
Récits
d’expériences déployées depuis les semences et leurs échanges jusqu’aux
fournils, visant à retrouver l’autonomie alimentaire et la
biodiversité, construire d’autres formes d’agricultures plus désirables
et sortir du capitalisme industriel, notamment en mettant un terme à
l’industrialisation de l’agriculture.
« L’immense majorité des champs sont
aujourd’hui remplis de quelques variétés de blé en lignée pure issues du
catalogue officiel, sélectionné pour leur force boulangère,
c’est-à-dire leur capacité une fois moulues à produire des pains très
aérés, pleins de glutens très tenaces et globalement mauvais pour la
santé. » « La baguette souvent érigée en symbole de la France est
massivement un pain fade, trop salé et dénué de presque tous ses
potentiels apports nutritifs. »
À la fin des années 1990, les
mobilisations contre l’arrivée des OGM débouchent sur un processus de
remise en culture de plantes sélectionnées en dehors du cadre de
l’agro-industrie. Des semences sont retrouvées dans les réfrigérateurs
du Centre de ressources génétiques de l’INRA à Clermont-Ferrand. Le
Réseau semences paysannes (RSP) est créé en 2004. Les paysan.nes
pratiquent une sélection massale en sélectionnant chaque année une
partie des grains avant de les planter à nouveau. Les blés ainsi
cultivés s’éloignent progressivement de la définition d’une variété en
lignée pure. Il ne s’agit pas de conserver une variété historique mais
d’acquérir une autonomie semencière, en se réappropriant des
savoir-faire autour de la production et de la sélection des semences.
« Le
bilan de l’agro-industrie est celui d’une grande dépendance aux engrais
et aux pesticides, d’une diminution sans précédent de la biodiversité
cultivée et d’une captation du revenu paysan par les fournisseurs et les
intermédiaires », au contraire des « blés paysans ». De la même façon,
l’industrie boulangère qui regroupe des pratiques telles que la baguette
blanche à 80 centimes, fabriquée et surgelée en usine puis vendue dans
un « point chaud », ou le pain « rustique » proposé par un.e artisan.e
de quartier, utilisent des variétés de blés en lignée pure, cultivées à
grands coups d’intrants chimiques, produisant une farine largement
dépourvue de qualités nutritives. La plus grande partie des bénéfices
remonte vers le même acteur économique.
Avec l’apparition des
botanistes au XVIIIe siècle, puis des semencier.ères, les relations
s’inversent : la pratique des paysan.nes va être orientée par la science
avec des objectifs de rendement, de précocité, de résistance aux
maladies. À partir des années 1930, un « catalogue » des variétés pures,
répondant aux critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité,
est progressivement mis en place par l’État qui « s’arroge le droit de
définir la liste exhaustive des plantes bonnes à cultiver », encouragé
par les industriels qui voulaient développer les marchés des machines
agricoles, des pesticides, puis des semences. Un décret de 1949 interdit
la commercialisation de semences de variétés non inscrites au catalogue
et en 1960, les variétés de pays (blés population) ont disparu de
celui-ci.
Si la boulangerie artisanale a connu une sorte de
résurrection dans les années 1990, il s’agit plus d’une diversification
de l’offre que d’un changement radical du mode de production. Les
franchisé.es comme les indépendant.es ont un contrat d’approvisionnement
exclusif avec des holding comme Vivescia.
« Les blés populations
s’adaptent aux évolutions du territoire dans lequel ils vivent. » La
notion de semences paysannes est en lien avec la conception de propriété
d’usage, en réponse à l’appropriation du vivant par l’industrie. La
construction de savoirs communs s’oppose à la distinction de la science
qui sait et de la population qui croit. Ces semences, libres de droits
de propriété, ne sont pas interdites même si elle ne figurent pas au
catalogue officiel, mais leur cession n’est autorisée qu’à des fins non
commerciales. On peut les semer pour son usage personnel, puis les
multiplier pour vendre la récolte ou la transformer. Les paysan.nes
peuvent fabriquer leur propre farine en échappant aux obligations qui
s’imposent à la meunerie, car le Code rural autorise toutes les
activités de transformations « qui sont dans le prolongement de l’acte
de production ».
« Aujourd’hui en France, l’immense majorité des
grains de blé est moulue « sur cylindres » : une technique datant du
XIXe siècle qui permet de moudre énormément de blé en très peu de
temps. » Les enveloppes, riches en fibres, en minéraux et en
oligoéléments sont séparées du reste du grain. La coopérative agricole a
remplacé le seigneur du Moyen Âge, garantissant aux paysan.nes
d’écouler leur production en échange d’une forme d’asservissement aux
lois du marché mondial du blé.
La mouture sur meules de pierre est
moins performante en matière de débit mais permet de conserver l’assise
protéique dans la farine. Le moulin Astrié, élaboré par deux frères dans
les années 1970, permet, en un seul passage, d’obtenir un taux
d’extraction maximal et, équipement modeste, va à l’encontre des
politiques de soutien au secteur agricole qui misent sur l’endettement.
Le trieur Marot qui connut son heure de gloire au milieu du XIXe siècle,
se trouve à bas prix et en état de marche, représente, de la même
façon, un outil réparable et d’usage simple, sans intervention de
spécialiste.
Le gluten est formé par les protéines les plus lourdes, une fois l’amidon du blé dissout lors du lavage de la farine. Il donne à celle-ci sa force boulangère, aujourd’hui deux fois et demi plus élevée qu’il y a soixante ans. L’intolérance au gluten de plus en plus développée par la population française, qui n’a rien à voir avec l’allergie, provoque une destruction des villosités de l’intestin grêle, les replis très fins qui permettent aux nutriments de passer dans le sang. Le principe chimique du levain est également exposé. Nous ne rapporterons pas ici en détail cette partie pourtant fort intéressante mais ne pouvons qu’inviter les lecteurs intéressés à s’y rapporter. En substance, la filière du pain en France se soucit plus de ses profits que de la santé des consommateurs et l’industrie, comme dans d’autres domaines, développe de nouveaux marchés en semblant réparer les désordres qu’elle a préalablement causés.
Ouvrage très technique mais parfaitement accessible. Cette somme de témoignages et cette restitution collective d’une démarche commune prouvent combien et comment il est possible de déjouer les pièges de l’industrie et des marchés pour déployer un réseau de résistance et de pratiques alternatives, dans les interstices de la loi.
NOTRE PAIN EST POLITIQUE
Les Blés paysans face à l’industrie boulangère
Groupe blé avec Mathieu Brier
210 pages – 13 euros
Éditions de la dernière lettre – Montreuil – Juillet 2019
zite.fr
https://bibliothequefahrenheit.blogspot.com/2019/12/notre-pain-est-politique-les-bles.html#more
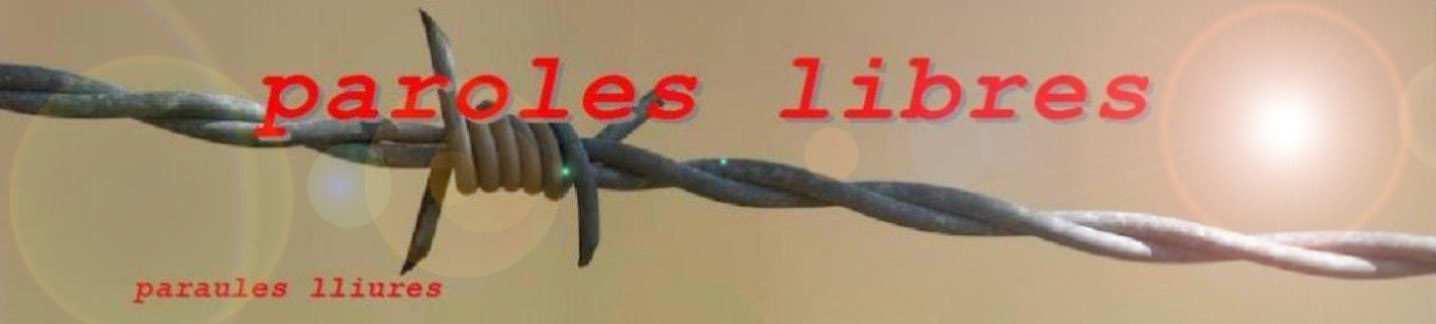
Commentaires récents