8 septembre 2025 par Floréal
On imagine assez peu Georges Brassens dans la peau d’un militant syndicaliste. Sa chanson « Le Pluriel » et le fameux débat arbitré par Jean-Pierre Chabrol, qui l’opposa amicalement à Jean Ferrat, en mars 1969, en ont fait à jamais un farouche partisan d’un inébranlable individualisme libertaire. Pourtant, il est arrivé que Brassens, sans perdre son inspiration libertaire, bien sûr, s’intéresse au sort de la classe ouvrière, comme en témoigne le texte ci-dessous, paru dans « Le Combat syndicaliste », organe de la Confédération nationale du travail (CNT), en avril 1947.
_______________

TROIS PETITES LETTRES
Il était une fois trois petites lettres, trois petites lettres de l’alphabet ; pas plus.
Trois petites lettres qui, partant du principe que l’union fait la force, se réunissent à la fin du siècle dernier.
Au grand bonheur des exploités, lesquels en conçoivent un immense espoir.
Au grand effroi du patronat qui, dans la crainte de perdre ses prérogatives, tombe aux genoux du ministre de l’Intérieur en le suppliant de perfectionner la machine policière.
Mais les trois lettres n’en ont cure.
Elles comptent près de cent mille adeptes.
Tout est possible à cent mille hommes qui veulent.
Au cours d’une année célèbre d’action directe, la grève générale est annoncée.
Si fort que la bourgeoisie perd contenance et que certains de ses représentants vont se cacher dans leurs caves, terrorisés.
Résultat satisfaisant.
Les trois lettres sautent de joie.
Seulement, quoique fort jeunes, elles ne manquent pas de réflexion et devinent bientôt le grave danger que représente la politique.
Aussi, le congrès d’Amiens, en 1906, les voit-il prendre la décision de demeurer toujours éloignées de ce foyer de corruption, de ne jamais céder aux avances des politiciens.
Tout marche à merveille.
Les exploités continuent d’espérer.
Les exploiteurs de trembler.
Mais la politique veille.
Elle n’a pas désespéré de mettre sa main malpropre sur les trois petites lettres dont la pureté devient choquante.
Et son opiniâtreté se voit bientôt couronnée. En 1914, la CGT accepte l’idée de l’union sacrée. C’en est fait de sa liberté, de son idéal. Chaque jour qui passe l’enfonce de plus en plus dans la lie.
La fameuse scission en fait deux parties, qui s’empressent de se prostituer. La première (CGT) dans les bras du Parti socialiste, la seconde (CGTU) dans ceux du Parti communiste.
De compromissions en compromissions, de déchéances en déchéances, elles en arrivent à devenir conseillères de l’Etat, agents d’exécution des réglementations gouvernementales.
La classe ouvrière, assidûment, progressivement trompée, ne cesse hélas de lui confier ses représentants.
Si bien que la Confédération générale de travail, « … qui avait été à l’origine un organisme destiné à endiguer les exigences du patronat au profit de la classe ouvrière », devient bientôt l’organisme chargé d’endiguer les exigences légitimes de la classe ouvrière au profit du patronat.
Et comme toutes ces infamies ne parviennent pas à satisfaire pleinement ce besoin de dégradation de la CGT, elle y met finalement le comble en s’abandonnant aux répugnantes caresses des policiers.
Des policiers qui, après le premier congrès de la CGT, reçurent du patronat l’ordre de sévir contre ce mouvement ouvrier menaçant dangereusement de saper les fondements de l’édifice bourgeois.
Les patrons peuvent exulter, dormir sur leurs deux oreilles.
Que risquent-ils, à la vérité ?
Ce sont eux qui mènent la barque et leurs défenseurs, les policiers, font partie de l’équipage.
Plus de danger et vogue la galère !
Plus de danger… en apparence seulement. Car un beau jour – plus proche que d’aucuns le supposent –, lassés de subir le joug de leurs maîtres, les matelots se souviendront des sens des mots mutinerie, insurrection et, ce jour-là, messieurs les capitaines, rira bien qui rira le dernier !
Il était une fois trois lettres, trois petites lettres bien pures…
Mais le temps a passé et avec lui la pureté. Aussi les ouvriers doivent-ils se persuader que ces lettres fameuses ne méritent rien d’autre que les cinq non moins fameuses avec lesquelles Cambronne fabriqua le célèbre mot.
Georges-Charles Brassens
(Le Combat syndicaliste, avril 1947)
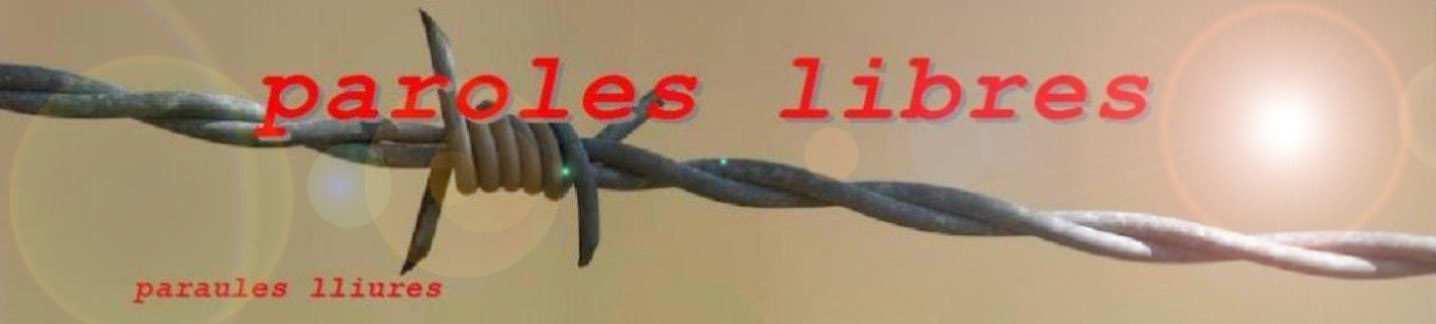
Commentaires récents