Mécénat
Depuis vingt ans, le groupe de Bernard Arnault, numéro un mondial du luxe, tisse sa toile dans le premier établissement culturel français. Au nom du mécénat, plusieurs marques de LVMH, de Louis Vuitton à Dior et Bulgari, sont autorisées à s’approprier les lieux et bénéficient de généreux privilèges. Sans résoudre le manque criant d’investissements dans la maintenance et la sécurité du musée, dont a témoigné le cambriolage retentissant du 19 octobre dernier.
Publié le 25 novembre 2025 , par Pauline Gensel

30 septembre 2025. Sous les dorures et les fresques, la voix de Cate Blanchett résonne, les mannequins défilent. C’est le deuxième jour de la fashion week, et les stars sont au rendez-vous : Zendaya, Emma Stone, Léa Seydoux… Toutes réunies pour découvrir la collection printemps-été 2026 de Louis Vuitton, qui célèbre « l’art de vivre » et rappelle que « le luxe ultime réside dans le choix de s’habiller pour soi-même, afin de révéler sa personnalité la plus profonde », comme l’écrit la marque. Le défilé prend place dans un lieu unique en plein coeur du musée du Louvre : les appartements d’été d’Anne d’Autriche, fraîchement rénovés. Et c’est peut-être ça, le véritable « luxe ultime » : avoir les moyens de s’approprier le premier établissement public culturel de France.
C’est peut-être ça, le « luxe ultime » : avoir les moyens de s’approprier le premier établissement public culturel de France
Depuis 2020, pas moins de dix défilés Louis Vuitton ont pris place dans l’enceinte du musée, plus d’un tiers des shows organisés par la marque durant cette période. En mars 2021, du fait des restrictions liées à la pandémie, la maison Vuitton présente sa collection à travers une vidéo dans laquelle les mannequins arpentent les couloirs déserts du Louvre, entre les statues, au rythme des tubes des Daft Punk. Puis les défilés s’enchaînent dans la cour Carrée année après année, avec des constructions toujours plus grandioses : une aire de jeu gigantesque pour un défilé en fanfare en juin 2022 ; une immense fleur-chapiteau rouge en octobre de la même année ; un appartement entier en janvier 2023 ; des boules lumineuses futuristes et un podium fabriqué à partir de malles Vuitton l’année suivante. À cette période, Louis Vuitton est l’un des principaux mécènes du Louvre, finançant le réaménagement des salles étrusques et italiques.
Mécénat intéressé
Cette mainmise de LVMH sur le prestigieux musée et ses lieux les plus iconiques date d’il y a près de vingt ans. Au début des années 2000, les défilés de mode sont confinés au Carrousel du Louvre, l’espace commercial souterrain situé entre le musée et le jardin des Tuileries. C’était sans compter sur la pugnacité du groupe de Bernard Arnault, qui obtient pour la première fois en 2007 le droit d’organiser un show dans la cour Carrée. Un privilège octroyé à LVMH en détournant quelque peu la législation sur le mécénat – dite loi Aillagon – adoptée quelques années plus tôt en 2003, comme le raconte Eliette Reisacher, alors étudiante à l’école du Louvre, dans un mémoire publié en 2019. Ce qui n’était pas possible sous la forme d’une simple location de l’espace le devient à titre de « contrepartie » d’un don opportunément accordé par le groupe de luxe.
L’idée première du mécénat est qu’il s’agit d’un soutien matériel sans contrepartie directe
L’étudiante rappelle pourtant que « l’idée première du mécénat est qu’il s’agit d’un “soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire”, donc désintéressé, alloué à un projet spécifique », et constate qu’il s’agit ici d’« un schéma totalement inverse avec un don intéressé, affecté sans grand intérêt à tel ou tel projet ». La location de la cour Carrée étant estimée à l’époque à 100 000 euros et les contreparties du mécénat limitées à 25% du don, LVMH a dû débourser un million d’euros par an pour y réaliser deux défilés chaque année. Sur cette somme, 600 000 euros seront pris en charge par l’État sous forme de réduction d’impôts.
« LVMH a fait tomber tous les tabous »
Depuis, il ne s’est pas passé une année sans défilé LVMH au Louvre. Entre 2014 et 2016, Louis Vuitton se concentre sur les nouveaux espaces de sa Fondation, dans le Bois de Boulogne, et sur la place Vendôme. C’est une autre marque du groupe qui le remplace dans la cour Carrée : Dior. Cette dernière a surtout investi le Jardin des Tuileries, dont elle finance le « réaménagement » et la « revégétalisation » via le mécénat à partir de 2019, aux côtés d’une autre maison LVMH, Moët Hennessy. Dior y réalise son dernier défilé le 1er octobre 2025 lors de la fashion week parisienne, avec comme mise en scène une pyramide inversée qui n’est pas sans rappeler celle du Louvre. Kenzo Parfums, également propriété de LVMH, a de son côté contribué au fleurissement du jardin à travers son mécénat de 2020 à 2023. Pour ses premières compositions florales, à l’été 2020, la marque de luxe a planté plus de 60 000 fleurs, dont 130 m2 de coquelicots, l’emblème de Kenzo.
En 2017, Louis Vuitton pénètre pour la première fois au sein même du musée pour présenter sa collection automne-hiver.
« LVMH, fort de sa puissance financière et politique, a fait peu à peu tomber tous les tabous au Louvre et obtient tout ce qui était auparavant interdit, observe Bernard Hasquenoph, journaliste et fondateur du blog Louvre pour tous, qui a publié une série d’enquêtes sur l’influence de LVMH dans le musée. Défiler dans la cour Carrée ? C’est fait. Organiser un show au sein même des collections ? C’est fait. Dîner au milieu des oeuvres ? C’est fait. »
Le 7 mars 2017, en effet, Louis Vuitton pénètre pour la première fois au sein du musée pour présenter sa collection automne-hiver. Le show se déroule dans la cour Marly, avec sa grande verrière et ses sculptures du XVIIe et XVIIIe siècle. Sept mois plus tard, la marque investit les sous-sols du pavillon de l’Horloge fraîchement rénovés pour un défilé devant le grand Sphinx de Tanis. L’année suivante, ce sera la cour Lefuel, pourtant fermée au public depuis 2007. Encore aujourd’hui, elle n’est accessible que lors de soirées spectacles l’été. En octobre 2021, c’est au tour du passage Richelieu d’accueillir le défilé Vuitton, perturbé par l’irruption de militants d’Extinction Rébellion, coupés au montage.

Soirées privées
D’autres événements encore plus select sont organisés par LVMH au sein du musée. Le 11 avril 2017, 200 invités se réunissent pour le dîner de lancement de « Master », collaboration entre Louis Vuitton et l’artiste Jeff Koons. Quelle salle à manger pour la famille Arnault et ses invités parmi lesquels Jennifer Aniston, Catherine Deneuve ou encore Adèle Exarchopoulos ? Rien de moins que la salle des États, où ils peuvent admirer la Joconde en toute tranquillité. Six mois plus tard, les 126 autres mécènes du Louvre auront finalement eux aussi le droit de manger dans l’une des salles du musée pour leur dîner annuel, mais sans Joconde. Ce sera dans la salle Daru, qui abrite l’immense tableau du Sacre de Napoléon.
Une centaine d’invités ont pu profiter d’un dîner privé dans la salle des Cariatides, au milieu des statues antiques.
Plus récemment, c’est la marque de joaillerie Bulgari, elle aussi propriété de LVMH, qui a bénéficié d’une soirée privée. Le 24 juin 2024, deux jours avant l’ouverture de l’exposition « Chefs d’oeuvres de l’exposition Torlonia », qu’elle a financée à travers son mécénat, une centaine d’invités ont pu profiter d’une visite privée en avant-première, d’une masterclass sur les pièces de haute joaillerie de la marque, puis d’un dîner privé dans la salle des Cariatides, au milieu des statues antiques. L’occasion pour la marque d’apposer son nom en lettres dorées gigantesques devant la façade du musée.
Quant au traditionnel dîner annuel des mécènes, il est financé de 2019 à 2024 par les dons de Moët Hennessy, la holding « Vins et spiritueux » de LVMH. L’événement a pris une toute autre ampleur en 2025 avec le lancement du « Grand dîner » du Louvre, un gala de levée de fonds. « Ils en ont fait un événement extrêmement mondain et médiatisé, fastueux, note Bernard Hasquenoph. Cela se fait beaucoup aux États-Unis, dans l’humanitaire notamment, mais c’est nouveau dans les musées en France. » Plus de 350 invités – dirigeants d’entreprises, créateurs de grandes maisons de mode, acteurs, chanteurs – se sont réunis dans la cour Marly pour un repas concocté par la cheffe étoilée Anne-Sophie Pic. Financé par Visa Infinite, « partenaire fondateur » de l’événement et de l’exposition associée « Louvre Couture. Objets d’arts, objets de mode », le gala a permis de récolter 1,4 million d’euros, et le musée a d’ores et déjà prévu de reconduire l’événement l’année prochaine, le 3 mars 2026. Un « succès » à relativiser tout de même au regard de son coût projeté : 1,1 million d’euros. Là encore, la majorité de l’argent du mécénat profite avant tout… aux mécènes.
L’État passe la main
Ces événements privés ne sont pas sans conséquence sur l’accessibilité du musée. Pour son rapport sur la gestion du Louvre, paru le 6 novembre 2025, la Cour des comptes a interrogé l’établissement sur les raisons qui empêchaient l’extension de ses horaires d’ouvertures, « alors même qu’une fermeture à 19h, voire 20h, permettrait de mieux répartir les flux de visiteurs dans la journée et de tenir compte de l’évolution des habitudes de vie des visiteurs notamment parisiens ou franciliens ». Réponse du Louvre : « Un élargissement des horaires à 19h ne serait pas compatible avec l’organisation des contreparties de mécénat et des locations d’espaces. »
L’importance prise par le mécénat au Louvre s’inscrit dans une dynamique amorcée il y a une vingtaine d’années dans les institutions culturelles, comme l’explique Jérôme Kohler, conseiller philanthropique et auteur de La main qui donne (éditions Charles Léopold Mayer, 2025) : « Pendant longtemps, les établissements culturels fonctionnaient essentiellement grâce aux subventions et à la billetterie. Mais les subventions et dotations publiques baissant, ils ont commencé à recruter du personnel pour accroître le mécénat, élargir leurs cercles d’amis du musée, développer la privatisation d’espaces. Ces pratiques, auparavant très marginales, sont aujourd’hui de plus en plus présentes. »
Le Louvre a préféré flécher ses ressources propres vers des « opérations visibles et attractives », plus à même d’attirer des mécènes, au détriment de l’entretien, de la rénovation des bâtiments et des investissements dans la sécurité.
« La dotation de l’État est censée payer les salaires des fonctionnaires du musée, explique un ancien responsable du Louvre, qui a souhaité garder l’anonymat. Mais aujourd’hui, elle est bien inférieure à la masse salariale, de 130 millions d’euros en 2024. A côté de ça, il y a toutes les charges d’entretien, de surveillance, de fonctionnement, qui représentent plusieurs centaines de millions d’euros. L’établissement se tourne donc de plus en plus vers les financements privés. Plus le Louvre est incité à développer ses ressources propres, plus il est inventif pour obtenir des fonds. »
Cette insuffisance chronique de la dotation publique peut avoir des conséquences dramatiques. Dans son rapport, la Cour des comptes alerte sur le « mur d’investissements immobiliers » auquel est confronté le musée, qui « a pris un retard considérable dans le rythme des investissements nécessaires à l’entretien et la mise à niveau de ses infrastructures, dont la dégradation s’est accélérée au cours des dernières années sous l’effet du haut niveau de fréquentation ». Entre 2018 et 2024, l’établissement a préféré flécher ses ressources propres vers des « opérations visibles et attractives », plus à même d’attirer des mécènes, comme l’acquisition de nouvelles œuvres ou le réaménagement de salles, au détriment de l’entretien, de la rénovation des bâtiments et des investissements dans la sécurité. Ce qui peut avoir des conséquences dramatiques, comme l’a montré le 19 octobre le vol des bijoux de la galerie Apollon.
Fonds de dotation
En 2024, les charges de fonctionnement du Louvre, personnel compris, s’élevaient à 298,4 millions d’euros. Les 99 millions d’euros de dotation de l’État pour cette année-là ne permettaient que de couvrir un tiers de ces dépenses. Pour rentrer dans ses frais, le musée a dû trouver d’autres sources de financement. En 2015, les ressources propres du musée (billetterie et mécénat) s’élevaient à 105 millions d’euros, un montant quasi égal à celui des subventions publiques. Dix ans plus tard, ces dernières n’ont pas augmenté, tandis que les ressources propres ont doublé pour atteindre 211 millions d’euros. Et ce, avant tout grâce à la billetterie, dont les revenus ont explosé pour atteindre 124,5 millions d’euros en 2024 – mais peut-être au détriment de son accessibilité pour les publics locaux et populaires. Le mécénat à proprement parler représentait cette année-là 20 millions d’euros.
En 2009, le Louvre est le premier musée français à créer un fonds de dotation, alimenté des dons de mécènes comme LVMH et des revenus issus de la location de son nom pour le Louvre Abu Dhabi.
Il y a aussi plus original : en 2009, le Louvre est le premier musée français à créer un fonds de dotation, alimenté des dons de mécènes et des revenus issus de la location de son nom aux Émirats-Arabes Unis pour le Louvre Abu Dhabi. En 2024, son portefeuille s’élevait à près de 279 millions d’euros et a rapporté 23,4 millions d’euros au musée. Parmi les principaux contributeurs, on retrouve sans surprise le groupe de Bernard Arnault. Louis Vuitton y a contribué dès 2013, en apportant 625 000 euros, complétés par 1,1 million d’euros l’année suivante. Christian Dior Couture s’est ajouté en 2015 et 2016 avec deux dotations de 1,25 million d’euros chacune. Au total, le groupe LVMH a donc versé au moins 4,2 millions d’euros au fonds de dotation du Louvre. Dont 2,5 millions d’euros défiscalisables.
Trésors nationaux
Le mécénat hautement médiatisé du groupe de Bernard Arnault en faveur du Louvre ne s’arrête pas là. En 2024, il a contribué à l’acquisition du tableau « Le Panier de fraises des bois », de Jean Siméon Chardin, une nature morte datant de 1761. Sur les 24,3 millions d’euros nécessaires à l’achat de l’œuvre, LVMH a « donné » 15 millions, qui s’ajoutent aux 20 millions d’euros de mécénat comptabilisés dans les ressources propres du musée pour cette année-là. Le tableau étant classé « trésor national », le groupe pourra bénéficier d’une déduction d’impôts exceptionnelle : 90% du montant du don. En réalité, le coût supporté par l’entreprise ne sera donc que d’1,5 million d’euros, le reste étant payé par l’État.
Pour l’État, 90%, c’est toujours un peu moins cher que 100%. Et la rigueur budgétaire est sauve puisque cette opération prend la forme de la renonciation à un impôt et non d’une dépense de crédits.
« C’est un dispositif qui a été mis en place par la France pour éviter que des chefs d’œuvres ne partent à l’étranger, explique Sabine Rozier, chercheuse et maîtresse de conférence en sciences politiques à l’université Paris-Dauphine. Le ministère de la Culture et les grands musées n’ont plus d’argent pour acheter ces trésors nationaux, donc ils contactent les entreprises, qui ont plus de souplesse financière et peuvent plus rapidement débourser plusieurs millions d’euros, en garantissant à ces entreprises qu’elles seront remboursées à hauteur de 90%. Pour l’État, 90%, c’est toujours un peu moins cher que 100%. Et la rigueur budgétaire est sauve puisque cette opération prend la forme de la renonciation à un impôt et non d’une dépense de crédits. Quant à l’entreprise, elle apparaît aux yeux du public comme étant généreuse, en ayant dépensé une fortune pour acheter un bien qui finalement a été en grande partie supporté par la collectivité nationale. » Cerise sur le gâteau : Dior a pu utiliser l’œuvre de Chardin comme décoration pour son défilé de juin 2025.
Dernier signe en date de l’omniprésence du groupe de luxe au sein de l’institution culturelle : Louis Vuitton a annoncé en 2025 devenir mécène de l’École du Louvre, établissement d’enseignement supérieur situé dans l’aile Flore du palais. L’entreprise financera deux bourses de recherche pour des doctorants « dont les travaux explorent de larges thématiques liées aux collections Louis Vuitton, ou à l’histoire de la Maison », ainsi que six bourses pour des étudiants en licence et master. Un partenariat qui, selon LVMH, « met en lumière la vision de Louis Vuitton en tant qu’acteur culturel et éducatif de premier plan », et qui lui permet aussi de s’acheter une place dans la manière dont s’écrira dorénavant l’histoire de l’art.
Pour ce qui est de la maintenance et la sécurité des bâtiments ou de la préservation de la vocation éducative et culturelle du musée du Louvre, ils attendent toujours leurs hypothétiques mécènes.
Article publié par Pauline Gensel
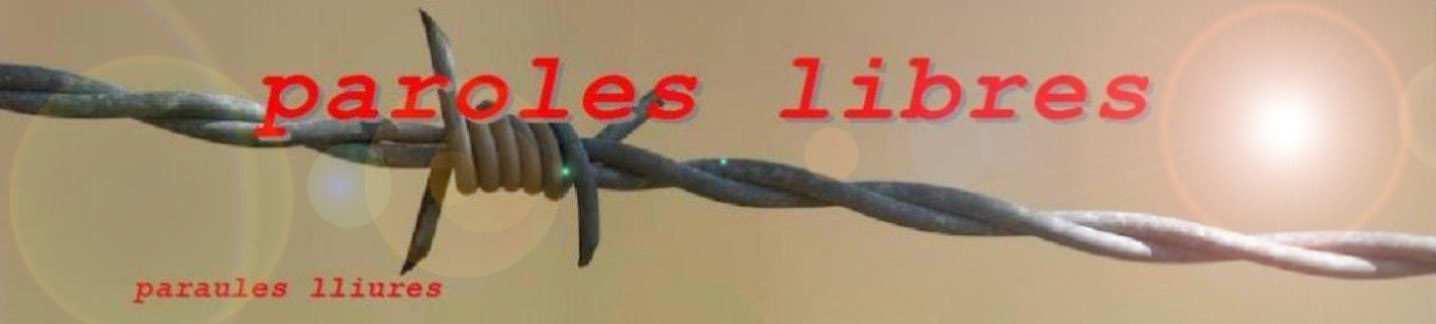
Commentaires récents