Décryptage
Le 10 Novembre 2025 9 min
[Vive la Sécu ! 11/14] Qu’il s’agisse d’accompagnement des chômeurs, de retraites ou encore de santé, le privé est loin d’être plus efficace que la protection sociale. Et il ne permet pas non plus de faire des économies.

C’est une petite musique qui revient régulièrement dans le débat, d’autant plus lors de la saison du budget : la protection sociale coûterait trop cher. Ainsi, pour faire des économies, certains défenseurs des restrictions budgétaires proposent de transférer certaines missions au secteur privé, assurant que cela permettrait de gagner en efficacité.
Pourtant, de nombreux travaux comparatifs démontrent le contraire. Du service public de l’emploi en passant par la retraite par capitalisation ou encore les systèmes de santé, le privé ne fait pas mieux. Alternatives Economiques en fait la preuve par trois.
1/ La retraite par capitalisation
En partie responsable du « trou de la Sécu », le déficit du système des retraites est régulièrement pointé du doigt. Le patronat avance donc régulièrement l’idée d’un système par capitalisation, en opposition au système par répartition que l’on connaît actuellement en France.
Pour rappel, dans notre système actuel, les actifs d’aujourd’hui financent, via des cotisations sociales, les pensions des retraités actuels. Et cela leur ouvre des droits pour leur future pension, qui, demain, sera payée par les cotisations des actifs de demain. Passer à un système par capitalisation constituerait un changement majeur : les individus placeraient leurs économies sur des comptes pour se constituer une retraite, espérant ainsi faire fructifier leur argent.
Problème, « les évaluations montrent que les rendements des investissements financiers sont très fortement corrélés avec les montants investis, souligne Clément Carbonnier, économiste codirecteur de l’axe de recherche politiques sociofiscales au Liepp de Sciences Po. Avec de la capitalisation, les petites retraites afficheraient de faibles montants. »
Un tel système serait donc criblé d’inégalités, comme le montre le dispositif de l’épargne retraite, qui existe déjà, et qui s’apparente à un dispositif de retraite par capitalisation. Non obligatoire, il est surtout utilisé par ceux qui en ont les moyens.
« Ce sont les plus riches et/ou ceux qui travaillent dans les “grandes et bonnes” entreprises, c’est-à-dire celles qui mettent en place un tel dispositif pour leurs salariés, qui mettent de l’argent de côté », expliquait Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po, dans un de nos précédents articles.
Ainsi, 16,6 % des ménages seulement possédaient un produit d’épargne retraite en 2021, principalement des cadres et professions libérales. Malgré les incitations fiscales, à l’image de la loi Pacte de 2019, qui a encouragé les travailleurs et travailleuses à se tourner vers l’épargne retraite, sa diffusion « reste limitée dans la population et concentrée sur des bénéficiaires aisés et âgés », constatait un rapport de la Cour des comptes, publiée en 2024.
Un système par capitalisation impliquerait par ailleurs davantage d’incertitudes liées aux fluctuations des marchés. « En Australie, lors de la crise de 2008, les retraités ont vu fondre leur capital retraite. Et un certain nombre d’entre eux ont dû reculer l’âge de leur départ à la retraite, parce qu’ils n’avaient plus assez », prévient Elvire Guillaud, maîtresse de conférences en économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Au-delà des crises, les rendements attendus des placements sur les marchés financiers sont systématiquement surévalués, et rien ne laisse penser qu’ils puissent apporter aux épargnants des revenus supérieurs au niveau des pensions issues de la répartition, comme l’ont montré récemment deux chercheurs dans nos colonnes. Le privé ne ferait donc pas mieux que la protection sociale en termes de retraites…
2/ La santé privée plus chère et moins efficace
S’il est, certes, régulièrement mis à mal, notre système de santé est pour le moins protecteur. En témoignent les travaux de Céline Jaeggy, directrice des affaires juridiques et institutionnelles à l’Unédic, repris dans une note de la Fondation Jean-Jaurès. Pour savoir si le privé serait plus efficace, la chercheuse a comparé les systèmes de santé français et états-unien. Une évaluation pertinente car, en France, les soins sont prodigués à tous (qu’importe l’âge, le niveau de revenu ou le statut social), alors que de l’autre côté de l’Atlantique, ce sont les assurances privées qui couvrent la majorité des Américains.
« Ce système trouve son origine dans le welfare capitalism (capitalisme social) porté par certains dirigeants d’entreprises jusqu’à la crise de 1929, explique Céline Jaeggy. Les employeurs accordaient des avantages sociaux à leurs ouvriers pour les attirer et les fidéliser, éventuellement mieux les contrôler, et éviter l’intervention des syndicats et/ou de l’État. »
Le problème, c’est que ce système est inégalitaire : en 2020, seuls 56 % des salariés états-uniens s’étaient vus proposer une assurance santé, avec d’importantes différences selon le secteur d’activité. Le système est, qui plus est, très sensible aux chocs sur le marché du travail. En cas de chômage, les individus se retrouvent souvent sans couverture médicale ou doivent la payer plus cher. Ainsi, en 2018, 8 % de la population américaine (soit 30 millions de personnes) n’était pas assurée.
Ce chiffre s’explique notamment par le coût très important des soins au pays de l’Oncle Sam. Les dépenses courantes de santé, en parité de pouvoir d’achat, s’y élevaient à environ 6 700 euros par habitant en 2021, contre 4 600 euros en France. Certes, des filets de sécurité, du type Medicare ou Obamacare, ont été ajoutés au fil des décennies, mais ils ne concernent qu’un peu plus de 30 % des couvertures santé. Et là encore, le coût des soins pèse, puisque ces assurances publiques représentent 4 896 dollars par an par personne, contre 3 724 en France.
Cette cherté a d’importantes répercussions, qui se lisent dans les indicateurs : « 22 % des Américains déclarent avoir renoncé à des consultations médicales pour raisons financières dans les douze derniers mois », notait Céline Jaeggy en 2023, contre 2 % pour les Français.
D’après l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), l’espérance de vie outre-Atlantique est de 76,1 ans, contre 82,5 ans en France en 2021. Les mortalités infantiles et maternelles, le taux de décès évitables grâce aux traitements ou encore, la densité des médecins, sont meilleures de ce côté de l’océan. « Comme quoi, ce ne sont pas forcément les systèmes qui ont le plus de privé qui fonctionnent le mieux, tant du côté de la santé, que du coût », résume Clément Carbonnier.
Dans son dernier ouvrage, le chercheur cite un autre exemple, suédois cette fois-ci. Une évaluation a comparé l’intervention d’ambulances privées et publiques (similaires au Samu français). Conclusion : le privé répondait plus vite aux appels (de huit secondes en moyenne) et rejoignait les lieux d’intervention plus rapidement (de une minute en moyenne). Mais cela se faisait au prix d’une surmortalité significative des patients.
« Une interprétation est alors que, pour gagner en rentabilité, les ambulances privées réalisent un travail moins approfondi, négligeant par exemple la qualité des diagnostics réalisés sur les lieux d’intervention, explicite le professeur d’économie. Des fonctionnaires bien formés, guidés par l’éthique du service public plutôt que par des incitations financières (…) peuvent mieux adapter leurs actions aux situations rencontrées, ce qui conduit à une production de service plus efficace. »
3/ L’accompagnement des demandeurs d’emploi
Les défauts du privé par rapport au public semblent également se vérifier pour le service public de l’emploi. Depuis plusieurs années, France Travail a tendance à externaliser de plus en plus l’accompagnement des chômeurs et à faire appel à des prestataires extérieurs.
« C’était déjà le cas, du temps de l’ANPE [l’Agence nationale pour l’emploi, qui a fusionné avec les Assédic en 2008 pour devenir Pôle emploi, NDRL], témoigne Guillaume Bourdic, élu CGT à France Travail. Mais ce n’était pas généralisé et automatisé comme ça l’est aujourd’hui pour une grande partie des contrats de sécurisation professionnelle ou pour les cadres. »
Un rapport des inspections générales des finances et des affaires sociales (l’IGF et l’Igas) consacré aux dispositifs de soutien à l’emploi et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi, abonde en ce sens. Il pointe la hausse des budgets des prestations sous-traitées de Pôle emploi, qui sont passés de 117 millions d’euros en 2019 à 417,7 millions en 2024. Or, ces prestations, pour plusieurs d’entre elles, sont « peu performantes et coûteuses », estiment l’IGF et l’Igas.
D’autres travaux, moins récents, montrent également que l’accompagnement des chômeurs n’est pas forcément meilleur lorsqu’il est réalisé par des entreprises privées. Dans une étude de la Dares (le service de statistiques du ministère du Travail), Luc Behaghel, Bruno Crépon et Marc Gurgand ont comparé, entre 2007 et 2008, deux dispositifs d’accompagnement, qui ont concerné 40 000 demandeurs d’emploi ayant un risque de chômage de longue durée. L’un de ces dispositifs était délégué à des opérateurs privés de placement (OPP), l’autre mis en œuvre par l’ANPE (Cap vers l’entreprise – CVE).
« Le rapport d’évaluation quantitatif, publié en 2009, montre que les résultats des CVE étaient dans l’ensemble meilleurs et plus homogènes que ceux des OPP (avec des “tailles de portefeuilles” similaires), résumait dans nos colonnes l’économiste Mathilde Guergoat-Larivière. Ces travaux indiquent qu’avec une charge de travail identique, le service public de l’emploi faisait mieux que les opérateurs privés de placement. »
La protection sociale mobilise des ressources financières importantes, c’est indéniable. Mais, d’une part, cet argent est très utilement dépensé et, d’autre part, rien ne laisse penser que le privé ferait mieux, surtout pour les plus modestes.
Retrouvez tous les articles de notre série sur les 80 ans de la Sécurité sociale en cliquant ici.

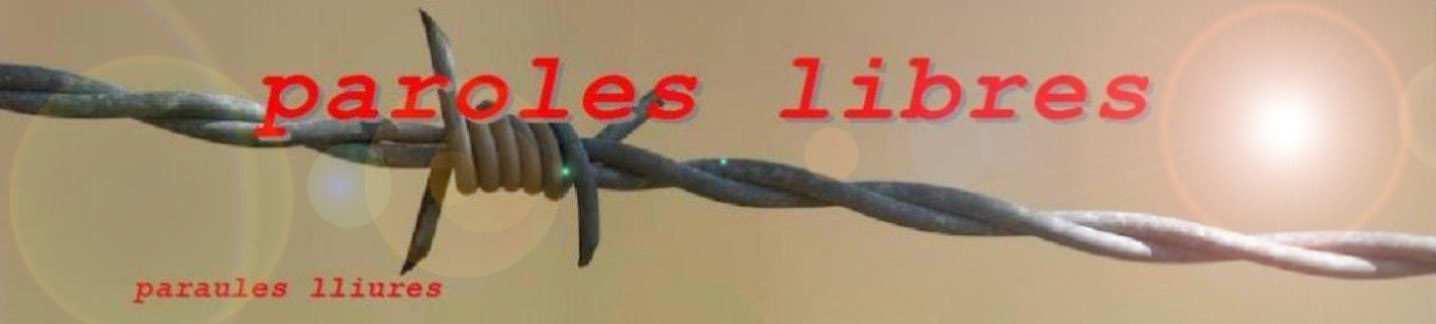
Commentaires récents