Analyse
Belém moi non plus. Quelques jours après le début du 30ème sommet mondial (COP30) sur le climat, la tournure des discussions inquiète alors que l’hôte brésilien promeut des solutions jugées inefficaces voire dangereuses, avec la bénédiction des pays riches.
- 13/11/2025
- Par Anne-Claire Poirier
Les choses avaient pourtant bien commencé lorsque, au lancement politique de la COP30 (deux jours avant l’ouverture officielle des négociations lundi), le président brésilien Lula avait appelé à une sortie «juste» et «ordonnée» des énergies fossiles, responsables de près de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais, quelques jours plus tard, «c’est déjà la douche froide», commente Fanny Petitbon, experte des négociations climatiques pour 350.org. De fait, les initiatives lancées jusqu’ici par le Brésil sont très loin de faire consensus.
Fonds pour la forêt tropicale : «On donne un prix à la nature»
Première d’entre elles : le lancement d’un fonds «innovant» pour lutter contre la déforestation des forêts tropicales, ces précieux puits de carbone et de biodiversité. Sur le papier, le Tropical forest forever facility (TFFF, pour les intimes) a le «potentiel pour aider à la protection de plus d’un milliard d’hectares de forêts tropicales dans plus de 70 pays en développement», fanfaronne la présidence brésilienne de la COP. L’initiative a déjà reçu le soutien de 53 pays, dont la France, et la mise de départ atteint pour l’instant 5,5 milliards de dollars (4,75 milliards d’euros).

Mais le fonctionnement de cet «outil financier» a de quoi gêner : «L’objectif est de collecter 25 milliards de dollars [21 milliards d’euros] auprès des États et 100 milliards de dollars [86 milliards d’euros] supplémentaires auprès d’investisseurs privés, décrit Clément Hélary, chargé de campagne Forêts de Greenpeace. Cet argent sera ensuite placé sur les marchés financiers pour que les profits générés soient ensuite reversés aux pays forestiers, mais seulement après avoir d’abord rémunéré les investisseurs privés.» Ses promoteur·ices ont promis de ne pas investir dans des produits «qui ont un “impact environnemental significatif” mais c’est encore très vague», constate-t-il.
Concrètement, les pays forestiers sont censés recevoir quatre dollars (3,44 euros) par hectare de forêt et par an. «Si d’une année à l’autre la surface de leur forêt a diminué, un malus de 400 dollars [344 euros] par hectare disparu est déduit, précise Clément Hélary. L’idée est de rendre la protection de la forêt plus intéressante financièrement que sa destruction.» Ce faisant, «le TFFF s’engage sur une pente dangereuse qui consiste à donner un prix à la nature et à compter sur les marchés financiers pour en payer le prix», enrage Andrea Echeverri, militante colombienne du réseau d’ONG Global Forest Coalition.
Quadrupler l’usage des agrocarburants : la proposition inflammable du Brésil
«On peut payer pour protéger les forêts, mais si derrière on ne combat pas les vrais moteurs de la déforestation, ça ne suffira pas», ajoute Clément Hélary. Or, de ce point de vue, les efforts de la présidence brésilienne pour promouvoir les agrocarburants (des carburants produits le plus souvent à partir de matières premières agricoles) semblent «particulièrement problématiques», selon lui. Le pays vient de convaincre 19 autres (dont l’Inde, l’Italie ou le Japon) de rejoindre son «Engagement de Belém pour les carburants durables» (ou Belém 4X) dont l’objectif est d’en quadrupler la production et l’utilisation d’ici à 2035.
«Alors qu’il dit vouloir lutter contre la déforestation, l’extension des surfaces dédiées aux agrocarburants est justement une grande menace pour les forêts et les peuples autochtones qui en vivent», pointe Clément Hélary. Pionnier des agrocarburants et deuxième producteur mondial derrière les États-Unis, «le Brésil défend ici des intérêts économiques, essentiellement de grandes entreprises, mais les risques sociaux et environnementaux sont immenses», s’alarme Fanny Petitbon, de 350.org. Entre autres, «mobiliser des terres pour produire du carburant entre en concurrence avec la production alimentaire», explique Judith Lachnitt, chargée de plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire.
Sans compter que, lorsque les effets du changement d’affectation des sols (passage d’une forêt à une monoculture de maïs par exemple) sont pris en compte, la majorité des agrocarburants émet plus de gaz à effet de serre que les carburants conventionnels, comme l’a démontré une étude de la Commission européenne dès 2016.
Les marchés carbone ont la côte
Pour les pays riches qui soutiennent l’initiative Belém 4X, l’utilisation d’agrocarburants est présentée comme un moyen de verdir les carburants utilisés dans les transports ou la production d’énergie. «C’est surtout un moyen pour prolonger l’utilisation de véhicules thermiques et retarder la transition», cingle Fanny Petitbon.
On retrouve la même logique dans la défense enthousiaste des marchés carbone par le Brésil, avec la bénédiction des pays riches. Pour rappel, la mise en place de ces marchés permettra à des pays pollueurs d’acheter à d’autres des crédits carbone générés par son stockage dans des forêts ou par le développement de projets d’énergies renouvelables. «Le Brésil y voit un moyen de générer des revenus grâce à ses immenses forêts tandis que les pays riches y voient un moyen de continuer à polluer», explique Sara Shaw, des Amis de la Terre International.
Autrefois prudente sur l’utilisation de ces crédits carbone, l’Union européenne vient d’officialiser qu’elle en utiliserait pour atteindre ses objectifs climat à 2040, à hauteur de 5% sur les -90% visés (entre 1990 et 2040). Or, de nombreuses enquêtes ont déjà démontré le manque de robustesse et de fiabilité des organismes qui gèrent ces crédits. En 2024, une enquête menée par plusieurs médias internationaux avait montré que plus de 90% des crédits carbone octroyés par la société Verra (grand nom du secteur) pour des projets liés à des forêts tropicales étaient des «crédits fantômes» : ils ne correspondaient à aucun bénéfice réel pour le climat.
Technologies vertes ou «colonialisme vert»
L’enthousiasme béat des pays riches pour les énergies renouvelables ou les voitures électriques inquiète de plus en plus les représentant·es de la société civile, en particulier dans les pays du Sud où sont extraits l’essentiel des «minerais de la transition». Parmi ces derniers : le cobalt congolais (pour les batteries de véhicules électriques), le cuivre chilien (pour les câbles électriques) ou le silicium et les terres rares chinois (respectivement pour les panneaux solaires et pour les éoliennes en mer).
«Pour beaucoup de nos confrères et consœurs au Sud, la question de la transition énergétique est vécue comme une fausse solution car on est en train de reproduire les erreurs du modèle extractif fossile, détaille Clara Alibert du CCFD-Terre solidaire. Bien sûr ces technologies sont indispensables pour se sevrer des énergies fossiles, mais si on ne questionne pas nos modes de vie, notre consommation d’énergie, c’est insuffisant. On oublie que l’extraction minière est extrêmement violente pour l’écosystème et pour les communautés locales qui en vivent.»
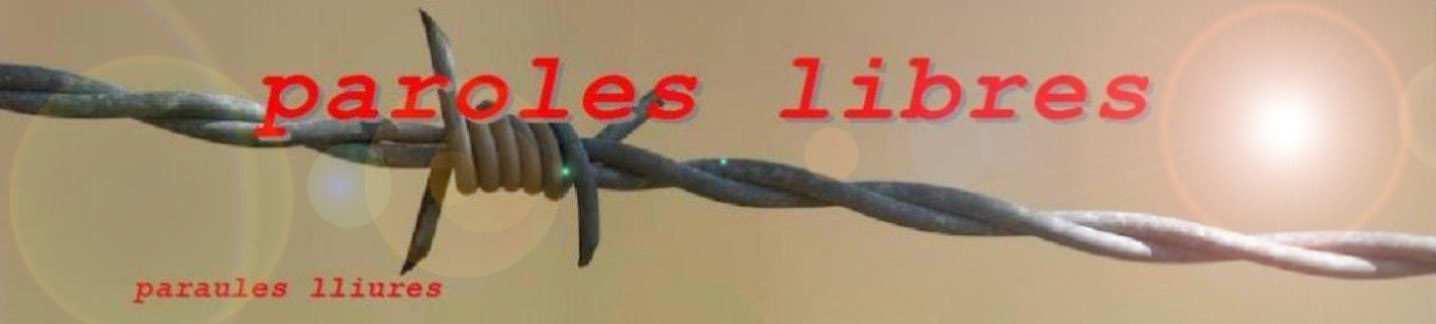
Commentaires récents