Que peuvent nous apprendre les discours prononcés devant les tribunaux par des manifestant·es emprisonné·es sur l’ampleur de la résistance anti-guerre en Russie ? L’historien britannique Simon Pirani discute de son nouveau livre Voices Against Putin’s War (Voix contre la guerre de Poutine) avec le journaliste russe indépendant Ivan Rechnoy.
Simon Pirani est un chercheur et auteur britannique qui a écrit sur l’énergie et l’écologie, l’histoire de la révolution russe, le mouvement ouvrier et la Russie post-soviétique. Son dernier ouvrage, Voices Against Putin’s War: Protesters’ Defiant Speeches in Russian Courts (Voix contre la guerre de Poutine : les discours provocateurs des manifestant·es devant les tribunaux russes), compile et analyse les discours prononcé·es devant les tribunaux par douze prisonnier·es condamné·es pour avoir résisté à l’agression russe en Ukraine.
— Aujourd’hui, en Russie, des centaines de personnes purgent des peines de prison pour avoir critiqué l’invasion de l’Ukraine. Douze d’entre elles font l’objet de votre livre. Comment les avez-vous sélectionnées ?
— Nous voulions montrer que l’opposition à la guerre de Poutine est très répandue. Ce qui frappe chez ces personnes, c’est leur diversité. Elles appartiennent à différentes générations, ont des expériences de vie différentes et défendent des opinions politiques différentes. Cette diversité démontre que, malgré l’absence de manifestations publiques et l’impossibilité réelle d’organiser un mouvement anti-guerre ouvert en Russie, un mouvement anti-guerre existe bel et bien dans ce pays. Il englobe un très large spectre de la société russe ainsi que des personnes issues des territoires occupés. Par exemple, le livre présente le discours prononcé au tribunal par Bohdan Ziza, originaire de Crimée.
Nous avons décidé de ne pas inclure dans le livre certains des opposants à la guerre les plus connus, ceux qui ont prononcé des discours courageux et fondés sur des principes devant les tribunaux, comme Ilya Yashin, par exemple. Leurs déclarations avaient déjà été largement diffusées dans les médias ici. Notre objectif était plutôt d’attirer l’attention des lecteurs anglophones sur des personnalités moins connues.
D’une part, il y a celles et ceux qui se sont contentés de s’exprimer ou de publier des déclarations sur les réseaux sociaux. Par exemple, Darya Kozyreva, la plus jeune personne présentée dans le livre, a été arrêtée pour avoir déposé des fleurs au monument Taras Shevchenko à Saint-Pétersbourg. D’autre part, il y a celles et ceux qui ont agi, par exemple en lançant des bombes incendiaires, non pas dans l’intention de blesser quelqu’un, mais pour attirer l’attention sur l’injustice de la guerre. Igor Paskar et Alexei Rozhkov font partie de ces personnes. Ce sont des personnes qui vivent dans de petites villes loin de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, où les jeunes hommes sont beaucoup plus susceptibles de recevoir des avis de conscription.
Nous avons également inclus la déclaration de Ruslan Siddiqi, qui a saboté une voie ferrée pour empêcher les munitions d’atteindre l’Ukraine.
Les textes du livre ont été rassemblés par un groupe d’ami·es qui, depuis l’invasion de février 2022, traduisaient les déclarations faites au tribunal et certains des messages publiés dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Alors que nous étions déjà bien avancés dans ce processus, de nombreux nouveaux documents ont été publiés sur le site web Poslednee Slovo [note de l’auteur : le nom du projet signifie « la dernière déclaration »]. Il s’agit d’un projet formidable qui fait un excellent travail de collecte et de publication d’un éventail de cas beaucoup plus large que celui que nous pouvions couvrir.
Nous nous sommes limité·es aux personnes qui ont fait des déclarations explicitement anti-guerre au sujet du conflit en Ukraine. Cependant, comme vous le savez, de nombreuses et nombreux autres prisonniers politiques ont comparu devant les tribunaux depuis l’invasion de 2022, et bien d’autres encore avant cela, en particulier parmi les prisonnier·es politiques tatars de Crimée. Elles et ils sont tous représentés sur le site web Poslednee Slovo. Une autre particularité remarquable de ce site est qu’il remonte jusqu’à la période soviétique. Il comprend les discours prononcés en 1966 par Andreï Siniavski et Youli Daniel, qui sont peut-être les premiers exemples depuis l’époque de Staline de personnes utilisant le droit à une dernière déclaration devant le tribunal comme forme de propagande.
Notre livre comprend un chapitre qui répertorie dix-sept autres cas de personnes ayant prononcé des discours anti-guerre, en plus des douze protagonistes dont nous avons publié les déclarations complètes. Nous espérons que mes collègues ou moi-même finirons par traduire également tous ces discours.
Malheureusement, le discours final devant le tribunal est devenu une sorte de genre littéraire à part entière. Cela en dit long sur la période difficile et effrayante que nous traversons.
— Quel est selon vous le public cible de ce livre ? S’agit-il de personnes en Occident et ailleurs qui ont déjà une certaine compréhension de la situation en Russie et souhaitent en savoir plus ? Ou s’agit-il de lecteurs à qui vous souhaitez transmettre un message politique, voire les persuader de quelque chose ?
— Le livre est en anglais et s’adresse donc plutôt à des lecteurs et lectrices anglophones qu’à des lecteurs et lectrices russophones. Seul un faible pourcentage de la population au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe sait lire le russe. Depuis 2022, nous sommes nombreuses et nombreux à connaître le sort réservé au mouvement anti-guerre en Russie. Comme vous le savez, il a commencé par de grandes manifestations, mais il est rapidement devenu difficile, puis presque impossible, de protester. Puis sont venues les attaques à la bombe incendiaire contre les centres de recrutement militaire, des actions qui ne visaient pas à blesser des personnes, mais à attirer l’attention sur la cause anti-guerre. Nous avons ensuite commencé à lire, dans les médias d’opposition russes, les dernières déclarations des figures de l’opposition, les tribunaux étant devenus, en effet, le dernier forum public en Russie où il était encore possible de manifester.
Cependant, je pense que beaucoup de personnes dans les pays anglophones ignorent encore tout cela.
Donc, pour répondre à votre question, notre objectif est de toucher un public plus large dans les sociétés occidentales : non seulement celles et ceux qui ont suivi de près l’attaque de la Russie contre l’Ukraine et ses conséquences, mais aussi celles et ceux dont la compréhension de la situation ne provient que de ce qu’elles ou ils ont appris par hasard dans les médias.
— L’un des personnages centraux de votre livre est Alexandre Skobov. On pourrait dire qu’il fait le pont entre deux époques. Il était dissident en Union soviétique et fait aujourd’hui à nouveau partie des persécutés. Il existe un autre exemple similaire qui n’est pas mentionné dans le livre : Boris Kagarlitsky. Comment les Occidentaux perçoivent-iels la différence entre les répressions actuelles et le mouvement dissident pendant la guerre froide ? Comment voient-iels la différence entre la situation actuelle en Russie et celle en Occident ?
— Tout d’abord, j’aimerais dire quelques mots au sujet de Skobov. Ayant régulièrement voyagé en Russie entre 1990 et 2019, j’ai été profondément marqué par ces discours prononcés devant les tribunaux. Le premier que j’ai entendu était celui d’Igor Paskar. Je me suis dit : « Mon Dieu, ce sont des gens si jeunes — pas les plus jeunes, mais quand même beaucoup plus jeunes que moi — qui se sont engagé·es dans ce combat. » Le discours d’Alexander Skobov m’a également ému, peut-être parce qu’il a à peu près mon âge — un an ou deux de moins — et, comme vous l’avez dit, il fait le pont entre deux époques.
J’ai été particulièrement touché par la lettre qu’il a écrite à sa compagne, Olga Shcheglova. Elle a été publiée dans Novaya Gazeta Europe, et nous l’avons également incluse dans le livre. Dans cette lettre, Skobov explique que certain·es de ses ami·es et camarades l’ont exhorté à quitter la Russie, mais qu’il a refusé. Cela rendait inévitable qu’il finisse par être jugé et emprisonné. Dans cette lettre, il explique qu’il voulait faire savoir à la jeune génération que le petit groupe de dissident·es auquel il appartenait autrefois – l’aile socialiste du mouvement dissident soviétique – était solidaire d’elle en ces temps difficiles. Il voulait que ce message soit inscrit dans l’histoire.
Je pense que c’est une déclaration très importante, et nous devons tous et toutes être reconnaissantes à Alexander Skobov d’avoir relié ces deux périodes historiques par son sacrifice. J’espère que le fait d’inclure ses déclarations dans notre livre aidera les Occidentaux à mieux comprendre cette continuité.
Je vais essayer de répondre à votre question sur la façon dont ces mouvements sont perçus. À l’époque soviétique, les Occidentaux considéraient généralement le mouvement dissident comme très restreint et marginal. Compte tenu du fonctionnement des communications à l’époque, il était très difficile de faire passer des informations. Bien sûr, il y a eu de grandes révoltes contre le pouvoir soviétique, à commencer par le soulèvement de Novotcherkassk dans les années 1960 et d’autres révoltes violentes dans les années 1970 et 1980. J’ai un ami en Ukraine qui a étudié la grande révolte qui a eu lieu à Dniprodzerzhynsk. Ces mouvements ont été de très courte durée et nous en savions très peu à leur sujet en Occident, même celles ou ceux d’entre nous qui s’intéressaient à ce qui se passait en Union soviétique.
Aujourd’hui, les Russes — et les Ukrainien·nes, bien sûr — ont beaucoup plus d’occasions d’avoir de véritables conversations avec des personnes d’Europe occidentale. Je pense que les puissances de l’époque ont vraiment réussi à diviser l’Europe ; il y avait véritablement un rideau de fer. Mais cela n’existe plus aujourd’hui. Des millions d’Ukrainien·nes et de Russes vivent en Europe occidentale, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les personnes apprennent à communiquer entre elles et entre eux et à travailler ensemble de nouvelles manières.
Nous pouvons déjà en voir des exemples en Allemagne, au Royaume-Uni et ailleurs. Je pense que ce dialogue doit se poursuivre, et notre livre, je pense, s’inscrit dans cette continuité.
Bien sûr, il n’est pas facile de communiquer avec quelqu’un·e qui se trouve littéralement dans une prison russe. Cependant, grâce aux ami·es, aux camarades et aux familles des personnages centraux de notre livre, j’espère que ce dialogue s’engagera et se poursuivra sur une longue période.
— Je voulais vous interroger plus précisément sur la possibilité de relier les agendas russe-ukrainien et israélo-palestinien. Nous sommes bien sûr impressionnés par l’énorme mobilisation en faveur de la Palestine. Dans le même temps, beaucoup de personnes à gauche sont frustrées que le soutien actif à l’Ukraine — un pays qui se trouve dans une situation similaire à celle de la Palestine à certains égards — soit beaucoup moins répandu en Europe et en Occident. Y a-t-il eu récemment des développements positifs à cet égard ?
— Depuis octobre 2023, nous avons tous et toutes assisté avec horreur à l’assaut israélien sur Gaza. Il a été largement reconnu comme un génocide, et nous assistons aujourd’hui à un mouvement anti-guerre plus important et plus durable dans les pays occidentaux que nous n’en avons vu depuis des décennies — comparable peut-être seulement aux protestations contre l’invasion de l’Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni en 2003, ou même au mouvement contre la guerre du Vietnam dans les années 1970.
L’une des raisons pour lesquelles j’ai estimé qu’il était important de traduire ces textes en anglais était de montrer au public occidental à quel point le mouvement anti-guerre russe a des points communs avec les mouvements ici. Bien sûr, leurs ennemis sont différents, se situant de part et d’autre du fossé géopolitique, et il existe également de nombreuses autres différences. Pourtant, les similitudes sont frappantes et profondément significatives. Les motivations de certaines des personnes qui ont prononcé ces discours devant les tribunaux – dont nous avons traduit les déclarations – sont très similaires à celles des militant·es britanniques qui ont été arrêté·es pour avoir soutenu Palestine Action, ou de celles et ceux qui ont rejoint la flottille récemment interceptée par les forces israéliennes alors qu’elle tentait d’atteindre Gaza.
J’ai passé une grande partie de l’année dernière à participer aux grandes manifestations britanniques contre l’attaque israélienne sur Gaza et à appeler à un cessez-le-feu. Avec des ami·es, nous avons brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire : De l’Ukraine à la Palestine, l’occupation est un crime ». Notre groupe voulait montrer aux autres manifestant·es que la lutte de l’Ukraine pour l’autodétermination nationale et celle des Palestinien·nes pour se libérer de l’occupation israélienne ont un point commun essentiel : le droit de décider de leur avenir, sans ingérence étrangère ni menaces militaires.
Nous avons reçu une réponse très intéressante de la part d’autres manifestant·es. Celles et ceux qui connaissent bien la politique des mouvements dits de gauche et socialistes reconnaîtront la réaction d’une petite minorité, composée principalement de personnes âgées, qui nous ont dit des choses comme : « Pourquoi prenez-vous le parti de l’Ukraine ? L’Ukraine n’est qu’un jouet des puissances occidentales, une marionnette de l’OTAN. Pourquoi même parler de cette question ? » Pourtant, la grande majorité – plus de 90% – de celles et ceux qui nous ont abordé·es ont dit : « Ah, oui, nous n’y avions pas pensé de cette façon auparavant, mais il y a vraiment quelque chose en commun entre ces luttes. »
Un autre obstacle majeur à l’unité provient non seulement du « campisme » de certain·es militant·es de gauche – celles et ceux qui se concentrent exclusivement sur l’impérialisme américain et britannique tout en minimisant ou en excusant l’impérialisme russe – mais aussi de l’État, de la presse grand public et de la propagande gouvernementale. Le discours officiel soutient systématiquement l’Ukraine et condamne sans réserve la résistance palestinienne. Les gens ordinaires ressentent ce déséquilibre : le racisme et la discrimination à l’égard de la cause palestinienne, parallèlement au favoritisme de l’establishment envers l’Ukraine. Il y a une part de vérité dans cela : la machine de propagande de notre classe dirigeante ici est largement favorable à l’Ukraine. Les travailleurs et travailleuses britanniques et européennes le remarquent et deviennent méfiant·es. Cependant, je pense que c’est une méfiance que nous pouvons surmonter – et c’est ce que notre expérience nous a montré.
Tout cela n’est que mon opinion personnelle. L’objectif de ce livre est toutefois de faire connaître aux lecteurs et aux lectrices anglophones les voix de nos ami·es et camarades en Russie, ces personnes courageuses qui se sont retrouvées devant les tribunaux et qui, dans certains cas au risque de se voir infliger des années de prison supplémentaires, ont choisi d’exercer leur droit constitutionnel (qui n’est pas toujours respecté par les juges) de prononcer une dernière déclaration devant le tribunal. C’est une décision remarquablement courageuse et difficile à prendre.
— Je tenais à vous remercier pour votre livre, et je voulais également vous demander, puisque vous vous intéressez à ce sujet depuis longtemps : comment cet intérêt est-il né, et pourquoi la Russie est-elle devenue si importante pour vous ?
— Mon lien avec la Russie a commencé avec le mouvement syndical. Je me suis rendu pour la première fois en Russie en 1990, à Prokopyevsk, en Sibérie occidentale, où les grèves des mineurs de 1989 avaient éclaté. À l’époque, je travaillais comme journaliste pour le syndicat des mineurs ici au Royaume-Uni. Nous avons vu là une occasion de développer des liens de solidarité entre les mineurs soviétiques et les mineurs britanniques. Et nous avons obtenu un certain succès. Nos ami·es du syndicat britannique des mineurs ont établi des relations très étroites avec le Syndicat indépendant des mineurs du Donbass occidental, basé à Pavlograd. Cette amitié perdure encore aujourd’hui.
À l’époque, j’étais membre d’une organisation trotskiste et, en août 1990, nous avons organisé une réunion à Moscou pour marquer le 40e anniversaire de l’assassinat de Trotsky. Cela s’inscrivait également dans le cadre d’un dialogue entre les socialistes occidentaux et les populations de Russie et d’Ukraine, qui avait été pratiquement impossible pendant la « guerre froide ».
J’ai continué à suivre l’actualité en Russie et en Ukraine, et à écrire à ce sujet. Entre 2007 et 2021, j’ai travaillé dans un institut de recherche, où j’ai rédigé des articles sur les secteurs énergétiques de ces pays.
Depuis la pandémie, je ne suis pas retourné en Russie. Le 24 février 2022, lorsque l’invasion a commencé, j’étais chez moi et j’ai été choqué. Nous avons tous et toutes été choquées. L’invasion a tout changé, tant en Ukraine qu’en Russie, pour de nombreuses années à venir. Avec des ami·es, nous avons commencé à traduire ces discours prononcés devant les tribunaux et à les publier en ligne. Peu à peu, ce travail a donné naissance à l’idée de créer un livre.
J’espère que vos lecteurs et lectrices le liront. Plus tard dans l’année, nous allons mettre le livre à disposition gratuitement au format PDF, afin que tout le monde puisse y avoir accès.
Si nous gagnons de l’argent – et je dois dire que c’est un livre très bon marché –, tous les bénéfices iront à Memorial et aux prisonnier·es politiques. Personne ne tire profit de ce projet. L’objectif est simplement de partager ces voix avec un public beaucoup plus large.
https://www.posle.media/article/we-wanted-to-show-the-whole-range-of-anti-war-resistance-in-russia
Traduit par DE
En complément possible :
Résister à la machine de guerre de Vladimir Poutine
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/10/17/resister-a-la-machine-de-guerre-de-vladimir-poutine/
Introduction à « Voix contre la guerre de Poutine — Discours provocateurs des manifestant·es devant les tribunaux russes »
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2025/10/06/introduction-a-voix-contre-la-guerre-de-poutine-discours-provocateurs-des-manifestant·es-devant-les-tribunaux-russes/
******
Russie, dissidence et migration :
au cœur de la reconfiguration culturelle de Berlin
Berlin a toujours été un refuge pour les écrivain·es russophones, depuis les exilé·es de la révolution de 1917 jusqu’aux auteurs/actrices d’aujourd’hui qui rejettent la politique guerrière de Poutine. Les écrivain·es arrivé·es avec la dernière vague migratoire apportent avec elles et avec eux des perspectives littéraires qui renégocient l’identité, la résistance et l’appartenance.
Dans sa critique du dernier ouvrage de l’autrice israélienne Linor Goralik, Exodus-22, la poétesse russe Polina Barskova décrit la dernière vague d’émigration intellectuelle depuis la Russie : « Nous savons où se trouvait la ligne de fracture. Mais qu’en est-il des autres lignes ? Au-delà de cette seule marque catastrophique qui a divisé l’histoire moderne de la Russie en un « avant » et un « après », des millions d’autres lignes sont apparues, des millions de vies ont été brisées. Qui répondra de toutes ces vies, et qui racontera leur histoire ? »
Berlin a toujours été un lieu où resurgissent de nombreuses lignes de l’histoire fracturée de la Russie. Les schémas de migration intellectuelle imprégnaient le tissu socioculturel de la ville bien avant la guerre actuelle. Aujourd’hui, de nouvelles trajectoires culturelles en langue russe sont tracées et retracées chaque jour pour façonner des récits alternatifs.
Au lendemain de la révolution bolchevique de 1917, Berlin est devenue une destination pour de nombreux intellectuel·les russes, qui s’y sont installés·e ou ont simplement visité la ville. Parmi eux figuraient les écrivain·es Vladimir Maïakovski, Nina Berberova, Marina Tsvetaïeva, Viktor Chklovski et Vladimir Nabokov. En 2025, la ville accueille des écrivain·es qui s’opposent au récit littéraire diffusé par le gouvernement du président russe Vladimir Poutine et condamnent son invasion à grande échelle de l’Ukraine et la guerre en cours.
Les dernières vagues migratoires d’écrivain·es russes et russophones vers Berlin renvoient à des épisodes antérieurs d’exil. Mais elles marquent également une nouvelle expérience de la migration, notamment en ce qui concerne les positions anti-guerre des auteurs et autrices, leur sentiment d’appartenance et les questions d’identité.
La cinquième vague : exil, censure et recherche d’une voix
L’espace culturel russe, de plus en plus restreint par la censure et la persécution de la liberté d’expression, nie toute vision alternative du présent et du passé. Le gouvernement de Poutine mène une lutte acharnée contre toute personne qui proteste publiquement, s’exprime ou écrit au sujet de l’invasion, ou qui ose même la qualifier de guerre. Les mouvements anti-guerre de toutes sortes ont été poursuivis, notamment pour avoir produit des documents qui, selon le gouvernement, diffusaient délibérément de « fausses informations » sur les activités des forces militaires russes.
Un nombre important d’intellectuel·les, d’artistes, d’écrivain·es et de poètes/poétesses russes ont quitté leur pays, où leurs publications ont été interdites. Dans de nombreux cas, la vente de leurs œuvres en Russie a été suspendue, souvent en raison de la censure. Cet exode, qualifié de cinquième vague d’émigration culturelle, comprend des personnalités telles que Viktor Shenderovich, Lyudmila Ulitskaya, Maria Stepanova, Viktor Yerofeyev et Dmitry Glukhovsky. Il convient de noter que les premier·es émigrant·es, tels que Boris Akounine (pseudonyme de Grigori Chkhartishvili) et Dmitri Bykov, avaient commencé à partir avant même la guerre, créant ainsi un précédent pour les vagues d’émigration suivantes.
À Berlin, de nombreuses couches migratoires imprègnent le tissu urbain de la ville, où elles se chevauchent et coexistent pour former un palimpseste de dissidence. Pourtant, même si les émigrant·es sont poussé·es hors de Russie pour différentes raisons et à différents moments, elles et ils parviennent à se réunir sous une bannière commune de dissidence envers la Russie et la guerre. Berlin ne se contente pas de maintenir son rôle historique de plaque tournante de la culture des émigrés russes, mais le renouvelle également grâce à des initiatives qui remettent en question le discours officiel de l’État russe.
Réseaux alternatifs : le tissu culturel berlinois de la dissidence
Les émigré·es russes à Berlin font partie d’une scène culturelle hybride, souvent fragmentée. Parmi eux, on trouve des écrivain·es tel·les que Maria Stepanova, connue pour ses mémoires publiées en 2021, In Memory of Memory, et son roman Focus, qui traite de la migration et de l’appartenance ; Dinara Rasuleva, une écrivaine tatare russophone qui expérimente les langues, la migration et l’identité ; et le poète Alexander Delphinov, cofondateur du théâtre Panda Platforma, un lieu destiné aux « artistes oppositionnel·les à l’esprit démocratique qui n’ont aucune chance d’atteindre le public dans leur pays d’origine » et qui prend « une position active contre la propagande d’État russe ».
De nombreuses autres lignes s’entrecroisent dans la ville, comme celle de la librairie Babel Books, fondée après le début de la guerre et qui sert aujourd’hui de point de référence pour les auteur·es migrant·es qui s’opposent ouvertement à la guerre. La librairie accueille des événements culturels et des présentations de livres tels que le volume Artists Against the Kremlin.
Cette année, Berlin a également accueilli le Salon du livre russe de Bebelplatz, dont l’un des objectifs est de lutter contre l’interdiction des livres et de présenter « des textes en langue russe non censurés qui ont vu le jour en réponse à l’agression, à la violence, à la désorientation, afin de repenser le passé qui a conduit à la guerre ». Le salon a donné lieu à des discussions sur des visions alternatives de la littérature russe et à la remise du prix Dar, un prix littéraire indépendant fondé par l’écrivain Mikhaïl Chichkine qui soutient les auteur·es qui recherchent une littérature en langue russe « responsable envers l’humanité et non envers les dictatures ».
Le Künstlerhaus Bethanien est un autre centre culturel dynamique qui a accueilli des initiatives telles que l’exposition No, organisée par le site d’information Meduza, et l’exposition Boxed de la journaliste Anna Narinskaya, qui dénonce les violations des droits des personnes LGBTQ+ en Russie. Il convient également de mentionner la revue russo-allemande Berlin Berega, fondée bien avant la guerre et qui soutient aujourd’hui les voix alternatives russes et russophones en exil.
Ces exemples sont loin d’être une liste exhaustive des personnes et des événements qui contribuent à développer une approche alternative de la lecture, de la production et de la diffusion de la littérature russe et en langue russe. Mais pris ensemble, ils révèlent la réponse intellectuelle à la guerre : condamnation des hostilités, dissidence envers le gouvernement de Poutine et croyance en un nouveau destin pour la littérature écrite en russe.
La question de savoir si ces réseaux alternatifs de voix formeront une force culturelle dissidente solide et cohésive reste ouverte. Ce que l’on peut observer aujourd’hui, c’est une réaction à grande échelle à la situation actuelle et l’articulation de différentes lignes de l’histoire russe qui convergent, divergent et coexistent à Berlin.
Michela Romano, 22/10/2025
Michela Romano est doctorante à l’université de Bologne. Ses recherches actuelles portent sur la littérature dissidente russe et russophone contemporaine, en particulier celle des écrivain·es migrant·es à Berlin.
https://www.zois-berlin.de/en/publications/zois-spotlight/russia-dissent-and-migration-inside-berlins-cultural-reconfiguration
Traduit par DE
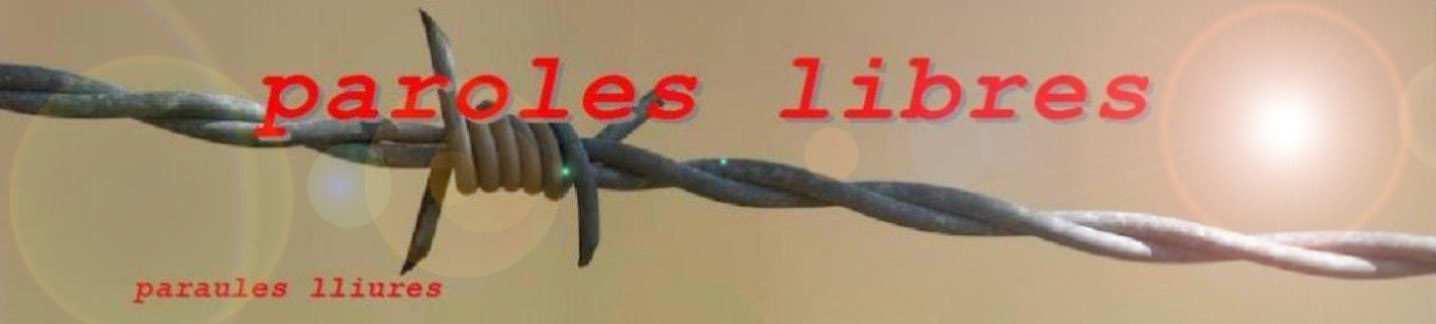

Commentaires récents