Depuis la fin des années 1970, près d’un millier de personnes sont mortes à la suite d’une interaction avec la police. Comment expliquer cette spirale et comment y remédier ? Familles de victimes, chercheurs et politiques proposent des mesures.
par Ludovic Simbille, Névil Gagnepain
30 octobre 2025 à 09h30, modifié le 31 octobre 2025 à 09h21 Temps de lecture : 9 min.
Cet article est publié dans le cadre de notre partenariat avec Le Bondy Blog.

Un mort. Un quartier qui s’embrase. Des escadrons d’uniformes. Un emballement médiatique. Une prise de parole des autorités pour dédouaner la police de ses actions. Une contestation de cette version par les proches du défunt. Une marche blanche. Un appel au calme et à faire confiance à la justice. De longues années de procédure judiciaire…
De Vaulx-en-Velin en 1979 à Nanterre en 2023, en passant par Clichy-sous-Bois en 2005, cette spirale se répète régulièrement depuis plus de quarante ans. En face, que fait l’État ? « Sans une volonté politique du gouvernement, on ne pourra pas mettre un terme aux bavures policières », s’alarmait déjà en 1979 le dirigeant de la Fédération autonome des syndicats de police (Fasp), Bernard Deleplace.
En France, au moins 945 personnes sont décédées directement ou indirectement à la suite d’une mission des forces de l’ordre depuis 1977, toutes circonstances confondues (hors opérations terroristes). En vingt ans, les interventions létales de la police ont quasiment triplé. Sans préjuger de la légalité ou de la légitimité des interventions policières mortelles, la cartographie de Basta! couvre une diversité de situations auxquelles sont soumises les forces de sécurité.
Ces décès ne résultent pas nécessairement de la dangerosité de l’interpellation ni du dérapage d’un fonctionnaire, bien que cela ne soit pas exclu. La grande majorité des personnes décédées n’appartenait pas au grand banditisme. Au-delà du funeste nombre de morts, la régularité et la similarité de ces issues tragiques révèlent leur caractère prévisible. Et laissent donc entrevoir des possibilités de les éviter.
Depuis des années, des collectifs de familles de victimes des forces de l’ordre formulent en ce sens une série de revendications, consultables ici.
Supprimer l’IGPN ?
Deux tiers des interventions policières mortelles ne débouchent sur aucun procès. Zones d’ombres, omissions, contradictions, disparitions de pièces illustrent la fabrique de l’impunité policière dans ces affaires. En cause notamment : l’IGPN, l’Inspection générale de la police nationale, régulièrement accusée de couvrir les collègues policiers.
De leur côté, les fonctionnaires se plaignent d’une profession trop contrôlée. En réalité, la « police des polices » sanctionne davantage un vol ou une malversation qu’une violence policière. Cela fait des années que des journalistes, des associations (dont Amnesty International, l’Acat, Flagrant déni) ou des commissions parlementaires documentent l’absence de transparence et d’impartialité de l’IGPN et de son pendant pour la gendarmerie, l’IGGN. « Ce n’est pas aux policiers d’enquêter contre des policiers », résume Fatou Dieng, sœur de Lamine Dieng, étouffé dans un fourgon de police en 2007. Fatou est membre du réseau Vérité et justice, un collectif qui exige la création d’un organe de contrôle indépendant de la police.
Sur le même sujetDepuis Zyed et Bouna, 162 personnes sont mortes suite à une tentative de contrôle de police
De telles institutions autonomes existent au Royaume-Uni et au Québec, qui a créé en 2016 le bureau des enquêtes indépendantes (BEI). Son efficacité est à relativiser au vu du nombre de décès depuis sa création et reste vivement critiquée pour sa partialité et sa consanguinité, la moitié de ses membres étant issus du corps policier.
Mais au moins, « au Canada, la société civile peut elle-même réunir des preuves et les transmettre aux magistrats sans passer par le ministère de l’Intérieur. Ce qui donne aux enquêtes une réelle objectivité », vante Farid El Yamni, dont le frère Wissam est mort après neuf jours dans le coma, à la suite de son arrestation violente à Clermont-Ferrand, le soir du 31 décembre 2011. « En France, l’IGPN ne remet pas de copie de son audition au témoin, et elle peut verser ce qu’elle veut au dossier judiciaire », ajoute-t-il.
Selon lui, dans le cas de la mort de son frère, l’IGPN a démenti avoir auditionné certains témoins ayant assisté à un tabassage dans le commissariat, témoins qui ont pourtant affirmé avoir été entendus. Farid El Yamni préconise la création d’une commission parlementaire sur les expertises mandatées par la justice. « Ça montrerait qu’elles n’ont rien de scientifique », assure celui qui a porté plainte contre le médecin légiste .
Interdire certaines techniques d’interpellation
Les familles de victimes veulent surtout empêcher en amont la survenue de nouveaux drames. Elles pointent notamment certains gestes techniques professionnels d’intervention (GTPI), à l’origine de trop nombreux décès et bannis dans certains pays. Parmi eux : les clefs d’étranglement, le plaquage ventral, le pliage. Leur interdiction serait-elle efficace ? Dans la réalité, quand certaines techniques controversées sont bannies, elles sont souvent remplacées par d’autres, ou utilisées autrement.
À la suite du décès de Cédric Chouviat, étranglé et plaqué au sol lors d’un contrôle routier en janvier 2020, la clef d’étranglement est « abandonnée » comme l’avait promis Christophe Castaner, alors ministre de l’Intérieur. Mais elle est finalement remplacée en 2021 par trois prises inspirées d’arts martiaux. Ce qui n’a pas empêché huit autres personnes de succomber depuis à une arrestation musclée. Idem pour la technique dite du pliage, proscrite en 2003, après plusieurs tentatives mortelles d’expulsion du territoire français de personnes en situation irrégulière. Depuis, plusieurs personnes sont mortes dans les mêmes conditions. Mais que le geste soit légal ou non, l’usage de la force par un agent dépend aussi des « consignes de ses supérieurs, de l’impunité que le policier ressent quand il se sait dans l’illégalité », analyse Farid El-Yamni.
Abroger l’usage des armes en cas de refus d’obtempérer ?
C’est pour réguler cet usage de la force que de nombreuses voix veulent l’abrogation de l’article L. 435-1 du Code de sécurité intérieure, qui autorise les policiers à faire usage de leur arme en cas de légitime défense, notamment en cas de refus d’obtempérer. « L’abroger, c’est survivre », martèle l’association Save, pour Stop aux violences d’État, fondée par Samia et Issam El Khalfaoui, tante et père de Souheil, tué par un tir policier à Marseille en 2021.
En attendant, les gendarmes cherchent très officiellement à changer les modes de contrôle et d’interception face aux refus d’obtempérer. Car les accidents routiers mortels consécutifs à des refus d’obtempérer sont en hausse ces dernières années, jusqu’à dix-neuf cas en 2023.
En théorie, les poursuites de véhicules sont réservées à des faits d’une grande gravité. Mais en mai 2025, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a donné pour instruction de pourchasser par principe celles et ceux qui n’obéissent pas aux ordres d’arrêt.
Sur le même sujetFatou Dieng : face aux violences policières, « ne rien faire était impossible »
Dans la majorité des cas de fuites mortelles, les personnes avaient tenté d’éviter un contrôle de police, que ce soit pour un délit mineur ou sans avoir commis aucun délit, comme Zyed et Bouna en 2005 à Clichy-sous-Bois. Les tentatives de vérification d’identité sont à l’origine d’un quart des missions policières létales depuis 40 ans.
Des zones sans contrôle d’identité ?
Avec 47 millions de contrôles d’identité recensés en 2021 par la Cour des comptes, la France se distingue par son usage peu modéré de cette pratique. Un rapport du Défenseur des droits publié en juin soulignait que « les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont 4 fois plus de risque d’avoir été contrôlés que le reste de la population, et 12 fois plus de risque de faire l’objet d’un contrôle “poussé” (fouille, palpation, conduite au poste, injonction à quitter les lieux) ».
Chez les indés
La revue de presse du journalisme engagé : une sélection d’enquêtes, de récits, et d’alternatives parues dans la presse indépendante, directement dans votre boîte mail. Mon adresse email :
En m’inscrivant j’accepte la politique de confidentialité et les conditions générales d’utilisation de Basta!
Ces contrôles au faciès sont la conséquence de la perception de la délinquance, entretenue par l’institution, dès l’école de police. « Ce qui crée les conditions propices à la violence policière, ce sont les contrôles répétés des mêmes individus par les mêmes policiers. Ça crée des tensions, des accros qui ne peuvent avoir que des conséquences négatives », explique Magda Boutros, politologue, coautrice avec Aline Dallière d’une étude sur la verbalisation de jeunes jugés « indésirables » par la police. « Dix fois dans une même journée, ça ne peut pas être un contrôle de routine », raille Fatou Dieng, qui souhaite la délivrance d’un récépissé avec motif à la personne appréhendée en cas de contrôle. « Au moins, le policier devra se justifier. » À défaut de moins contrôler.
Quand, en 2021, la Défenseure des droits Claire Hédon a proposé d’expérimenter des « zones sans contrôle d’identité », elle s’est vu reprocher par les syndicats de police un laxisme envers les délinquants.
L’efficacité de ces vérifications d’identité demeure pourtant très relative. Dans un rapport d’information parlementaire (de 2021), le sociologue Sebastian Roché estime que « 95 à 97 % » des contrôles d’identité ne permettent pas « d’envisager le début d’une procédure judiciaire quelconque ». « L’IGPN elle-même remet en cause l’efficacité de ces contrôles », ajoute ce rapport. « C’est un mythe de penser que moins de contrôles va faire exploser la délinquance », souligne la chercheuse en sciences politiques Magda Boutros. Elle mentionne le cas de la police new-yorkaise, qui avait réduit drastiquement ses contrôles à la suite d’un procès en 2013. « On n’a pas vu monter la criminalité », constate la politologue.
Pour une autre police ?
Une « autre police serait-elle possible » ? La France insoumise souhaite refondre l’institution policière de la « cave au grenier » : démanteler certaines unités (BAC, Brav-M) au profit d’enquêteurs, restreindre l’usage des armes, améliorer le recrutement des fonctionnaires afin de restaurer la confiance entre police et population.
La « police de proximité » est aussi souvent présentée à gauche comme une alternative à la répression. Elle avait été mise en œuvre de 1998 à 2002, sous le gouvernement de Lionel Jospin, avant d’être démantelée par Nicolas Sarkozy sous la pression de sa politique du chiffre. Selon nos données, la période 1998-2002 ne se distingue pas par une baisse remarquable des interventions policières létales. « Toutes les solutions réformistes sont bonnes, mais ne peuvent pas fonctionner seules », analyse Farid El Yamni.
Loin de renouer avec la police de proximité, les vingt dernières années ont plutôt marqué une militarisation du maintien de l’ordre, en banlieue et en manifestation, ayant conduit à plusieurs morts (Rémi Fraisse, Zineb Redouane, Steve Caniço, Mohamed Bendriss…) et à des dizaines de blessés et mutilés. Les unités spéciales (Raid, GIGN) sont davantage sollicitées pour des missions de droit commun quand les autres brigades deviennent lourdement équipées d’un arsenal d’armes (taser, LBD, fusils d’assaut). Même les policiers municipaux sont désormais près de 60 % à disposer d’une arme à feu. Il paraît loin le temps où un ministre de l’Intérieur, Pierre Joxe, avait tenté en 1990 de désarmer ses troupes, avant de se dédire face à la bronca des syndicats de police.
Vers une décroissance sécuritaire ?
Depuis, les lois sont toujours plus répressives, les prisons n’ont jamais été aussi remplies et les interventions policières sont plus souvent fatales. « Est-ce que la situation française s’est améliorée sur le point de la sécurité ? Non ! » analyse le sociologue Laurent Bonelli, qui prône une « décroissance sécuritaire ». « On a intégré une sorte de pensée magique, une sorte de mythe selon lequel la police serait capable de résoudre tous les problèmes sociaux », dénonce-t-il.
Contrairement à une idée reçue, la lutte contre la « délinquance » n’excède pas 20 % de l’activité de la police, rappelle le sociologue.
La plupart du temps, les fonctionnaires de police interviennent pour des problèmes de voisinage, d’incivilité, d’infraction routière, d’alcoolisme, de drogue, voire de santé mentale.
En dix ans, plus de 50 personnes souffrant de troubles psychiatriques sont mortes après une intervention de police, d’après un recensement de StreetPress.
Réorienter les missions ?
Au-delà de leurs méthodes, les missions confiées aux agents pourraient aussi être repensées. Plutôt que de mettre du bleu partout, le réseau Vérité et justice envisage par exemple de confier à d’autres services que la police la prise en charge de certaines situations. Par exemple, les interventions pour des personnes en état d’ébriété ou les plaintes pour violences conjugales.
C’est aussi le sens du mouvement abolitionniste Defund the Police, né à Minneapolis aux États-Unis lors des soulèvements de 2020 consécutifs au meurtre de George Floyd. Entre mai 2020 et janvier 2021, le mouvement est parvenu à faire affecter une partie du budget dédié aux polices locales vers des travailleurs sociaux ou des communautés qui gèrent les problèmes de santé, d’éducation, de logement. Les effets de ces mesures sont difficilement mesurables, puisque la plupart des municipalités ont rétropédalé dans les années suivantes.
Malgré tout, « la priorité, c’est de repenser les missions des policiers, il faut une réforme totale de l’institution », plaide Almamy Kanouté, actif dans le Comité Adama, du nom d’Adama Traoré, mort en 2016 lors d’une interpellation de gendarmes à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise). Car, rappelle Farid El Yamni : « Il y a nos vies à sauver. »
https://basta.media/zyed-bouna-morts-de-la-police-comment-les-empecher
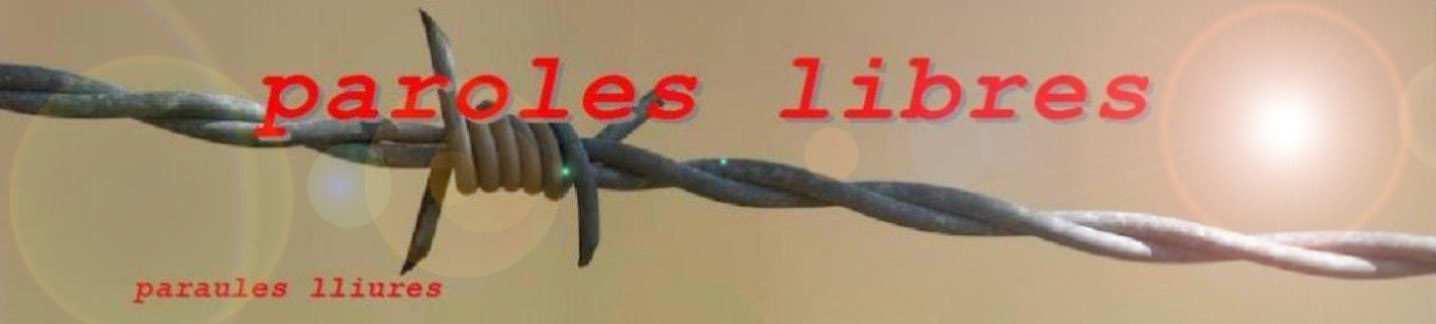
Commentaires récents