Article mis en ligne le 20 octobre 2025
par F.G.

■ Freddy GOMEZ
FOLIES D’ESPAGNE
Ombres et lumières d’un anarchisme de guerre
L’échappée, « Dans le feu de l’action », 2025, 384 p.
« Je n’écris que pour être relu. »
Walter Benjamin, Conversation avec André Gide.
Disons, par commodité, que c’était il y a un peu plus de trente ans. Disons que j’avais la vingtaine et que je sortais, très tardivement, de l’œuf. Soit d’une longue adolescence et d’un milieu familial modeste où régnait un désert tant culturel que politique. Disons, enfin, qu’il y eut cette fondamentale rencontre avec un couple d’amis qui me fit bifurquer et entrevoir les rivages du continent Anarchie – et de sa fille aînée : la Révolution espagnole. Avouons, surtout, que de cette grande fresque humaine je ne comprenais pas grand-chose et que, pétrifié par mon inculture, je me décidai à y remédier en lisant tout ce qui me tomberait sous la main. Mon premier achat fut aussi hasardeux que malheureux, un poche intitulé sobrement La Guerre d’Espagne d’un certain Guy Hermet [1]. Fier de ma trouvaille, je le présentai à mes amis qui grimacèrent : pas sûr que je trouve là-dedans matière à penser les enjeux soulevés par ces trois années de guerre civile. Pas sûr non plus que j’y rencontre la Révolution…
Des années plus tard, je l’ai revisité sommairement ce bouquin édité en mars 1989. Il suinte la posture mandarinale et l’académisme aux ordres où la guerre civile espagnole se résume ainsi : dans son tortueux chemin vers l’unité nationale et la démocratie libérale, l’Espagne s’est déchirée au cours d’une séquence vue comme le « rattrapage dramatique [d’un] retard historique ». Avec comme malheureux corollaire, ces excès commis par les « extrémistes de gauche comme de droite »… L’historien Hermet semble voir dans la visée libertaire un exotisme à la fois perché et terrifiant ; en Aragon, « l’hégémonie des courants les plus illuminés de l’anarchisme y fait que la propriété et la monnaie s’y trouvent purement et simplement abolies en mains endroits ». Dans cette « mutation sociale un peu trop forcée », règne ici un « puritanisme moral assez hallucinant » tandis qu’ailleurs, dans le Sud andalou par exemple, des « nouveaux bandits de grand chemin deviennent les gardes civils qui ont pris le maquis et survivent en volant alentour ». Selon Hermet, « l’exubérance révolutionnaire assez terrifiante des anarchistes » a tout fait pour saper le rempart républicain antifasciste. Pire : « Le règne des milices ouvrières ne fait pas obstacle ou participe même à la furie meurtrière qui frappe l’Espagne dite loyaliste pendant les premiers mois de la guerre civile. » Surtout, Hermet-le-pieux semble particulièrement hanté par l’« holocauste » antireligieux – la « plus grande hécatombe anticléricale avec celle de la France révolutionnaire puis du Mexique d’après 1911 » – auquel il consacre de nombreuses pages. Voilà pour le topo circonstancié de ce spécialiste de l’histoire des démocraties et des populismes. Voilà pour cette mise en bouche qui aurait pu, alors, me vacciner contre l’« extrémisme anarchiste ». Fort heureusement la suite a été toute autre.
Liquider les utopies d’hier
« Illuminés », « hallucinant », « holocauste »… Quelles sont donc ces « folies d’Espagne » capables de pousser un observateur de la chose politique du gabarit de Hermet dans des débordements aussi outranciers ? Une piste ? Hermet est un habitué des colonnes de Catholica, revue de réflexion politique et religieuse. Une inclinaison toute légitime mais qui conditionne quelque peu sa vision des hommes et de leurs combats. Malgré ses sources chiffrées et sa cuirasse honoris causa reconnue par ses pairs de l’Alma Mater madrilène, l’historien reste un idéologue. Petit soldat pour qui l’Histoire est un fléchage, souvent accidenté, mais forcément ascensionnel où l’ordre et la raison, souvent du côté des puissants, s’affrontent dans un combat sans cesse rejoué à la déraison des masses bestialisées ou manipulées. Une fois purgés ces moments de « folies » meurtrières, les passions s’éteignent et se sédimentent ; alors sur un charnier encore tiède, les vainqueurs promeuvent un esprit de concorde à la faveur d’un grand pardon œcuménique – ou d’un business plan planétaire. « Au lendemain de la mort de Franco, écrit Freddy Gomez, la “transition démocratique” naquit d’un pacte négocié par une gauche institutionnelle soucieuse d’entrer dans le jeu politique et par une droite toujours franquiste, mais désireuse de ne pas en sortir. […] Deux ans après la mort de Franco, les commentateurs fascinés du modèle espagnol pouvaient ainsi s’extasier : la guerre était enfin finie. Et de fait, elle l’était, ce pacte impliquant, sinon le silence, comme on l’a dit abusivement, du moins l’oubli des anciennes querelles et, plus encore, du côté des historiens, une approche résolument objectivée de l’histoire contemporaine de l’Espagne. » Approche résolument objectivée aurait pu être écrit en italique tant son format responsable et dépassionné cache une charge : celle visant à liquider les utopies d’hier afin de les rendre indisponibles pour les combats d’aujourd’hui. Privé de mémoire, un peuple est un poisson rouge qui tourne en rond. Pour les requins de la pire espèce, c’est alors open-bar.
Mémoire donc ! Mémoire surtout ! Mais laquelle ? Celle, espagnole, de 1936-1939 est un canevas d’une densité remarquable. Elle fut la raison première pour laquelle la revue À contretemps existât, du début des années 2000 jusqu’en 2014 sous sa forme papier, puis sous ce format numérique dans lequel ces lignes apparaissent. Au lecteur, on ne fera pas l’affront de présenter son principal animateur : Freddy Gomez. On se permettra juste de souligner la position, assez cocasse, du soussigné attaché à son tour à recenser… une collection de recensions.
La recension est un drôle d’exercice critique : objet à la fois autonome et lié au texte auquel elle se réfère. Elle est susceptible de provoquer sa propre mise en abîme d’où naitra une nouvelle recension. Nous y sommes, au cœur d’une boucle rétroactive constituée d’un échantillon de 35 longues notes de lecture rassemblées en un recueil au titre inquiétant : Folies d’Espagne : ombres et lumières d’un anarchisme de guerre. Ça commence par un « tombeau », celui de Durruti, et ça se termine par une « imposture », celle de Jorge Martínez Reverte, « commentateur journalistique et essayiste approximatif ». Autant dire que le ton est donné : celui d’une balistique précise et affûtée passant au crible le bref été révolutionnaire, les années de guerre, la lutte antifranquiste et la transition démocratique. Un peu moins de quatre décennies donc où Freddy Gomez pèse et soupèse une multitude d’enchaînements circonstanciels, entre embrasements collectifs et choix tactiques, qui vit une partie du peuple espagnol, sur ses terres ou depuis l’exil, tenter de dépasser l’historique fatalité de son assujettissement.
Éxécutif « stalino-républicain »
Pour qui s’intéresse de près ou de loin à cette guerre sociale, ces Folies d’Espagne constituent une somme incontournable. Les habitués du titre À contretemps le savent : la plume de Freddy Gomez est redoutable. Par son savoir, précis jusque dans les plis les plus serrés de la grande fresque libertaire, par son art de mettre au jour et de problématiser des angles morts souvent douloureux, par son expression qui chemine entre art du portrait au ras des chairs et poétique crépusculaire. Par cette habileté, fort rare au demeurant, consistant à manier subjectivisme situé et objectivisme critique. Chroniquant un ouvrage de Francisco Carrasquer, ancien milicien de la colonne Durruti devenu essayiste et traducteur, et donc porteur de la mémoire révolutionnaire espagnole, Freddy Gomez le complimente pour son « habile juxtaposition de la connaissance et du sensible ». On ne croit pas se tromper en indiquant que la plume gomézienne trempe dans le même encrier.
Une précision d’importance : si la plupart des livres auxquels se réfèrent les recensions compilées ici ont été édités en espagnol, il n’est absolument pas nécessaire de les avoir lus pour en tirer la substantifique moelle. Les textes de Freddy Gomez sont à prendre comme autant de petits essais s’attachant à travailler les nœuds les plus complexes et douloureux de ce qui se révéla être, pour les anarchistes, un « conflit immédiat et définitif entre utopie et principe de réalité ».
Appuyer et creuser là où ça fait mal. Non par sadisme mais parce que c’est précisément dans ces plaies du passé mal cicatrisées – ou trop rapidement refermées – que se nichent les scories encore chaudes et encombrantes de ce que fut cet « anarchisme de guerre ». Guerre tous azimuts, ouverte ou bien larvée, frontale ou traître : contre l’ennemi fasciste, l’allié républicain de circonstance, l’épurateur stalinien.
À partir du moment où la dynamique libertaire se nourrit de l’irréductible intuition que rien de bon pour le peuple n’adviendra tant que le pouvoir (politique, économique, coercitif, etc.) n’aura pas été aboli, elle s’expose irrémédiablement à une multiplicité d’ennemis mortels provenant de l’ensemble du spectre politique. En période de guerre, cette loi d’airain ne peut que porter son fer jusqu’à l’incandescence.
Une des leçons les plus cuisantes de ces Folies d’Espagne tient à l’impitoyable diagnostic que ce livre pose : si le bloc bourgeois préférera toujours Hitler au Front populaire, les circonstances pourront amener son avatar – « le bloc républicain » – à miser sur Staline pour balayer le risque de contagion anarchiste. Ainsi de l’exécutif « stalino-républicain » étouffant méthodiquement les conquêtes de la révolution libertaire et liquidant dans un même élan les militants marxistes révolutionnaires et antistaliniens du POUM. 1937 fut une terrible année de purge, en Russie comme en Espagne.
L’antifascisme, une abstraction absolue
Si l’agenda révolutionnaire classique implique, dans son moment inaugural, une lutte contre l’État et la classe des possédants, que faire lorsque le conflit armé est déclenché, non par les révolutionnaires, mais par les fascistes ? Que faire quand la révolution se déploie dans les seuls espaces libérés par la déroute étatique ? Que faire lorsque les « rebelles » sont les bruns et que les anars se voient objectivement contraints de défendre l’ordre légal défaillant ? Dès le départ, l’« anarchisme de guerre » espagnol s’est vu placé en situation révolutionnaire comme on l’est devant un fait accompli. Tout est allé vite : le 17 juillet 1936, les putschistes se soulèvent au Maroc espagnol ; deux jours après, à Barcelone et Madrid, les militaires sont défaits. En Catalogne, la CNT et la FAI engagent la mise sur pied de milices antifascistes tandis que la terre est reprise par les paysans et l’industrie collectivisée. La guerre et la révolution, la guerre ou la révolution : en cet été 1936, ce tellurique diptyque est source de passions euphorisantes, mais aussi d’inquiétants vertiges.
Freddy Gomez résume ainsi le casse-tête des acteurs de l’époque : « Cette révolution se présenta, dès le début, sous la configuration étrange d’une résistance à un coup d’État militaire antirépublicain. Autrement dit, elle n’eut pas la forme prévue par les anarchistes d’une levée en masse pour l’émancipation sociale, mais celle d’un soulèvement populaire aux motivations aussi contradictoires que pouvaient l’être, d’une part, la défense d’une légitimité démocratique mise à mal par des putschistes et, de l’autre, la croyance que l’écrasement des croisés de l’ordre nouveau n’avait de sens que si elle permettait de subvertir l’ordre démocratique ancien. »
C’est dans un texte intitulé Monologue intérieur sur une révolution empêchée encensant le livre Ascaso y Zaragoza du déjà cité Francisco Carrasquer que Freddy Gomez examine l’échec que la révolution anarchiste semble s’auto- administrer alors que les vents de l’Histoire lui sont, pour une rare fois, favorables : « Il faut en convenir : quand il était possible de lui porter le coup de grâce, l’anarchisme décida, par peur du vide et par crainte de lui-même, de perfuser la République bourgeoise agonisante. Au nom d’une abstraction absolue : l’antifascisme, cette machine à faire voler le front de classe. Ce piège, nul ne niera que la direction de la CNT se l’est tendue toute seule, car seule elle était en mesure de décider de la route à suivre. » Bien entendu, ce jugement sera plus tard nuancé par le fait que la CNT, irrégulièrement implantée sur le territoire espagnol, ne s’est peut-être pas sentie d’un poids suffisant pour continuer à jouer la partition révolutionnaire. Mais peu importe, au fond, et rien n’empêche les méninges d’imaginer a posteriori un autre scénario. Plutôt que d’envoyer quatre ministres cautionner le gouvernement de Largo Caballero et d’accepter la militarisation des milices en octobre 1936, la CNT, notamment en Catalogne, aurait pu adopter une forme de soutien critique au gouvernement de la République, mais sans s’y rallier institutionnellement. En agissant de la sorte, de manière autonome en somme, elle eût été, à ce moment-là et vu sa force combattante, en état d’exiger des armes pour ses milices et la reconnaissance de ses nombreuses collectivités agraires. Seul un positionnement de ce type aurait pu l’autoriser à mener de front la guerre et la révolution, mais surtout à éviter les compromissions, les trahisons et les saloperies à venir, du genre de celles qu’incarnèrent ces « tribunaux spéciaux de la République » où, particulièrement « efficaces en matière de geôles clandestines et d’exécutions sommaires », les mercenaires staliniens du Service d’investigation militaire (SIM), s’en donnèrent à cœur joie, sous couvert d’antifascisme, dans la répression des révolutionnaires.
Démythifier, toujours
S’il n’est pas question, dans ces Folies d’Espagne, de distribuer de bons ou de mauvais points, l’agencement de ces recensions comme une suite de chroniques permet d’éclairer, sous de multiples focales, « l’extraordinaire complexité de la révolution espagnole » et de ses suites, mais aussi de démythifier la geste romantique anarchiste, de démythifier certains de ses héros combattants (de Durruti à… Rouillan), de démythifier des lectures de l’Histoire par trop galvanisantes ou simplistes (par exemple, des élites révolutionnaires promptes à collaborer avec l’État républicain et, a contrario, une base pure et spontanée ; ou encore « cette merde programmatique du marxisme-léninisme militarisé »). Démythifier, en somme, pour faire de l’histoire à hauteur d’hommes – parce que, paradoxalement, c’est quand l’Historie s’accélère, et qu’elle place des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires, que les historiens aux ordres vont tenter de la figer en un récit souvent borgne et appauvri. Il convient alors de ne pas leur laisser la main.
Le « front antifasciste » mue interminablement. Il était là hier, il sera là demain. Le temps d’une peur commune tout à fait légitime, il agglomère les résistances – issues pourtant de camps historiquement antagonistes. Passée l’épreuve du barrage « républicain », un mélange d’hébétude et d’amertume s’empare, immanquablement, des castors les plus radicaux. L’impression que si le mal a été neutralisé, tout reste pourtant à faire. Inlassablement. Comme si, encore une fois, le coche avait été loupé. S’il est un intérêt majeur de ces Folies d’Espagne – et de la Révolution qu’elles ont servie –, c’est de nous permettre de renouer avec « la claire conscience, un temps exprimée avec force par ses combattants les plus aguerris, que fascisme et République devaient être balayés pour que tombent leurs chaînes ».
La gageure paraît d’autant plus béante que, vue depuis notre sale époque ensablée, jamais l’utopie n’a paru aussi éloignée. Raison de plus pour garder le cap. En temps de guerre comme en tant de paix – l’autre nom de la guerre sociale.
Sébastien NAVARRO
Notes
[1] Guy Hermet, La Guerre d’Espagne, Points-Histoire, 1989.
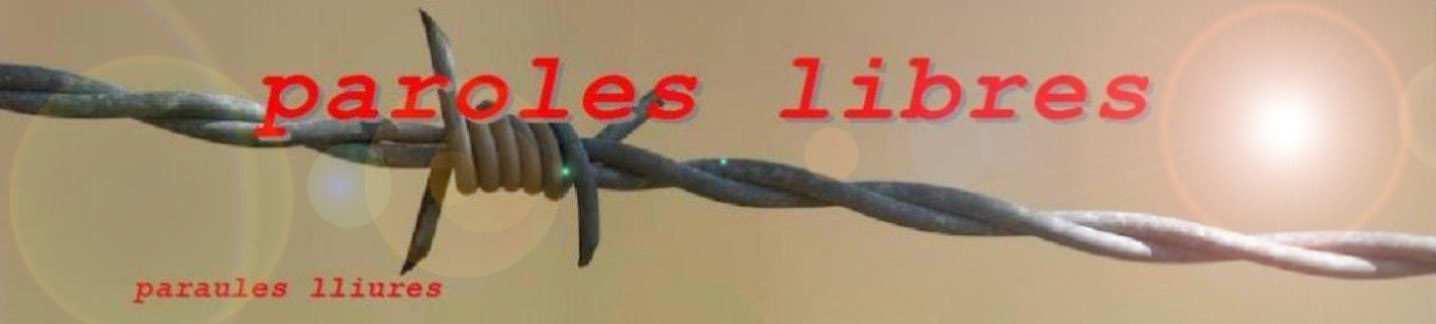
Commentaires récents