Reportage — Luttes

Des membres du collectif Cancer Colère, postés devant un hôpital parisien, appelaient à politiser la campagne Octobre rose, jugée « bisounours ». Dans leur viseur, l’agro-industrie et ses pesticides cancérogènes.
Paris, reportage
Posté devant l’hôpital, il porte une casquette bleu nuit un poil trop grande, sous laquelle poussent à nouveau de fins cheveux un temps dérobés par la chimiothérapie. Les premiers éclats d’une renaissance : « Il est en rémission d’un cancer du cerveau », sourit sa mère en attrapant le tract que lui tend une dame.
En cette matinée d’octobre, le parvis de l’Institut Curie — centre hospitalier spécialisé en cancérologie du 5e arrondissement de Paris — s’est mué en forum. Cinq bénévoles du collectif Cancer Colère apostrophent les passants, d’abord un brin fuyant face à ce qu’ils imaginent être une énième prospection publicitaire.

« La dernière fois que j’ai mis un pied ici, c’était pour fermer le cercueil d’une de mes meilleures amies », confie Julie. Extirpant de son sac à dos un pavé de dépliants à distribuer, la militante décrit la démarche de cette opération éminemment politique : « La célèbre campagne de communication Octobre rose [contre le cancer du sein] est précieuse à bien des égards, mais regorge d’angles morts. Elle multiplie les injonctions culpabilisatrices, notamment à la féminité, et met uniquement l’accent sur les comportements individuels. Pas un mot n’est consacré aux causes structurelles du cancer. Nous devons briser ce silence. »
Pesticides : la colère monte
Destiné à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la science, Octobre rose est né en 1985 aux États-Unis sous l’impulsion de l’association American Cancer Society et d’Imperial Chemical Industries, une société britannique. Cotée en bourse jusqu’à son rachat en 2008, cette entreprise aux milliards d’euros de chiffre d’affaires fabriquait certes un médicament contre cette maladie… mais surtout des produits chimiques et des insecticides.
Quatre décennies plus tard, la campagne automnale n’a rien perdu de son aspect commercial. Bien au contraire, elle est pour certaines entreprises un alibi béton pour s’assurer une image progressiste. En communiquant à gogo sur l’émoi que suscite le cancer chez elles, des marques l’utilisent comme véritable levier marketing.
Inès est l’une des bénévoles mobilisées ce jour. Une discrète ligne de maquillage permanent, esquissée sous ses sourcils, témoigne de l’épreuve affrontée ici même « il y a deux ans tout pile ». La trentenaire se remémore les intervenants venus lui dispenser des conseils pour soigner sa peau, fortement abîmée par la chimio. Une fois terminé le cours de make-up, un coffret rempli de produits cosmétiques lui avait été offert. « Pas un seul n’était bio… Seulement des marques comme L’Oréal. Et ça ne choquait personne. »
Et ce alors que les produits toxiques contenus dans les cosmétiques jouent un rôle dans l’apparition des cancers du sein.
Lire aussi : Des produits toxiques dissimulés dans les cosmétiques
La monotonie des injonctions médicamenteuses qu’elle affrontait en cette période a offert à Inès le terreau d’une colère, longtemps restée silencieuse : une obsession pour la responsabilité des pesticides et des perturbateurs endocriniens dans l’apparition de cancers.
Deux ans plus tard, le déclic lui est venu d’une vidéo. Celle dans laquelle Fleur Breteau, perchée sur un balcon de l’Assemblée nationale, hurlait aux députés de droite et d’extrême droite : « Vous êtes les alliés du cancer, et nous le ferons savoir. » La bénévole poursuit : « À ce moment-là, j’ai su que je voulais en être. »

Face à la viralité de cette séquence, intervenue le jour de l’adoption de la loi Duplomb au Parlement, Fleur Breteau est devenue le visage d’une révolte. En quelques mois, son collectif s’est structuré en une constellation d’antennes locales aux plus de 450 têtes pensantes.
Lire aussi : Des produits toxiques dissimulés dans les cosmétiques
Des malades, et ex-malades, fatigués que seuls le tabagisme et l’alcoolisme soient jugés coupables alors même que les études scientifiques montrant la corrélation entre les cancers et exposition aux pesticides se multiplient. [1] Fatigués que les lobbies et les politiques continuent de cultiver la fabrique du doute pour préserver les intérêts de l’agrochimie.
6 milliards d’euros versés par l’Assurance maladie
En 2021, près de 6 milliards d’euros ont été versés par l’Assurance maladie aux sociétés privées fabriquant des médicaments contre le cancer — et bien souvent, en parallèle, des pesticides et produits chimiques. C’est le cas de Bayer qui commercialise des substances comme le Larotrectinib — une molécule utilisée dans le traitement contre le cancer de la thyroïde par exemple — et dont la filiale Monsanto produit du Round-up, contenant du glyphosate.
« Ce coût [déboursé par l’Assurance maladie] a doublé en quatre ans et augmente de 20 % chaque année, détaille le tract que Thérèse brandit aux passants. L’épidémie explose et les laboratoires imposent des prix exorbitants pour leurs anticancéreux. »
« Les laboratoires imposent des prix exorbitants pour leurs anticancéreux »
Psychologue de profession, cette bénévole a adopté une stratégie bien à elle pour convaincre les inconnus de l’écouter… Les poursuivre, où qu’ils aillent. Tout sourire, elle détaille les combats de Cancer Colère, aborde le scandale du chlordécone et ponctue ses conversations d’un appel au soutien : « Suivez-nous sur Instagram, ce sera déjà un sacré coup de pouce. » Comme Marianne et Inès, elle aussi a eu un cancer. « Du rein, précise-t-elle sans épiloguer. Je m’en suis bien sortie. »
Épandage à l’hélicoptère
Un pin’s à l’effigie du collectif accroché au gilet, Marianne, ancienne professeure d’arts plastiques, interpelle une coquette septuagénaire prête à s’engouffrer dans l’institut. « Le cancer ? Oui, je ne le connais que trop bien malheureusement », lui rétorque cette dénommée Brigitte. Fille d’un éleveur de vaches de Bourgogne, elle énumère ses proches emportés par la maladie. Son père et son grand-père ont succombé au cancer de la prostate. Son cousin céréalier, au cancer du rectum. « Je le vois encore survoler ses champs en hélicoptère pour balancer des cochonneries. L’épandage n’avait aucune limite, regrette cette infirmière retraitée. C’était hallucinant. »
Sa sœur et elle ont aussi eu un cancer du sein. « J’avais 35 ans et venais d’accoucher de mon troisième enfant, poursuit Brigitte. J’ai dû arrêter mon travail. » Une fois achevée la mastectomie, elle a dû changer à plusieurs reprises de prothèse. Traité en 1982, son cancer la poursuit encore aujourd’hui.
« Le plus difficile, c’est cet inconnu, abonde Inès. Mon oncologue m’a prévenu que les risques de récidives demeureraient toute ma vie. Comment avancer paisiblement en sachant que cette épée de Damoclès plane au-dessus de votre tête ? »

À ses yeux, la campagne Octobre rose revêt en ce sens un aspect « bisounours » : « Le cancer du sein est évoqué comme un petit cancer. Non, c’est le cancer le plus meurtrier chez les femmes. » Et lorsqu’il ne tue pas, il pousse parfois les victimes au divorce, au licenciement ou à l’abandon de projets. Débarrassée depuis deux ans de la tumeur, la militante est toujours sous traitement. Des piqûres et des comprimés annihilant ses hormones, jusqu’à placer son corps en ménopause. « Résultat : j’ai dû renoncer pour l’heure à avoir un enfant », déplore-t-elle.
Un « tsunami » de cancers
« Personne ne se sent vraiment concerné par le cancer, avant d’avoir rendez-vous chez l’oncologue, poursuit Inès. Lorsque le mien m’a été diagnostiqué, un immeuble m’est tombé sur la tête. Pour moi, ça n’arrivait qu’aux autres. »
Dans une enquête publiée en mars, Le Monde dévoilait que le nombre de nouveaux cas de cancers chez les moins de 50 ans avait bondi de près de 80 % en moins de trente ans. Les tumeurs digestives et du sein sont les plus concernées par ce que certains chercheurs qualifient déjà d’« épidémie ». Un mois plus tôt, le Pr Fabrice Barlesi, directeur général de l’Institut Gustave Roussy, appelait même à se préparer à « un tsunami » de cancers chez les jeunes. « Ce n’est plus juste la faute à pas de chance », dit Marianne.

La bouille débordante d’entrain, Candice contorsionne sa poupée sous l’œil amusé d’un taxi. Il y a un an, un rétinoblastome — tumeur cancéreuse intraoculaire — a été diagnostiqué à la fillette qui soufflera en janvier sa deuxième bougie. « J’ai aperçu un reflet blanchâtre dans sa pupille, témoigne Ingrid, sa mère. Le même que l’on observe chez les chats la nuit. » Dès le lendemain, un pédiatre l’invitait à sauter dans un avion en direction de Paris pour procéder aux analyses. « Nous avons multiplié les allers-retours entre ici et La Réunion le temps du traitement. Et par bonheur, son œil a pu être sauvé. »
Enfouissant le tract de Cancer Colère dans une pochette de la poussette, Ingrid salue les bénévoles et disparaît. Comme pour bien des passants croisés ce jour-là, la polémique entourant la loi Duplomb et le rôle des pesticides dans l’émergence de cancers ne lui étaient guère familiers.
« À force de sensibilisation, ces sujets seront incorporés dans le débat public », espère Thérèse. À la nuit tombée, une autre équipe du collectif s’en ira d’ailleurs placarder les murs de la ville d’affiches appelant à briser le silence.
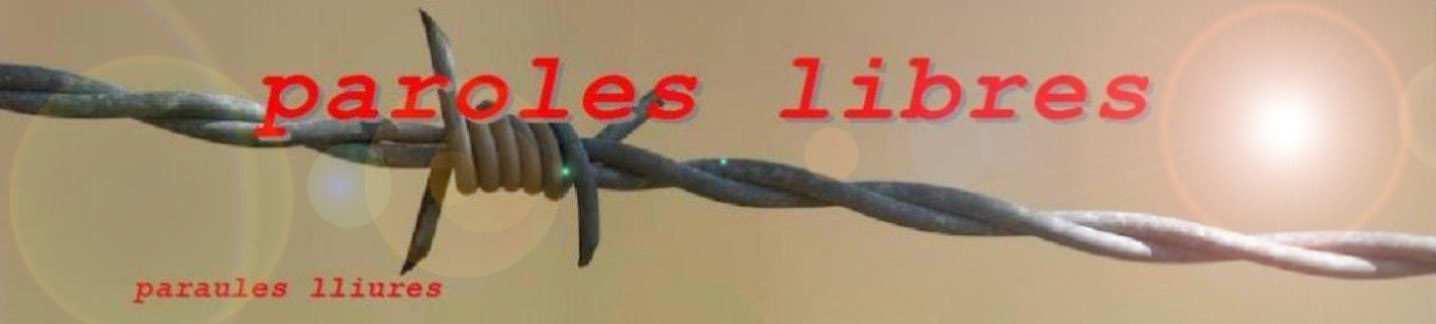
Commentaires récents