Pédagogie Éducation

Après huit ans d’existence, le seul master de France formant au journalisme sur le changement climatique est sur la sellette. Ses responsables, qui se disent éreintés, sonnent l’alerte pour préserver cette formation.
Une situation complètement à rebours de l’urgence. À l’heure où le traitement du changement climatique est d’une importance fondamentale dans les médias, le seul master de France dédié à la formation des journalistes et des communicants sur ce sujet est menacé.
L’alerte a été donnée par Gilles Ramstein, directeur de recherches au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, paléoclimatologue et responsable scientifique du master 2 climat et médias, lors de son passage dans l’émission « La Terre au carré » sur France Inter, lundi 10 mars.
Dispensé par l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) et l’École supérieure de journalisme de Lille (ESJ), ce master 2 fournit aux journalistes et aux communicants des bases scientifiques pour comprendre le changement climatique et mieux l’intégrer dans leur traitement de l’information, le tout à distance via des cours en ligne.
Créée en 2017, cette formation est née du constat de la faible collaboration entre journalistes et scientifiques pour expliquer au grand public et aux décideurs la crise climatique en cours et ses conséquences dans tous les domaines de la vie. L’évolution du climat de la terre depuis sa formation, l’effet du changement climatique sur le vivant, le droit, la justice, les politiques d’adaptation… Chaque chapitre est élaboré en commun par un scientifique et par un journaliste, tous deux spécialistes du sujet.
« On a l’impression que la présidence de l’université veut nous épuiser »
« Ça fait plus de deux ans que l’on demande à l’université de Versailles Saint-Quentin de renouveler la convention de partenariat, un document obligatoire lorsque l’on travaille avec des journalistes enseignants. Mais nous n’avons obtenu aucune réponse malgré nos relances », dit Bruno Lansard, enseignant-chercheur en sciences de l’environnement marin et responsable académique du master. Si la direction de l’université refuse de signer cette convention, « c’est parce qu’elle estime que le master coûte trop cher », selon lui.
Sauf que le master est excédentaire : « Il génère 88 000 euros grâce aux frais d’inscription et il fonctionne avec un peu moins de la moitié de ce montant, le reste étant réservé au budget de l’université. » Mais ce n’est pas suffisant : « Il nous manque 15 000 euros pour travailler correctement, le changement climatique est une matière qui doit être sans cesse actualisée et les cours doivent être régulièrement mis à jour, sinon ils deviennent obsolètes », précise Gilles Ramstein.
Pour pallier ce manque d’argent, les encadrants multiplient les appels à projet mais « chaque année, ça demande beaucoup de temps et d’énergie à côté de nos activités de recherche, on a l’impression que la présidence de l’université veut nous épuiser pour que l’on jette l’éponge et que le master s’arrête », déplorent Gilles Ramstein et Bruno Lansard. Tous les deux se disent éreintés par cette charge de travail supplémentaire.
Une formation de plus en plus demandée
Pourtant, le succès de la formation n’est plus à démontrer. De moins de dix étudiants dans la première promotion en 2017, le master en compte aujourd’hui quarante-six, treize en formation initiale et trente-trois en formation continue. « Année après année, il y a toujours plus de candidatures, l’an dernier nous en avons reçues 120 », dit Bruno Lansard. En tout, 153 personnes ont été diplômées depuis 2017.
Parmi les étudiants, la plupart sont des journalistes en poste ou à la pige dans des rédactions nationales ou locales de presse écrite ou audiovisuelle. De nombreux journalistes spécialisés dans les questions environnementales sont passés par ce master : Anne Le Gall qui présente chaque jour le billet sciences sur Franceinfo, Thomas Baïetto, journaliste pour les JT de France 2, Élise Menand d’« Envoyé Spécial », etc. Plusieurs journalistes de Reporterre, ou ayant écrit pour Reporterre — parmi lesquels l’autrice de ces lignes — ont d’ailleurs suivi ce master.
La formation s’adresse aussi à des journalistes francophones d’autres pays que la France grâce à un partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie. Haïti, la République démocratique du Congo, le Québec, l’Algérie, le Bénin… Des étudiants issus de trente pays ont ainsi été formés. « Pour nous, il était important d’inclure des journalistes habitant dans des pays plus vulnérables, où les gens sont touchés au quotidien par les conséquences du dérèglement climatique », dit Bruno Lansard.
Pour l’université, « des ajustements nécessaires d’ici la rentrée »
Contactée, la présidence de l’UVSQ indique que « la nouvelle présidence a pris connaissance des difficultés administratives rencontrées depuis plusieurs années dans le cadre de la convention actuelle. Celles-ci sont en cours d’examen attentif par nos services, afin que des solutions soient apportées, dans un esprit de coopération et avec la volonté commune d’assurer la pérennité de cette formation ».
La direction ajoute qu’elle est « pleinement mobilisée pour que cette formation puisse se poursuivre dans le respect de ses ambitions académiques, tout en travaillant à des ajustements nécessaires d’ici la rentrée universitaire 2025 ». Sans préciser lesquels.
https://reporterre.net/La-seule-formation-francaise-au-journalisme-vert-est-en-peril
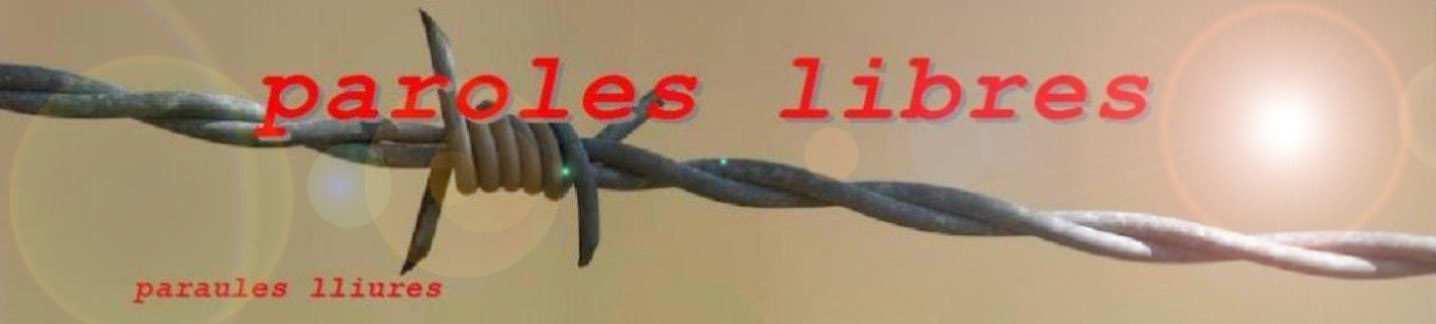
Commentaires récents