CA 348 mars 2025

mardi 11 mars 2025, par Courant Alternatif
A la demande des intéressé·es, le nom du village n’est pas mentionné et les prénoms ont été changés car certain·es habitant·es craignent de se retrouver sous le feu des projecteurs, ou de se voir coller une étiquette en fonction de l’orientation du média. Le communalisme réel dans un village procède d’un processus certes enthousiasmant, mais demeure encore fragile eu égard à son caractère novateur. Il est impératif de respecter les rythmes des habitant·es et surtout les choix de diffusion de leur expérience.
Il existe dans la Meuse un petit village de 190 habitant·es qui pratique depuis 2020 la démocratie directe. C’est à priori un village tout à fait normal, plutôt ouvrier, où l’électorat est, de façon classique pour cette région, très majoritairement pour le RN. Rien ne le destinait donc particulièrement à cette expérience démocratique originale que nous allons vous présenter.
Eugène est maire de ce village sur la base de ce que nous appellerions dans nos milieux « municipalisme libertaire » mais que les habitant·es nomment : « démocratie directe par l’Assemblée citoyenne ». Ni Eugène ni le conseil municipal ne prennent de décisions importantes, tout est décidé par assemblées citoyennes du village depuis 4 ans 1/2. C’est le seul village en France à fonctionner de la sorte. Nous avons voulu en savoir plus sur cette expérience et avons discuté à plusieurs reprises avec Eugène et Louise, habitant·es de ce village autogéré. Dans cet article, nous ne posons pas de discussion politique critique, nous rendons juste compte de ce qu’il et elle nous ont expliqué.
Eugène et Louise ne sont pas pour rien dans la genèse de cette expérience. Ces deux militant·es se sont rencontré·es il y a un peu plus de 20 ans, lui venait des courants écologiques, elle des courants trotskystes. Leur parcours les a amenés à vouloir rompre avec l’entre soi militant et à se retrouver dans le municipalisme libertaire de M. Bookchin.
Eugène a déjà été maire de sa commune de 2001 à 2008, mais avec un mandat classique de maire. Il avait essayé, comme tous les maires un peu progressistes, des réunions publiques où chacun et chacune pouvaient donner leur avis mais les gens ne venaient pas. Il était alors ressorti insatisfait de ce mandat de maire. Il y a une dizaine d’année, le livre de Janet Bielh « le municipalisme libertaire », a changé sa vie notamment au travers de sa préface d’Annick Stevens. Cet ouvrage répond concrètement au problème qu’il se pose depuis toujours par la voie pratico-pratique et audacieuse qu’il pose. Eugène adhère à l’idée que la population peut reprendre le pouvoir par les assemblés à la base. Ce n’est pas une idée nouvelle (le Chiapas, le Rojava, les soviets, la commune de Paris…) mais pour lui, cela répond concrètement à comment on peut le faire dans la société actuelle. L’idée de participer aux élections municipales, avec un programme de démocratie directe, lui est apparue évidente.
Dans leur recherche de dépasser l’entre soi militant, Louise et Eugène avaient commencé par créer avec d’autres une association autogérée à Commercy dans un lieu où tout le monde pouvait venir et où l’on parlait de tout, pour y faire à la fois des choses festives et des choses plus politiques. L’idée était déjà dans certaines têtes de lancer les bases de la conquête de la ville par l’Assemblée des citoyens. C’est alors que sont arrivés les Gilets jaunes. Eugène s’est engagé dans le mouvement des Gilets jaunes avec beaucoup de bonheur. Il a déchiré immédiatement toutes ses cartes politiques et syndicales. Il ne voulait plus faire partie d’un groupe militant d’aucune sorte.
Et ce n’est pas un hasard si c’est à Commercy qu’a été lancée la frange assembléiste des Gilets Jaunes pour essayer de structurer le mouvement : le débouché politique du mouvement devait être la prise du pouvoir par la base sans réclamer ou quémander des avancées sociales ou des mesures au plus haut niveau de l’État. L’une des stratégies envisagées était la prise des municipalités. S’est construite alors La commune des communes, qui était un collectif à la suite des Assemblées des assemblées du mouvement des GJ, pour proposer aux gens de prendre le pouvoir dans leurs municipalités et de les faire tourner en démocratie directe. Il y a eu ainsi pas mal de listes qui se sont présentées aux élections municipales, quelques-unes en démocratie directe, la plupart en démocratie participative. Toutes les listes en démocratie directe ont été battues, y compris à Commercy où elle n’a fait que 10%.
Eugène n’habite pas Commercy mais un petit village situé non loin de là. Dans ce village, le maire ne voulait pas se représenter et il est venu demander à Eugène s’il voulait reprendre du service. Eugène a sauté sur l’aubaine et il a trouvé une dizaine de colistier·es (il fallait une liste de 11 personnes) à qui il a proposé une charte : une assemblée décidera et prendra toutes les grandes décisions du village et les élu·es de la liste s’engagent à exécuter ces décisions. Tou·tes étaient d’accord sur le principe. Ces colistier·es n’étaient pas militant·es mais des personnes investies dans le village, ou désireuses de s’investir, et l’idée d’Eugène a été acceptée par simple bon sens. Les habitant·es du village avaient des opinions partagées sur ce fonctionnement proposé avant les élections. La plupart des personnes étaient dubitatives. Comme il n’y avait pas d’autres listes, la liste a été élue. Pour Eugène, s’il y avait eu une autre liste, leur liste n’aurait pas été élue car l’idée paraissait trop farfelue.
Suite aux élections, une première assemblée citoyenne a été convoquée. 35 personnes sont venues, ce qui était un vrai succès. Il y en avait 42 à la suivante, 45 à la troisième. Il y a eu jusqu’à 80 personnes ce qui signifie que les gens se sont très vite appropriés l’idée de l’Assemblée comme quelque chose de tout à fait naturel.

A la fin de chaque assemblée, sont désignées trois personnes qui vont organiser la suivante. Ces trois personnes sont chargées d’une part de recueillir les propositions de la boîte à idées que peuvent utiliser tou·tes les habitant·es. Il y a aussi évidemment les projets qui sont en cours et pour lesquels Eugène et les conseiller·es municipaux sont à même d’informer les trois personnes organisatrices et un certain nombre de grands sujets. A titre d’exemple, le prochain sujet concernera l’aménagement de la place du village. Les trois personnes décident de la date et font un ordre du jour. Elles convoquent les gens à l’Assemblée où l’ordre du jour peut être modifié. La convocation est envoyée par mail, SMS, courrier et par Telegram (un groupe Telegram a en effet été créé où sont maintenant la plupart des gens, soit 94 personnes). Sur décision de l’Assemblée elle-même, les procurations sont interdites. Pour Eugène et Louise, les gens ont vraiment compris que les procurations suppriment complètement la vertu des débats de l’Assemblée (et qu’en assistant aux débats, on peut changer d’avis). Par contre ce qui est autorisé et pratiqué, c’est la visio. Les gens l’utilisent uniquement quand ils ou elles ne peuvent pas venir physiquement. Si une personne de l’Assemblée demande le vote à bulletin secret, il est accordé. A donc été mise en place une procédure de vote secret par Telegram.
Il n’y a pas de fréquence préétablie, c’est en fonction des sujets. Entre 3 et 8 par an. Les assemblées durent toujours 2 heures ce qui est précieux pour favoriser la participation. Après, il y a un apéro et quelquefois une bouffe collective. Les assemblées ont lieu dans une salle municipale qui est une ancienne auberge, donc il y a tout : bar, tireuse à bière, chambre froide, … En moyenne, c’est une quarantaine de personnes présentes, représentatives de la population du village en âge et genre. Au début, peu de gens prenaient la parole alors que maintenant, tout le monde ose la prendre, notamment les femmes. Il y a un·e président·e, un·e modérateur/modératrice (qui n’a jamais eu à intervenir) et un·e secrétaire.
Pour Eugène et Louise, cela fonctionne formidablement car il n’y a pas eu de théorie en amont. L’Assemblée aborde les sujets importants pour le village qui concernent directement la vie de tout le monde. Il y a un fort intérêt pour ces sujets-là et qui veut venir voter vient. Les personnes savent que c’est là que ça se décide et que ce sont elles qui décident. Petit à petit, ceux et celles qui ne venaient pas trop au début se sont mis·es à venir parce que chacun·e sait qu’être absent·e signifie ne pas pouvoir participer à la décision. Cependant, les décisions de gestion courante sont gérées par le conseil municipal (comme acheter un nouveau photocopieur), l’Assemblée ne décidant que des sujets importants pour ne pas alourdir les débats.
Les sujets abordés ont été par exemple : la sécurité routière dans le village, la création d’un terrain multisports et des projets d’énergie renouvelable (une éolienne citoyenne et un projet d’autoconsommation collective solaire avec stockage). Les sujets sont pris en charge et présentés, soit par le maire et les conseiller·es, soit par celles et ceux qui ont un point de vue, au volontariat. Beaucoup de compétences particulières sont rassemblées et trouvent automatiquement leur utilité pour éclairer les discussions et faire des propositions.
Sur la sécurité routière par exemple, il s’est formé naturellement un petit groupe de gens : un ouvrier qui fait le marquage au sol pour les routes, un camionneur, un paysan, un chauffeur de bus, une parente d’élève. Le projet a été proposé à l’Assemblée citoyenne suivante avec toutes sortes de modifications : 30 à l’heure, des passages cloutés, des stops. Il y avait deux « céder le passage » proposés pour la grande rue pour faire ralentir les voitures qui roulent trop vite. Le travail d’Eugène était de soumettre ce projet à la validation de la DDT. La DDT n’a pas tout validé : il fallait mettre des stops à la place des « céder le passage » à cause de la visibilité. Eugène a donc commandé deux stops, et puis quand les stops sont arrivés, les gens ont dit « mais c’est quoi ça ? ». Il a expliqué les raisons mais les réactions ont été : « oui mais ça, ça n’a pas été validé par l’Assemblée citoyenne. Les stops ce n’est pas pareil. Les voitures s’arrêtent et ça fait du bruit ». Il a fallu reconvoquer une nouvelle assemblée. Eugène estime alors : « J’avais fait mon petit potentat local, comme tout bon maire qui se comporte avec la connaissance du dossier. Je suis le sachant, les autorités m’ont dit comment il fallait faire, donc je fais comme ça. Et bah il a fallu que l’Assemblée valide, et ils ont eu mille fois raison. Ils m’ont botté le cul ». L’Assemblée s’est réunie à nouveau et a validé les stops.
Un autre sujet débattu a été la question de la mise en place de caméras de surveillance dans le village sur proposition d’une habitante suite à des tentatives de cambriolage. Eugène et Louise étaient persuadés que cela serait accepté, le village votant majoritairement RN. L’Assemblée s’est réunie. Après les discussions, il n’y a eu que 5 voix pour les caméras sur les 45 personnes présentes. La première rafale d’arguments a porté sur le rapport efficacité/prix. Les gendarmes eux-mêmes avaient dit qu’il y avait peu de cas élucidés avec les caméras, vu que les voleurs/voleuses mettent des cagoules et qu’ils/elles changent leur plaque d’immatriculation. Cela a déjà refroidi les gens. La deuxième rafale d’arguments portait sur qui voit les films des caméras : le maire, une personne désignée du village et la gendarmerie. Une personne a dit « si je rentre avec mon amant à deux heures du matin, je n’ai pas envie que le maire le sache ». Ça a fait rire tout le monde. Les arguments contre se sont alors enchaînés : « Pendant le Covid, quand on allait faire les apéros chez les autres, s’il y avait eu des caméras, tu te rends compte ». Le projet a été rejeté par l’écrasante majorité de la population. Pour Eugène et Louise, si cela s’était produit dans un conseil municipal classique, ce dernier aurait probablement voté pour les caméras en prêtant à la population le fait qu’elle veut des caméras.
Un autre exemple sur une subvention. Eugène a un passé militant que tout le monde connaît dans le village contre le centre d’enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Pour l’achat du restaurant [voir après], la commune pouvait avoir une subvention via l’Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui achète les communes proches de Bure en les arrosant de pognon. Eugène était bien évidemment contre mais il a, par honnêteté, soumis la question à l’Assemblée citoyenne. La grande majorité a décidé de demander la subvention et il a fallu que Eugène fasse cette demande… ce qui fait visiblement encore rire tout le monde.
Quant au budget de la commune, celui-ci n’est pas discuté dans les assemblées. Dans leur village, ils décident au coup par coup. Ainsi, le conseil municipal regarde ce qui a été dépensé, ce qui a été gagné et la trésorerie. Les gens sont informés de tout cela. Le budget est au service des décisions qui sont prises au cours de l’année sans figer les choses. Au niveau comptable, le conseil municipal modifie ensuite le budget si cela est nécessaire. Cela peut sembler surprenant mais pour Eugène, il y a un fétichisme du budget alimenté par une illusion collective. C’est pour lui un artefact qui cherche à figer les choses.
Aujourd’hui, le village a un alambic municipal (seul village de France), un verger communal avec 35 arbres (pommes, poires, cerises, mirabelles) et un pressoir que les gens peuvent utiliser gratuitement. Il y a un projet d’une éolienne géante qui appartiendrait en propre à la commune, et non pas un développeur privé, ce qui serait une première en France. Le permis de construire est déposé. L’éolienne donnera du courant pour 3000 ou 4000 foyers. Elle appartiendra à la commune qui revendra l’électricité pour en faire profiter les habitant·es. Et en projet également, un système de stockage gravitationnel par micro-step est envisagé, c’est-à-dire un système d’autonomie solaire collective auquel est adjoint un système de stockage pour avoir de l’électricité aussi la nuit : il y aura deux bassins, un bassin en bas du village, un bassin 100 mètres plus haut. Avec l’électricité produite en journée, l’eau du bassin du bas sera pompée, et la nuit, le bassin du haut va faire tourner une turbine qui restituera l’électricité stockée. Là encore, c’est complètement unique en France. Tou·tes les habitant·es pourront avoir de l’électricité, meilleur marché car achetée à la commune au lieu d’être achetée à EDF. Et le prix de l’électricité ne variera pas pendant 20 à 25 ans, donc sans être soumis aux fluctuations du marché.
Aucun de ces projets, plutôt ambitieux, n’aurait pu être envisagé sans l’Assemblée citoyenne selon Louise et Eugène, car l’adhésion et le soutien de la majorité des habitant·es n’auraient jamais pu être vérifiés de façon claire et le conseil municipal n’aurait donc pas osé.
Mais le sujet qui a provoqué le plus de passions, ce fut visiblement l’achat d’un restaurant pour qu’il ne disparaisse pas. Ça a fait venir deux fois 80 personnes, en un mois d’intervalle pour décider.
Le seul restaurant du village était mis en vente, mais ne trouvant pas preneur, il allait fermer et il n’y aurait plus de restaurant ni de chambres d’hôtes dans la commune. L’idée a germé que ce soit la commune qui achète. Cela a été très débattu et contesté car les anciennes familles du village, plutôt des agriculteurs/agricultrices conventionnel·les et les entrepreneurs/entrepreneuses, ont fait un front instinctif : un restaurant devait faire du profit, il fallait que ce soit rentable, la commune n’avait pas à se mêler de ces choses-là, les travaux seraient à la charge de la commune et le budget de la municipalité s’en trouverait grevé. Certains ont avancé que municipaliser une entreprise, c’était comme du « communisme ». Il s’agissait en fait d’une opposition politique instinctive pas du tout majoritaire comme la suite allait le montrer. L’autorité de ce groupe, pourtant minoritaire, a pu sembler prégnante lors de la première assemblée. Et beaucoup de petites gens se sont dits « écrasé·es », tétanisé·es par ces arguments apparemment de bon sens.
Mais la magie de l’Assemblée des citoyen·nes c’est qu’elle dilue le pouvoir de ceux et celles qui sont le plus habitué·es à l’exercer et qu’elle permet de libérer la réflexion. Tout d’abord, comme l’ont fait justement remarquer les opposant·es à l’achat lors de la première assemblée ou 75 personnes étaient présentes, le dossier avait des failles. Il manquait les devis des entreprises pour les travaux, des estimations contradictoires pour la valeur du bien, etc. Il a été alors décidé à une large majorité de surseoir à la décision. A la deuxième assemblée qui a eu lieu un mois plus tard, il y avait 80 personnes. C’était le sujet qui enflammait tout le monde. Les opposant·es à l’achat ont alors été largement minoritaires par un vote à bulletin secret. Des femmes, en particulier, qui s’étaient senties écrasées à la première séance, ont beaucoup parlé à cette seconde assemblée et influé sur la décision finale. Le résultat a été sans appel : 65 pour, 12 contre et le reste en abstention.
C’est une majorité de petites gens qui ont fait jouer la solidarité car le couple qui devait reprendre le restaurant est très investi dans le village et ce sont des gens modestes. Il y a eu une sorte de solidarité instinctive qui s’est jouée envers eux. Beaucoup ont dit : « c’est les gros contre les petits ». C’était un peu caricatural certes mais il y avait quand même ce sentiment. Les opposant·es à la municipalisation du resto ont fait le plein de leurs voix mais ils et elles n’ont pas réussi, comme le font habituellement les dominant·es dans la société, à entraîner les autres parce que leur pouvoir dans une assemblée est complètement dilué. Pour Louise, cette assemblée a permis de franchir un pas. Elle a eu lieu trois ans après les élections, c’est-à-dire avec trois ans d’expérience, d’apprentissage de discussions. Beaucoup de personnes se sont appropriées plein de choses et elles ont aussi compris l’intérêt du bien commun.
A la suite de cet achat de restaurant, quelques minoritaires ont malheureusement décidé de ne plus participer aux assemblées. D’autres sont revenu·es et ont encore dû s’incliner sur un sujet similaire. En effet, il y avait des bâtiments agricoles qui étaient en vente. L’idée de faire acheter ces bâtiments-là par la commune a germé afin de les louer à des gens du cirque pour leur petits travaux d’hiver, ce qui arrangeait les circassiens. Ces habitant·es se sont opposé·es pour les mêmes raisons que pour le restaurant : ce n’est pas à une commune de gérer cela ni de posséder autant de biens. Mais l’Assemblée en a décidé autrement. Et pour la deuxième fois, le choix de la communalisation de biens a été effectué par une large majorité d’habitant·es.
Quid de la légalité des décisions prises par l’Assemblée citoyenne ? Il n’y en a pas vu que chaque décision de l’Assemblée est validée par une délibération du conseil municipal. Délibération qui est elle-même systématiquement validée par le contrôle de légalité de l’autorité préfectorale. Comme toute décision de tout conseil municipal, celles du village autogéré peuvent naturellement être attaquées en justice. Mais cela ne viendrait à l’esprit de personne. En effet, d’une part, rien de ce qui est décidé ne l’est à la légère et l’intelligence collective se montre très sage et très précautionneuse. Et d’autre part, ce serait psychologiquement très compliqué pour des minoritaires de contester juridiquement une décision prise par la majorité de la population. Cela reviendrait à se mettre à dos voisin·es et ami·es et pas seulement un maire ou quelques conseiller·es.

Aujourd’hui, nombre d’habitant·es apparaissent très fier·es de leur Assemblée citoyenne. Il n’y a pas de crispation dans le village en dehors des quelques personnes qui regrettent le fonctionnement autoritaire de l’ancien conseil municipal car cela leur donnait l’illusion d’être dépositaire du bon sens commun. Il y a aussi des gens qui sont indifférent·es mais c’est vraiment une minorité : sur 120 électeurs/électrices qui pourraient participer, il y en a 107 qui ont participé au moins une fois à une assemblée. Il y aura toujours quelques personnes hostiles à l’Assemblée, mais la plupart d’entre elles viennent quand même parce que des sujets leur tiennent à cœur. Il y a un noyau dur d’une trentaine de personnes qui sont vraiment mordues, capables de défendre l’Assemblée à l’extérieur du village. Les autres viennent épisodiquement.
L’ambiance du village s’est trouvée considérablement améliorée par l’Assemblée. Des gens qui ne se parlaient plus se sont de nouveau retrouvé·es dans cette enceinte et ont été amené·es à se revoir, à échanger. Toutes les tensions n’ont pas disparu, mais elles se sont estompées. Il y a une dynamique pour faire des choses ensemble qui n’existait pas avant. Des gens ont appris à se connaître tout simplement, parce qu’à l’Assemblée on ne s’insulte pas, on ne se crie pas dessus. Par exemple, il y avait une crispation séculaire entre les chasseurs/chasseuses et les randonneurs/randonneuses. Aujourd’hui ils et elles arrivent à se parler parce qu’ils et elles ont un cadre pour discuter. Les chasseurs/chasseuses ont d’ailleurs participé à dessiner et à creuser les chemins de randonnée. Louise concède « moi-même, je ne me voyais pas avoir de la sympathie pour les chasseurs. J’en ai maintenant. Les chasseurs nous amènent des sangliers pour nos repas conviviaux. ».
La commune a maintenant un terrain de pétanque et un barbecue à côté du terrain pour les enfants (terrain multisport choisi par l’Assemblée). Cela rapproche les générations et à plusieurs reprises, des moments communaux ont été organisés toute génération confondue. Pour illustrer la dynamique du village, l’année dernière l’association du village a lancé une fête celtique. Il y a eu 55 bénévoles du village pour un village de 180 habitants. Tout le monde reconnaît que l’Assemblée apporte une ambiance différente au village.
Aux élections, le RN a fait 40% aux présidentielles et 60% aux européennes. Comment comprendre que le fonctionnement actuel n’ait pas d’impact au niveau électoral ? Pour Eugène et Louise, il semble que les gens ne fassent pas le lien entre ce qui est fait localement et ce qui se passe au niveau national. La seule chose que permet l’Assemblée, c’est de créer une confiance au sein du village et de pouvoir discuter. Eugène et Louise peuvent ainsi discuter librement de leurs idées politiques écologiques, anticapitalistes, … Et inversement, Eugène et Louise peuvent saisir pourquoi bien des gens sont amené·es à voter RN.
Eugène et Louise expliquent : c’est plutôt une population ouvrière, modeste, ayant peur de l’avenir et en insécurité économique. Le monde autour ne change pas parce qu’il y a une Assemblée. C’est le village qui change mais les gens sont toujours, au niveau national, sous l’emprise des médias. Les médias hurlent que l’on est en insécurité, que c’est en constante augmentation, que c’est la jungle. Les gens de ce village autogéré voient comme les autres les banlieues qui flambent, les petites grands-mères qui se font arracher leurs sacs, les professeurs qui se font poignarder par les terroristes, les moindres faits divers comme une petite fille qui se fait violer. Le pays est à feu et à sang pour les habitant·e et ce sont majoritairement les immigré·es qui sont pointé·es du doigt par les médias dominants : donc « vite le RN ! ». C’est le bain médiatique dans lequel on évolue qui pousse à cela. Logiquement, ils et elles votent RN aussi car les trahisons ont été si énormes pendant si longtemps que cela est profondément ancré. Pour la majorité des gens, le RN est antisystème et on ne l’a pas essayé. Le discours du RN apparaît très fraternel : les gens doivent s’entraider au niveau français. Si on n’est pas armé politiquement pour comprendre d’où vient le RN et ce qu’il veut réellement, il fait parfaitement illusion.
L’Assemblée ne peut pas en 4 ans inverser de telles choses. Eugène et Louise précisent « Il faut être humble dans une assemblée citoyenne et ne pas croire détenir la vérité universelle et prétendre donner des leçons. Il s’agit d’un échange entre citoyen·nes, d’égal à égal, où chacun·e défend son point de vue dans le respect et la bienveillance ». C’est pour Louise et Eugène le seul moyen de faire bouger les lignes.
La question se pose d’une extension de cette expérience. Pour Eugène et Louise, leur expérience est juste un micro-laboratoire. La seule preuve qui est faite c’est que les citoyen·nes sont suffisamment matures pour s’autogérer. D’ailleurs, dans des villages aux alentours, des personnes commencent à envisager des listes municipales sur le même cadre. Mais Eugène et Louise savent que ce sera compliqué. S’il y a deux listes, la liste « démocratie directe » se fera certainement battre car c’est trop lunaire pour les gens. Par contre, Eugène est persuadé que dans son village, la liste pour la démocratie directe gagnerait même face à une autre liste car, par l’expérience, ce fonctionnement de démocratie directe est rentré dans l’esprit des gens.
Il y a eu à Saillans avant 2020 une expérience proche. Une liste qui s’était constituée autour d’un projet inutile. Cette liste donnait la parole à la population. Cela a été médiatisé dans le milieu militant. Cette liste a été battue à l’élection suivante. Il semble que plusieurs facteurs aient provoqué cette défaite, d’après ce que Eugène a pu collecter comme information : La première raison c’est que les gens se sont lassé·es à cause du nombre de réunions. Les porteurs/porteuses de la liste voulaient que les personnes se saisissent de tous les sujets et deviennent expertes en tout. Or, la gestion des dossiers administratifs est chronophage et rébarbative. Dans son village, c’est Eugène qui gère l’administratif car il est habitué à le de faire de par son métier. L’Assemblée ne fait que décider sans devoir tout gérer ensuite… ce qui pour Louise n’est pas sans poser des questions sur le pouvoir que peuvent avoir des expert·es. La seconde raison, toujours selon Eugène, c’est que c’était coloré politiquement. C’étaient des écolos et les projets devaient donc avoir cette orientation. Pour Eugène, c’est la limite des groupes organisés : « On veut bien faire de la démocratie directe à condition qu’il y ait des garde-fous. Chez nous, il n’y a pas de garde-fous et nos idées, on les défend dans l’Assemblée avec l’espoir qu’elles soient majoritaires mais en acceptant à l’avance la possibilité de perdre… ou de changer d’avis ».
Quid de l’extension de ce modèle et de l’avenir ? Pour Eugène, l’expérience est largement reproductible. Tout d’abord il y a en France près de 20 000 communes de moins de 500 habitant·es. Ensuite ; dans des villes moyennes ou assez importantes, il pourrait y avoir une division en quartiers vraiment autonomes, chaque quartier devenant comme un village, et la ville devenant comme une communauté de communes. Une communauté de communes peut très bien s’accommoder d’assemblées citoyennes avec un va et vient entre les assemblées de base et l’assemblée de la communauté de communes pour des projets importants. Au-delà, dans un village ou dans un quartier, il y a énormément de sujets qui sont hautement politiques et qui peuvent être décidés à la base : l’autonomie énergétique, l’autonomie alimentaire, la voirie, le logement, le cadre de vie, les équipements sportifs, … Pour Eugène cela laisse tout un immense champ de possibilité à la démocratie de proximité pour qu’elle s’exerce vraiment et pas seulement sur des sous-sujets. Bien évidemment, si cela s’étend, et si les communes autogérées viennent à se fédérer, on pourrait craindre qu’un jour il y ait un blocage au niveau étatique pour certaines décisions. Pour Eugène toujours, ces refus seront beaucoup plus difficiles à admettre par la population si c’est elle qui a co-construit les projets. Il y aurait alors une prise de conscience que le système nous empêche de mettre en place des mesures de bon sens, qu’elles soient économiques, écologiques ou sociales. Cela pourrait être un facteur facilitant la construction d’un rapport de force en cas de besoin.
Pour lui, si on réussit à créer du lien, à montrer aux gens qu’ils sont capables de penser, de réfléchir, de décider par eux-mêmes, si on réussit à populariser cette idée-là, donner envie, on jette des bases. “Dans notre village, d’eux-mêmes les gens disent que c’est comme ça que ça devrait fonctionner partout ailleurs, au niveau local comme à l’Assemblée nationale. Même pas besoin de professer une quelconque théorie ou un quelconque but final. Ça procède directement de l’expérience collective. Les gens y viennent naturellement. La municipalisation de bâtiments, l’éolienne communale, l’autonomie énergétique, … tout ça vient de l’Assemblée, de la volonté des gens. Ça vient de leur expérience et ce sont des aspirations humaines naturelles. L’Assemblée a juste offert le cadre pour que se révèlent ces aspirations”. Une personne a dit il n’y a pas longtemps à Eugène : « Ah, je t’aime mieux maintenant que tu fais plus de politique comme avant. ». Eugène lui a répondu qu’il continuait à faire de la politique, « oui, mais ce n’est pas pareil, tu fais de la politique locale, tu t’occupes de ton village. J’aime bien en faire avec toi de la politique comme ça ».
RV et Muriel
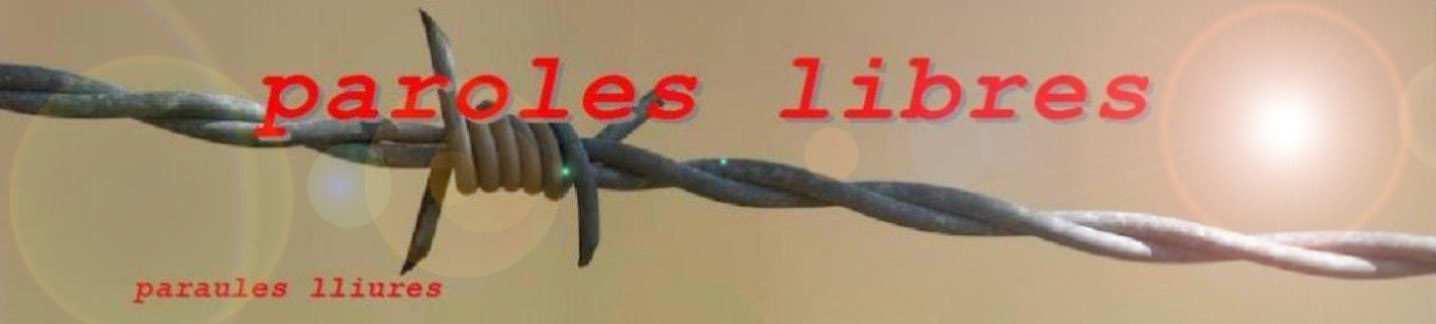
Commentaires récents