Écologie

L’inaction écologique menace désormais l’espace démocratique, estime le philosophe Pierre Charbonnier. Les régimes autoritaires qui émergent ne se constituent-ils pas en appui à l’accumulation de richesses par quelques-uns au prix de la dilapidation des ressources de tous ? Face à cette destructrice « utopie du marché », les progrès politiques viendront du contre-mouvement social. Entretien réalisé en partenariat avec l’hebdomadaire Politis.
Basta ! et Politis : Comment interprétez-vous la multiplication d’initiatives écologiques et sociales à l’échelle locale ?
Pierre Charbonnier [1] : Ces démarches perpétuent une grande tradition de lutte pour les libertés et les droits collectifs, elles remettent en avant ce que l’on peut appeler la conquête de l’autonomie. À la différence des précédentes transformations sociales, ces revendications ne se font pourtant plus seulement dans une relation positive à l’État, mais contre lui. Le droit du travail, la Sécurité sociale, les retraites : historiquement, les dispositifs de protection ont été négociés et obtenus avec l’État ; c’est ainsi que celui-ci est devenu l’interlocuteur principal du mouvement social, et donc une valeur pour la gauche. Puis, en grande partie sous l’effet de l’émergence des enjeux écologiques, ce jeu s’est renversé. C’est désormais contre l’État centralisateur et bureaucratique que se construit parfois le mouvement de conquête de l’autonomie collective.
 La grande machine administrative qui a mis en forme la protection sociale a été largement incapable d’entendre d’autres demandes, en rupture avec le processus d’uniformisation territoriale qui caractérise la modernité. C’est ce qu’illustre la lutte contre les grands projets inutiles, ces infrastructures industrielles accusées de sacrifier des morceaux de territoire au nom de l’intérêt « national ». L’exemple le plus symbolique est celui de Notre-Dame-des-Landes : tout l’enjeu pour les opposants à ce projet de nouvel aéroport dans la région de Nantes consistait à démontrer à l’État qu’il ne savait plus administrer correctement ce territoire, que l’espace n’est pas seulement une juxtaposition de parcelles identiques les unes aux autres. Que ce soit au regard de ses caractéristiques écologiques propres ou de l’histoire des savoir-faire qui y sont implantés, il était possible de démontrer en actes que l’aéroport promu par l’État constituait un gâchis et un investissement obsolète.
La grande machine administrative qui a mis en forme la protection sociale a été largement incapable d’entendre d’autres demandes, en rupture avec le processus d’uniformisation territoriale qui caractérise la modernité. C’est ce qu’illustre la lutte contre les grands projets inutiles, ces infrastructures industrielles accusées de sacrifier des morceaux de territoire au nom de l’intérêt « national ». L’exemple le plus symbolique est celui de Notre-Dame-des-Landes : tout l’enjeu pour les opposants à ce projet de nouvel aéroport dans la région de Nantes consistait à démontrer à l’État qu’il ne savait plus administrer correctement ce territoire, que l’espace n’est pas seulement une juxtaposition de parcelles identiques les unes aux autres. Que ce soit au regard de ses caractéristiques écologiques propres ou de l’histoire des savoir-faire qui y sont implantés, il était possible de démontrer en actes que l’aéroport promu par l’État constituait un gâchis et un investissement obsolète.
Est-ce à dire que l’État serait aujourd’hui devenu un adversaire dans la lutte pour le progrès écologique et social ?
Ce n’est pas aussi simple. Je ne crois pas à une lecture qui opposerait l’autonomie radicale à l’État. Il ne faut pas oublier que la haine de l’État peut aussi venir du fanatisme marchand : c’est très clair dans la tradition viennoise, chez Hayek [Friedrich Hayek, économiste britannique, ndlr] et ses héritiers, qui étaient aussi des « autonomistes » à leur façon, avec l’idée que l’offre et la demande peuvent se rencontrer sans la tutelle d’un grand intendant général. L’enjeu est donc de savoir où et comment produire du commun et des politiques de solidarité à l’heure du choc climatique. Parfois, cela passe encore par les formes classiques et majestueuses de l’État, comme c’est le cas avec le projet d’un Green New Deal aux États-Unis, qui entend répondre au démantèlement de l’État fédéral américain par le président Donald Trump. Pour discipliner de grands oligopoles industriels, pour orienter les flux de capitaux dans la bonne direction et pour ajuster le droit à l’enjeu écologique, il est difficile de ne pas en passer par l’État.
Dans d’autres cas, cela passe plutôt par des échelles régionales ou municipales. La question, selon moi, n’est pas d’être pro ou anti-étatiste, mais plutôt de faire une critique de la souveraineté. Il faut contraindre l’État à ne pas s’envisager comme une sorte d’instance transcendante qui s’imposerait à son propre territoire et à ses administrés au nom d’une volonté qui s’exprime épisodiquement dans les urnes. La souveraineté est un concept issu de la théologie qu’il faut combattre. Cela ne veut pas dire que l’État, en tant que structure institutionnelle, ne doit plus faire l’objet d’une conquête.
Pour autant, le local n’est-il pas devenu un levier d’action plus efficace ?
Les initiatives de remunicipalisation à l’œuvre, pour l’eau ou pour alimenter en circuit court les cantines scolaires par exemple, peuvent avoir un impact gigantesque sur les modes de consommation et l’économie politique. C’est fascinant de voir que certaines municipalités ne se considèrent plus seulement comme des entités administratives et budgétaires abstraites, qui gèrent des crédits venus d’en haut et qui accordent des marchés aux entreprises compétitives, mais comme des acteurs qui veulent intervenir activement sur les dépendances matérielles qui définissent le monde urbain.
Les villes sont par définition des aspirateurs métaboliques qui absorbent de grandes quantités de ressources et produisent des déchets. En remodelant les infrastructures de transport et les chaînes d’approvisionnement, elles peuvent limiter ce déséquilibre et imprimer dans la conscience collective une meilleure culture écologique et une conscience accrue de la valeur des liens matériels et de la façon dont ceux-ci s’articulent à des liens institutionnels.
La question de l’énergie interroge aussi, à sa façon, l’organisation d’un contre-modèle dans lequel les territoires seraient plus autonomes : comment, par exemple, assurer un accès et une distribution équitables à l’énergie si tous n’ont pas les mêmes ressources ou la même capacité de production ?
L’économie de l’énergie est un objet fascinant parce qu’elle est à la fois liée à la territorialité locale, et imbriquée dans des jeux diplomatiques très complexes. Début 2020, par exemple, il y a eu une manifestation à Hambourg (Allemagne) contre la décision prise par Siemens de signer un contrat avec Adani (une entreprise indienne) pour construire la signalétique d’une ligne de chemin de fer en Australie, qui part d’une mine de charbon jusqu’à son terminal d’expédition vers la Chine. Nous sommes face à des capitaux indiens qui vont exploiter une ressource australienne en direction de la Chine avec un savoir-faire allemand. Il y a là, incontestablement, des questions de territoire, mais la cartographie politique a complètement explosé : on n’est plus au 19ème siècle, quand les ouvriers et les patrons habitaient dans la même ville, à quelques rues d’écart, et se faisaient face directement dans les luttes sociales.
Aujourd’hui, le contre-mouvement doit épouser les formes territoriales de l’organisation du capital, être aussi souple et mobile que lui. C’est une forme d’internationalisme, bien entendu, mais qui n’est plus tout à fait celui qui a été théorisé au 19ème siècle. Il ne s’agit pas seulement de coaliser des groupes sociaux similaires par-delà les frontières, mais de coaliser des groupes sociaux très différents dont les intérêts s’alignent.
| Lire à ce sujet : Pourquoi et comment faire des marchés financiers le nouveau foyer des luttes sociales, entretien avec le philosophe Michel Feher |
C’est donc dans l’articulation entre toutes ces échelles que se jouerait aujourd’hui la conquête de l’autonomie ?
Ce qui compte, quelle que soit l’échelle à laquelle on se situe, c’est d’être attentif aux ressources que l’on peut exploiter pour faire société. Il en existe à l’échelle locale, d’autres qui sont à la mesure des vieux États-nations – comment, par exemple, gérer autrement la Sécurité sociale qu’à cette échelle ? – et d’autres qui sont transnationales. Historiquement, chacune de ces trois échelles est porteuse de ses pathologies propres : le localisme identitaire et l’idéologie de l’ancrage ont été le berceau des conservatismes, le patriotisme à tendance protectionniste est le péché mignon de certains socialistes, et le globalisme utopique est caractéristique des libéraux. Il faut savoir identifier ces pathologies pour ne pas enfermer la pensée et l’action politique dans un seul registre territorial.
Les nouvelles luttes écologistes, selon vous, sont un prolongement historique des luttes ouvrières…
L’une des caractéristiques fondamentales du mouvement ouvrier, c’est d’avoir compris que le choc matériel, celui de l’industrialisation, nous obligeait à reconsidérer ce que l’on appelait la liberté. Le développement des nouvelles technologies productives ainsi que les nouvelles formes de division du travail et de consommation ont bouleversé la conception individualiste dominante qui encadrait l’idéal d’émancipation – et dont l’idée de propriété était le socle. Le socialisme s’est construit en incorporant ce choc matériel à sa pensée politique. C’est ainsi que l’idée de société elle-même est née : les interdépendances entre les individus, et entre les individus et les choses, sont constitutives de leur condition, et on ne peut en rester aux idées nées à l’âge préindustriel. C’est un mouvement de pensée dans lequel la question des rapports collectifs à l’extériorité matérielle est indissociable de la réflexion politique.
Or, aujourd’hui, un nouveau choc matériel nous arrive, qui s’appelle le changement climatique et qui déstabilise les conditions matérielles dans lesquelles nous existons. Ce choc-là doit donner lieu à une nouvelle formulation des idéaux de justice et d’égalité, comme cela avait été le cas au 19ème siècle. C’est en cela qu’il y a une relation à la fois de continuité et de discontinuité avec l’héritage socialiste. D’une part, il y a, dans le nouveau pacte social à construire, certains aspects qui héritent directement du socialisme, comme le refus du seul marché comme régulateur. D’autre part, il doit aussi y avoir une rupture, car la relation productive au monde matériel ne peut plus être admise comme un socle intellectuel allant de soi.
La construction de l’État social, notamment après la Seconde Guerre mondiale, a eu pour contrepartie de rendre les finances publiques tributaires de hauts niveaux de croissance, longtemps dopés par l’accès à des énergies bon marché. Quand les gains de productivité se sont mis à ralentir, quand les énergies sont devenues plus chères, cette marche en avant s’est grippée, on a eu recours à la dette. La crise perpétuelle de l’État social est un signe que l’impératif de croissance est devenu néfaste sur le plan social autant qu’écologique. Aujourd’hui, il est impératif de rompre avec la logique qui subordonne les politiques de redistribution à la performance économique : il faut se demander quelles infrastructures techniques et écologiques on peut déployer pour engendrer de la justice sociale et de la sobriété, et plus seulement si notre sphère économique est assez compétitive pour financer notre modèle social.
À l’heure où l’écologie politique est parfois instrumentalisée par le discours du « ni droite, ni gauche », votre propos a le mérite de la positionner très clairement sur l’échiquier…
Il y a deux questions. D’abord, si la gauche veut survivre, il faut qu’elle se réinvente, comme le socialisme avait réinventé l’émancipation au 19ème siècle. L’articulation de la justice sociale à l’enjeu du choc climatique sera décisive. Ensuite, l’adversaire politique de cette gauche nouvelle version n’est pas monolithique. Schématiquement, il se présente sous les traits du mainstream néolibéral d’un côté et de la réaction nationaliste de l’autre. Ces deux blocs sont constamment en train de s’opposer officiellement tout en s’échangeant des arguments, mais il n’en reste pas moins qu’il faut trouver des arguments spécifiques en fonction des confrontations.
Ce pôle de « la gauche nouvelle version » est encore loin, toutefois, de s’affirmer comme uni et rassemblé. Sur quelles bases une alliance des forces actuelles vous semblerait-elle envisageable ?
Les résultats des élections européennes de 2019 ont incité les organisations issues de l’écologisme classique à penser qu’elles étaient en train de prendre leur revanche historique sur la gauche sociale-démocrate et anticapitaliste. Pendant des années, on a ridiculisé le « vert » comme un élément minoritaire, décorrélé des grandes luttes sociales. Alors, quand l’opinion leur paraît plus favorable, les écologistes n’ont plus envie de s’écraser et misent sur une stratégie d’indépendance. Mais ces résultats sont en trompe-l’œil : ils sont liés aux échecs du Parti socialiste, et aux hésitations idéologiques de La France insoumise autour de la stratégie « populiste ». Surtout, la capacité des écologistes à capter les demandes de justice issues des classes populaires reste pour le moins limitée. Après le mouvement des gilets jaunes, il aurait été nécessaire pour eux de construire un discours qui ne prête à aucune confusion concernant la culpabilisation du consommateur pauvre, tout en se séparant de l’attachement traditionnel au « vert », qui est encore largement perçu comme un instrument de distinction sociale.
Autrement dit, rendre l’écologie plus intelligible sur les questions sociales ?
Il faut pouvoir présenter l’écologie comme une proposition forte sur les transports, le logement, les territoires, mais aussi sur les conséquences de l’accumulation du capital – et pas seulement sur le glyphosate ou le nucléaire. Le recours même à la terminologie environnementale pourrait s’effacer pour laisser place à une réflexion sur les infrastructures matérielles de la liberté et de l’égalité. On entend encore trop souvent des discours « paléosocialistes » : la culture contestataire dans laquelle résonne le souvenir des grandes conquêtes sociales ne parle pas à tout le monde, parce qu’elle s’enracine dans un monde en partie révolu. La symbolique du vert, du tournesol, est en porte-à-faux par rapport à l’imagination politique du plus grand nombre, de la même manière que la symbolique des grandes confrontations de classe est décalée par rapport à la réalité sociale actuelle.
Sur la question de l’articulation entre la gauche et l’écologie, je ne pense pas qu’une alliance bien coordonnée autour d’un unique langage politique puisse se former à court terme. Il faut donc faire avec ce que l’on a et apprendre à orchestrer différents registres symboliques. J’aurais tendance à penser que la double opposition au pôle néolibéral et au pôle conservateur peut suffire à une alliance de circonstance, une alliance composée d’acteurs suffisamment polyglottes pour accepter les langages propres à différentes cultures sociales et formes de luttes. N’oublions pas que de larges pans de l’élite administrative et technique seront des alliés nécessaires dans la bascule écologique et sociale : il faut faire du droit, construire des infrastructures sobres, réapprendre de quel sol on vit. Tout cela nécessite aussi des savoirs de pointe. Les victoires du mouvement émancipateur se produisent toujours quand des groupes différents voient leurs intérêts s’aligner. Il ne faut donc pas manquer l’occasion lorsqu’elle se présente.
Autour de quels thèmes et de quels enjeux particuliers cette nouvelle culture politique pourrait-elle se former ?
D’abord sur la critique de l’inefficacité de l’économie politique capitaliste : en plus d’être socialement injuste, le marché n’arrive pas à faire bon usage de la nature car il subordonne tout à une logique comptable qui rend quasiment invisibles les liens très concrets que l’on entretient avec notre milieu. Il faut donc réactiver un contrôle démocratique de l’économie pour qu’elle soit en mesure de s’ajuster aux impératifs écologiques.
Et il y a des sujets qui n’ont, en apparence, de rapport qu’indirect avec l’écologie mais qui sont fondamentaux. L’éducation, par exemple : aujourd’hui, l’état de l’école est une honte nationale, le désinvestissement dans la transmission scolaire, notamment dans les régions les plus pauvres, est affligeant. Comment fait-on une société qui répond à l’injonction écologique de manière constructive si on n’a pas de leviers de transmission ? Il faut mettre en œuvre une alphabétisation écologique, un peu de la même manière que la IIIème République s’était efforcée de fabriquer des citoyens adaptés au nouveau régime politique en construction. Il faut qu’un enfant connaisse aujourd’hui les mécanismes de base des cycles du sol, du climat et des chaînes productives – c’est aussi important que la Révolution française et Victor Hugo ! On pourrait dire la même chose au sujet des retraites : comment se fait-il que ce débat, qui engage la solidarité intergénérationnelle et le temps long, soit à ce point déconnecté des thèmes de l’écologie ? Le système de retraite est tributaire d’estimations de croissance sur plusieurs décennies, et donc de notre capacité future à produire et à répartir des richesses. Il ne peut être réduit à un enjeu budgétaire abstrait. Là encore, il faut donc décloisonner l’écologie.
Un autre de vos combats intellectuels consiste à rappeler que ces impératifs écologiques ne sont pas incompatibles avec la préservation d’un idéal démocratique : pouvez-vous détailler votre raisonnement à ce sujet ?
Il y a une inquiétude, souvent répétée, que la réaction au choc climatique débouche sur une sorte d’autoritarisme vert. Cette inquiétude prouve, selon moi, que l’on n’a pas bien compris ce qu’était un État démocratique : on l’assimile aux libertés individuelles, comprises essentiellement comme des libertés économiques. Mais un espace démocratique, ce n’est pas « chacun fait ce qu’il veut », c’est au contraire la capacité collective à se donner des règles. Parmi celles-ci, il y en a une qui, au moins depuis le 19ème siècle, est constitutive de cet espace démocratique. C’est ce que l’on pourrait appeler « la discipline du capital » : l’impôt, évidemment, mais aussi le droit social, qui limite le temps de travail, ainsi qu’un certain nombre de règlementations sur l’utilisation des technologies ou de ressources. Cette discipline du capital souligne tout simplement l’erreur de l’utopie libérale : elle ne produit pas l’optimisation de l’utilisation des ressources sur la base du marché, comme elle le revendiquait, elle produit plutôt leur dilapidation.
| Retrouvez cet entretien – et bien d’autres articles sur les alternatives face à « l’inaction climatique » – dans le hors série commun à Basta ! et Politis, à commander ici |

L’économie politique capitaliste a été présentée comme la solution la plus simple pour nous faire suivre la voie du développement matériel. Cette promesse a été partiellement réalisée, il faut tout de même reconnaître que les conditions dans lesquelles on vit aujourd’hui n’ont rien à voir avec celles qui précèdent la grande mutation industrielle. Mais elle n’a pas forcément su convertir ce développement matériel en développement politique.
S’il y a eu des progrès politiques, essentiellement du côté de la protection sociale, ce n’est pas l’œuvre de l’utopie du marché, mais celle du contre-mouvement qui a réussi à faire monter dans l’État une demande de régulation. En réalité, ce qu’on nous vend comme spontané, à savoir le marché, est une construction institutionnelle, activement supportée par l’État, sur une période très longue, entre les 16ème et 19ème siècles.
Comme le disait l’économiste Karl Polanyi, « le libre-marché a été planifié, le contre-mouvement socialiste, lui, est spontané ». C’est ce contre-mouvement qui a restitué le droit à l’autonomie des individus. Cela fonctionne de la même manière pour la crise écologique : le freinage n’est pas un obstacle à la démocratie, on peut même considérer que c’est la voie par laquelle la démocratie va pouvoir subsister face au choc climatique. Il faut pouvoir sauver le climat, non par la technologie comme certains s’y essayent, mais plutôt par une mutation sociologique, c’est elle qui permet d’emmener le plus de monde.
Pour autant, on entend souvent dire que des mesures comme la taxe carbone ou la réduction du trafic aérien pourraient être jugées « anti-démocratiques »…
Où a-t-il été écrit que l’accès à des billets d’avion bon marché faisait partie du pacte démocratique ? Nulle part ! On mesure là à quel point cette ambition triviale qu’est l’accès sans limite à des biens, qui ne sont ni de subsistance, ni même d’agrément, paraît désormais presque constitutive de l’ordre démocratique. C’est tout de même fabuleux. Or ce qu’il se passe aujourd’hui, c’est que pour sauver l’« accumulation », comme on le dirait en des termes marxistes assez classiques, on est obligé de détruire la démocratie. Parce qu’il faut maintenir des gains de productivité sur le travail – c’est la réforme du droit du travail –, ou pour les ressources – c’est l’absence de contraintes pour les sphères fossiles et extractives.
Sauf que ces gains de productivité produisent de la souffrance sociale, dans le premier cas, et le choc écologique, dans le second. De surcroît, ces gains de productivité sont quasi-nuls depuis vingt ans. Même l’informatisation n’en a quasiment pas produit. C’est fini, l’histoire de cette grande conquête moderne, « l’abondance et la liberté en même temps », qui reposait sur les gains de productivité « smithien » (d’Adam Smith, qui a théorisé la division du travail) et « ricardien » (de David Ricardo, qui a théorisé l’optimisation de l’exploitation de la nature). Cela nous met en porte-à-faux, matériellement et socialement, et n’est plus générateur de démocratie. La démocratie est, et a toujours été, une forme d’auto-limitation et d’auto-contrainte.
On pourrait aussi renverser la perspective en considérant que c’est l’inaction écologique qui va miner l’espace démocratique. Que ce sont eux, les saboteurs. De fait, aujourd’hui, on peut constater que ce qui relève de l’autoritarisme vient plutôt en appui des politiques de croissance, aux États-Unis, au Brésil, en Inde…
Faut-il en passer par le droit ? Le mouvement pour les droits de la nature ou la reconnaissance d’un crime d’écocide prend de l’ampleur et a obtenu quelques premières victoires symboliques…
Aujourd’hui, le sujet politique n’entretient plus le même rapport au vivant et au non-humain. Dans les droits de la nature, il y a cette intention généreuse, qu’on pourrait appeler « l’animisme juridique », qui consiste à mettre à niveau humains et non-humains comme tous porteurs de droits. Intellectuellement, je suis méfiant sur les formulations naturalistes et dualistes des enjeux politiques : l’idée d’un crime d’écocide et d’un droit de la nature me met très mal à l’aise car cela oblige encore à séparer des donneurs de droit, d’un côté, et la nature, de l’autre, qui serait encore quelque chose d’un peu inerte. Dans un tribunal, pour l’instant, ça ne marche pas : il y a le principe d’intention, en droit, et il est impossible de prouver qu’on a voulu détruire la nature.
C’est un mouvement qui peut se justifier politiquement, au regard des dynamiques contemporaines, mais qui reste compliqué d’un point de vue juridique. En réalité, il est déjà écrit que la propriété ne saurait remettre en cause le droit à une vie décente, donc il est possible de démontrer l’infraction des activités agro-industrielles ou pétrolières au regard d’un droit déjà existant. Le problème n’est donc pas d’inventer un nouveau droit, c’est de mieux interpréter celui qui existe déjà, l’interpréter de manière un peu plus radicale et de l’appliquer.
Propos recueillis par Barnabé Binctin
Photo : © Anne Paq
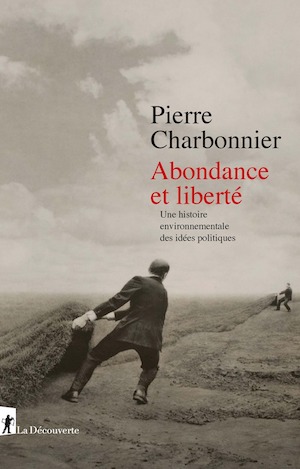 Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, Pierre Charbonnier, La Découverte, 2020 (version numérique : 16,99 €)
Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, Pierre Charbonnier, La Découverte, 2020 (version numérique : 16,99 €)
Notes
[1] Pierre Charbonnier est philosophe, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et membre du laboratoire Lier-FYT à l’EHESS. Il est l’auteur du livre Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques (La Découverte, 2020)

Commentaires récents