Histoire
12 mai 2025 par Commission journal AL

8 mai 1945 : ce jour est resté dans l’Histoire comme étant celui de la capitulation nazie, douze ans après leur installation au pouvoir et six ans après le déclenchement du conflit le plus meurtrier que le monde ait connu. Mais le 8 mai 1945 c’est aussi la date du début d’un massacre colonial d’ampleur, qui durera plusieurs semaines, perpétré par l’Armée française et des supplétifs coloniaux en Algérie. À Sétif, Guelma et Kherrata, l’État réprime dans le sang des manifestations nationalistes. Retour sur l’autre 8 mai 1945.
Comme le rappelle l’historien Yves Benot, pour la France et l’Algérie, le 8 mai 1945 incarne deux mémoires antagonistes : « le 8 mai est une date encore vivante en France comme en Algérie, mais avec des significations opposées. En France, il évoque la Libération achevée, en Algérie, la revendication d’une Libération à faire, revendication étouffée cette fois-là dans le sang. Revendication de tout le peuple algérien, mais la répression se concentre autour de Sétif et Guelma, dans le Constantinois » [1].
Ce jour-là, à Sétif, à Guelma et à Kherrata, la France réprime dans le sang les manifestations dès lors que sont brandis des drapeaux algériens. La libération pour les Françaises et Français, pas pour les Algériennes et Algériens. La sanglante répression, qui durera plusieurs semaines, marque un tournant dans l’expression du nationalisme algérien. Dès lors, la voie pacifique et réformatrice n’est plus de mise ; face à un État colonial intransigeant, le chemin vers l’indépendance s’écrira désormais les armes à la main.
Une promesse trahie
Les événements survenus le 8 mai s’inscrivent dans une dynamique anticoloniale qui s’est accélérée à l’occasion du conflit mondial. Le 14 août 1941, la Charte de l’Atlantique, signée par Franklin D. Roosevelt (1882-1945) et Winston Churchill (1874-1965), est promulguée. Dans celle-ci, les deux hommes politiques déclarent respecter « le droit qu’ont tous les peuples de choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils entendent vivre ; et [désirer] voir restituer, à ceux qui en ont été privés par la force, leurs droits souverains ».
Cette charte est aussitôt interprétée par les nationalistes algériens comme un soutien au principe d’autodétermination. L’attente de réformes politiques est patente. D’autant plus que cela va dans le « sens de l’Histoire ». La Conférence de Brazzaville, organisée en janvier 1944 par le Comité français de libération nationale, évoque également des réformes dans les colonies françaises, tout en rejetant explicitement l’idée d’autonomie ou d’indépendance, affirmant que la « mission civilisatrice de la France » devait se poursuivre. Enfin, l’ordonnance du 7 mars 1944, promulguée par le Gouvernement provisoire, qui prétend abroger le code de l’indigénat et annonce de nouveaux droits pour les Algériens et Algériennes, suscite un regain d’espoir.

Le mouvement nationaliste algérien se renforce lors de cette période, d’autant plus que l’administration du territoire algérien sous Vichy est particulièrement dure. La « Révolution nationale », sa volonté de créer un « homme nouveau » et de lutter contre « l’anti-France » est appliquée avec zèle, d’autant plus qu’à la suite de la signature de l’armistice du 22 juin 1940 et de la création d’une zone occupée couvrant plus de la moitié du territoire hexagonal, l’Algérie apparaît « comme un refuge pour la souveraineté française » [2].
Sous l’impulsion du général Weygand se constitue un « vichysme colonial en Algérie » [3] désireux de faire lever un « vent [contre-]révolutionnaire ». Les tensions s’accroissent dans les mois qui suivent le débarquement des Alliés en Afrique du Nord en novembre 1942 : le mythe de la toute puissance colonisatrice s’effondre et le mouvement nationaliste, bien que durement réprimé par le police de Vichy, se renforce à la base.
Le leader nationaliste modéré Ferhat Abbas (1899-1985) publie en 1943 le Manifeste du peuple algérien qui revendique un nouveau statut pour la « nation algérienne » et créé dans la foulée l’association des Amis du Manifeste et de la liberté (AML). Leurs revendications rejoignent celles plus radicales de Messali Hadj (1898-1974), pionnier du l’indépendantisme algérien et fondateur du Parti du peuple algérien (PPA), emprisonné depuis 1941.
La montée des tensions
Le 2 avril 1945, à l’occasion du congrès des AML, est adoptée une motion demandant la libération de Messali Hadj reconnu « leader incontesté du peuple algérien ». Le 18 avril, alors qu’une délégation de membres du PPA est venue demander sa libération au Préfet, une émeute éclate à Ksar Chellala où il est emprisonné depuis le début de l’année. Le PPA et l’AML appellent conjointement à des manifestations nationalistes le 1er mai, notamment dans les villes d’Alger, Oran, Sétif et Tébessa, distinctes des cortèges syndicaux de la CGT (bien qu’il soit prévu notamment à Alger de rejoindre le cortège syndical en fin de manifestation).

Les tensions dégénèrent en affrontements avec les forces de l’ordre, faisant plusieurs morts et mortes et blessé·es parmi les manifestants et manifestantes : quatre personnes sont tuées à Alger, et plusieurs mortellement blessées décèdent les jours suivants, une autre meurt à Oran ; les blessé·es se comptant par centaines [4]. Un drapeau algérien (interdit) levé [5] et des mots d’ordre réclamant la liberté [6] ont suffi aux autorités coloniales pour ouvrir le feu. Une semaine plus tard, à l’occasion du 8 mai, l’AML et le PPA appellent à nouveau à des manifestations, notamment dans le Constantinois, pour la libération de Messali Hadj qui, depuis les incidents survenus à Ksar Chellala, a été déporté à Brazzaville (Congo).
Un tournant sanglant
Le 7 mai, l’annonce anticipée de la signature de la capitulation du IIIe Reich se répand. Des manifestations célébrant la fin de la guerre s’organisent sur tout le territoire, en France métropolitaine mais aussi en Algérie. Le PPA, bien qu’interdit depuis 1939, appelle encore à la manifestation. Ce qui doit caractériser ces manifestations « ce sera le drapeau algérien placé au milieu des drapeaux des Alliés, et les banderoles avec des mots d’ordre comme : “Algérie libre !” (ou “indépendante”) ; “Libérez Messali Hadj” » [7].
À Sétif, ville natale de Ferhat Abbas, l’AML n’appelle pas à manifester : ce sont des Scouts musulmans, organisation légale créée par des membre du PPA, qui tiennent la banderole de tête. La manifestation part des quartiers musulmans pour se rendre au monument aux morts, situé dans la partie européenne de la ville, où une gerbe doit être déposée. Le sous-préfet Butterlin avertit, « qu’il ne doit pas y avoir de banderoles avec mots d’ordre et, bien sûr, pas de drapeau algérien » [8]. Lorsqu’il apprend que des « banderoles subversives » sont bien présentes, il ordonne de « les faire disparaître », quitte à ce qu’il y ait « de la bagarre ». Ce qui dans le contexte des événements survenus une semaine auparavant signifie que ce pourra être au prix d’autres morts… et c’est précisément ce qui arrive quand un commissaire cherche à faire baisser un drapeau algérien des mains de son porteur, lequel refuse et le porte encore plus haut. Bouziz Saal, 26 ans, membre des Scouts musulmans, est abattu par un policier. Il est le premier d’une longue série de morts qui s’étalera sur plusieurs semaines.

Tel un jeu de dominos, le premier homme abattu entraîne une série d’événements qui s’enchaînent pour aboutir à un massacre d’ampleur. Le premier coup de feu en entraîne plusieurs autres, la foule se disperse. Tandis qu’une partie des manifestantes et manifestants musulmans décide de poursuivre vers le monument aux morts, où ils et elles seront accueillies par des gendarmes en armes qui essuient une pluie de caillasses, une autre partie se déchaîne contre les Européens et Européennes croisées sur leur parcours.
En une demi-heure, 21 Européens et Européennes ont perdu la vie selon un rapport officiel ; on ne compte pas le nombre de victimes du côté algérien ! Le sous-préfet décide de faire appel à des compagnies de tirailleurs algériens, avec encadrement français, pour mater la rébellion. Dans la matinée du 8 mai à Alger, alors que les tirs survenus à Sétif ne sont pas connus de la population, Ferhat Abbas, venu présenter au gouverneur général – le socialiste Chataigneau – les félicitations des AML pour la victoire des Alliés, est arrêté par le directeur de la sécurité militaire sous l’accusation de complot contre la sécurité de l’État.
Une escalade mortifère
Si « l’ordre » est rapidement rétabli dans la ville de Sétif, il n’en est pas de même au-delà. Comme une traînée de poudre, la nouvelle des coups de feu tirés contre les manifestants et manifestantes se répand dans la matinée aux villages et villes alentours sur la route qui va de Sétif à la mer. À Guelma, les manifestations officielles ne sont prévues qu’en fin d’après-midi. Mais lorsque le sous-préfet Achiary et les représentants officiels se retrouvent face à une foule de manifestantes et manifestants musulmans, des coups de feu sont tirés. Ici aussi, le premier à tomber est le porteur du drapeau algérien.
La foule réplique par des jets de pierres et blesse des policiers mais aucun Européen ou Européenne n’est tuée. Peu importe, offense a été faite à la puissance coloniale. Le sous-préfet ordonne la fermeture immédiate des cafés et établit un couvre-feu. Il ordonne également la constitution d’une milice de colons européens constituée de « 150 hommes sûrs ». Les arrestations et exécutions sommaires commencent. Mais lorsque des paysans et paysannes algériennes des alentours se réunissent aux abords de la ville, c’est l’aviation qui les mitraille et bombarde. Désormais c’est l’Armée qui se charge du « maintien de l’ordre ».

Plus d’un mois durant, les « dissidents », comme les appelle le général Henry Martin, commandant supérieur des troupes en Algérie, sont repoussé·es vers les montagnes et impitoyablement pourchassé·es. Guelma reste un important point de résistance des Algériens et Algériennes qui résistent presque un mois malgré un ratissage intense des troupes militaires. Le nombre de morts côté algérien est encore inconnu à ce jour. Les estimations varient du simple au décuple et même plus : de 3000 à 30000 disent la plupart des historiens et historiennes, 45000 est le chiffre annoncé à l’époque par le PPA.
Se souvenir de ces massacres, c’est aussi ne pas oublier ces morts et mortes inconnues, en tout cas que l’Histoire ne reconnaîtra jamais, car il et elles étaient du côté algérien [9]. La suite, on la connaît. Une guerre qui ne s’achèvera qu’en 1962 et qui sera l’occasion de multiples massacres et actes de torture au nom de la France.
Depuis des années, le politologue Olivier Le Cour Grandmaison se bat pour que soit reconnu à sa juste place cet autre 8 mai 1945 [10]. À l’heure d’un coup de barre à l’extrême droite, il est de notre devoir de rappeler ces massacres commis au nom de la grande « œuvre civilisatrice » de la France. Oui, des massacres de l’ampleur de plusieurs Ouradour ont été commis sur le sol algérien. Non, ces massacres n’ont pas été commis par des nazis mais bien par l’Armée française. Ne pas le reconnaître est une seconde insulte faite aux mortes et morts qui ne revendiquaient que le droit à l’autodétermination, à la liberté, à l’égalité… Héritage d’une certaine Révolution que haïssent tous les réactionnaires, si friands d’un grand roman national vierge de toute tache.
David (ami d’AL)
[1] Yves Benot, Massacres coloniaux. 1944-1950 : la IVe République et la mise au pas des colonies françaises, La Découverte, 1994, p. 9.
[2] Jacques Cantier, « Vichy et l’Algérie, 1940-1942 », dans Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour et Sylvie Thénault (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale, La Découverte, 2014.
[3] L’expression est de l’historien Jacques Cantier.
[4] « À Alger, le 1er mai 1945, quatre morts et plusieurs blessés à la manifestation patriotique organisée par le Parti du peuple algérien (PPA) », Association des anciens appelés en Algérie et leurs ami·es contre la guerre (4ACG), 4acg.org.
[5] Selon des témoignages, on doit à Émilie Busquant, compagne de Messali Hadj et militante anarcho-syndicaliste, féministe et anticolonialiste, la confection du premier drapeau algérien du PPA.
[6] « Les consignes données sont très strictes : pas d’armes, “pas même une épingle” ont formellement recommandé les dirigeants pour éviter toute provocation. Les mots d’ordre lancés sont précis et peu nombreux. L’un d’eux proclame “Liberté pour tous” et un autre, qui revient très souvent, demande la libération des détenus politiques et notamment celle de Messali Hadj. Au cours de la manifestation tout à coup, de façon plus ou moins spontanée, un cri libérateur, scandé bientôt par la foule tout entière : “Yahia el Istiqlal !” (Vive l’Indépendance) et, soudain au-dessus des têtes, le drapeau algérien interdit est brandi. », Mohamed Rebah, « 1er Mai 1945, manifestation et répression sanglante à Alger », babzman.com.
[7] Yves Benot, op. cit., p. 9-10.
[8] Yves Benot, op. cit., p. 10.
[9] À ce propos Yves Benot souligne que « Le ministre de l’Intérieur, le socialiste Adrien Tixier, annoncera le 18 juillet, à l’Assemblée consultative provisoire de Paris, que les victimes s’élèveraient à environ 1500, alors qu’en Algérie les nationalistes parlent de dizaines de milliers de morts. Le 28 juin, Le Populaire fera état de 6000 à 8000 morts algériens, tandis que peu à peu surgit le chiffre souvent répété depuis de 45000 morts. Quant aux Européens – en fait, uniquement Français, à l’exception de trois “indigènes” tués dans les rangs de l’armée et de deux prisonniers de guerre italiens –, on sait, avec certitude, que 102 ont été tués, dont 14 militaires. Au-delà de la mort, la précision des données concernant les colonisateurs en face du vague exaspérant de celles qui concernent les colonisés marque l’opposition radicale de ce que l’on appelle alors les “communautés” », Yves Benot, op. cit., p. 13.
[10] Olivier Le Cour Grandmaison, « Massacres du 8 mai 1945 en Algérie : 80e anniversaire et indispensable reconnaissance », blogs.mediapart.fr.
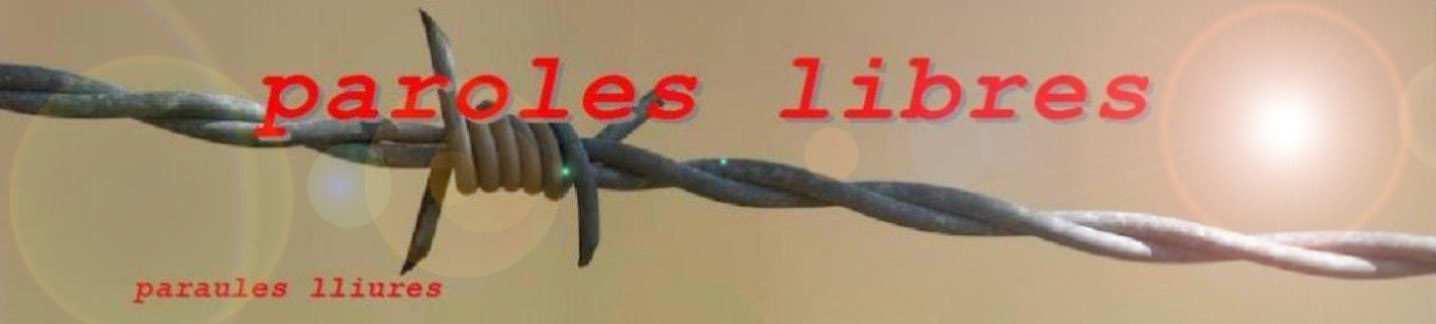
Commentaires récents