
Billet de blog 5 juillet 2023
Comment se fait-il ? Non seulement ils pillent les supermarchés et les bijouteries, attaquent les mairies et les banques mais ils brûlent les écoles. Ils brûlent l’École ! Comment se fait-il ?
Par précaution, ceci pour commencer : je suis depuis fort longtemps irréductiblement adepte de la désobéissance civile non-violente. Je ne l’ai pas toujours été. J’ai éprouvé le besoin de m’en expliquer. Je l’ai fait en publiant un billet ici.
Ceci dit, par une de ces nuits quelque peu agitées qu’il nous est donné de vivre, il m’est venu à l’esprit de feuilleter un vieux livre (L’école des riches, l’école des pauvres, La Découverte et Syros, 2001), (vingt deux ans déjà !) que je publiai comme point d’orgue (ou d’exclamation?) à mes trente cinq années de vie dans l’institution éducative. Et il m’est apparu que mon propos d’il y a vingt ans pouvait peut être questionner notre présent.
Feuilletons donc.
Ça commence comme ça, par un mot de ma modeste mais authentique biographie :
Moi aussi, j’ai été orienté. Un jour de Juillet, vers la fin des années cinquante, l’École de la République décida que je n’étais pas assez méritant, sans doute, pour me permettre de « poursuivre des études ». Je fus donc orienté […], j’allai en BEI (brevet d’enseignement industriel)…
Et ça continue ainsi ;
Nyuma saisit son sac jeté la veille dans un recoin et, à l’instant même, il lui vient à l’esprit qu’elle n’a toujours pas retenu, deux mois après la rentrée, les enchaînements hasardeux de son emploi du temps hebdomadaire. […] La conseillère d’orientation lui a proposé un BEP VAM (vente action marchande) du bout des lèvres. « Pour être caissière à Monop ? » a-t-elle répondu. Et elle a quitté le bureau.
Puis ainsi :
Julie s’est levée tôt. Comme tous les matins. Pour prendre le temps de revoir ses cours, de relire la copie qui lui vaudra l’excellente note habituelle. Ses parents ont veillé à ce qu’elle soit « en avance pour son âge », en équitation comme en latin, au piano comme en mathématiques.
[…]
Ces deux jeunes filles ont le même âge, vivent dans le même pays, sont élèves de la même institution publique d’Éducation nationale. Pourtant elles ne fréquentent pas la même école. L’une va à l’école qui ne conduit pas à Polytechnique, l’autre à l’école qui ne conduit pas à un BEP « sanitaire et social ».
Car le hasard a fait l’une enfant de pauvres qui, comme telle, fréquente l’école des pauvres, l’autre enfant de « riches » qui, comme telle fréquente l’école des riches.
Oui, mais, pauvres ou « défavorisés », comme on disait pudiquement à l’époque et comme on persiste à euphémiser aujourd’hui en parlant à tout bout de champ de « quartiers populaires » ?
Pauvres ! Évidemment pauvres, de toutes les pauvretés, non seulement celle que signale le « bas salaire » mais celle qui mobilise toute énergie, toute réflexion, toute pensée dans l’accomplissement de tâches matérielles dont on se souvient qu’Aristote les confiait à l’esclave défini comme « celui qui, par nature, ne s’appartient pas à lui-même, tout en étant un homme, mais est la chose d’un autre (La Politique). Cette pauvreté qui fait du pauvre […] la « chose » d’un mode de vie le privant de la capacité de se penser autrement qu’exécutant de tâches matérielles, mode de vie pauvre qui se décrit nécessairement en négatif : ne jamais penser à lire un journal, moins encore un livre […], ne jamais penser « culturellement » mais toujours « matériellement », ce qui présuppose une imprégnation des esprits par des représentations tenaces, comme modelées par chaque geste quotidien qui n’est jamais autre que geste asservi ou geste ménager, celui, précisément, dont le philosophe dit qu’il empêche de penser.
Alors, que deviennent-ils ces enfants de pauvres depuis la création du « collège unique » par la fameuse loi Haby du 11 juillet 1975 ?
[…] Le collège les accueille tous. Les enfants issus d’un milieu socio-culturel favorisé et les autres. Ceux qui se heurtent, se cognent, trébuchent sans cesse sur les obstacles du langage, des comportements licites ou réprimés, des incompréhensions, des ignorances. […] Nyuma, ce jour-là, en fin d’après midi et dernière heure de cours, qui refuse de « changer de place » comme le lui demande le professeur excédé par ses « bavardages incessants », et qui ne supporte pas le ton impératif, qui ne comprend pas, ne veut pas comprendre, ne peut plus comprendre, et qui se lève soudain, jette, de rage, son sac à terre et se sauve, quitte la salle hurlant des insultes effarantes, et sa mère à nouveau convoquée pour s’entendre signifier, une fois encore, l’exclusion temporaire de sa fille.
Sans compter l’émergence, depuis bien des année déjà, du phénomène de la « ghettoïsation » :
Ne parle-t-on pas de ghetto social, mais aussi, et plus redoutablement, de ghetto ethnique, quand il se trouve que les pauvres sont des pauvres venus d’ailleurs ? […] L’école alors, recueillant les enfants de la zone, se constitue à son tour en ghetto d’enfants. Car ces enfants-là, qui sont nés dans les mêmes bâtiments, les mêmes logements, des mêmes parents, qui se retrouvent depuis toujours dans les mêmes espaces au pied des mêmes murs, sont à leur tour regroupés dans le même établissement, dans les mêmes classes.
L’école alors apparaît pour ces enfants qui y pénètrent ainsi en cohortes comme un lieu étrange. Car ce lieu est celui du droit, c’est-à-dire du droit extérieur, étranger, celui d’un autre mode de vie, étrange à son tour, ce lieu n’est rien d’autre qu’une parcelle d’extérieur, d’étrangeté implanté au cœur de la zone reléguée, une parcelle du « monde des riches ».
[…]
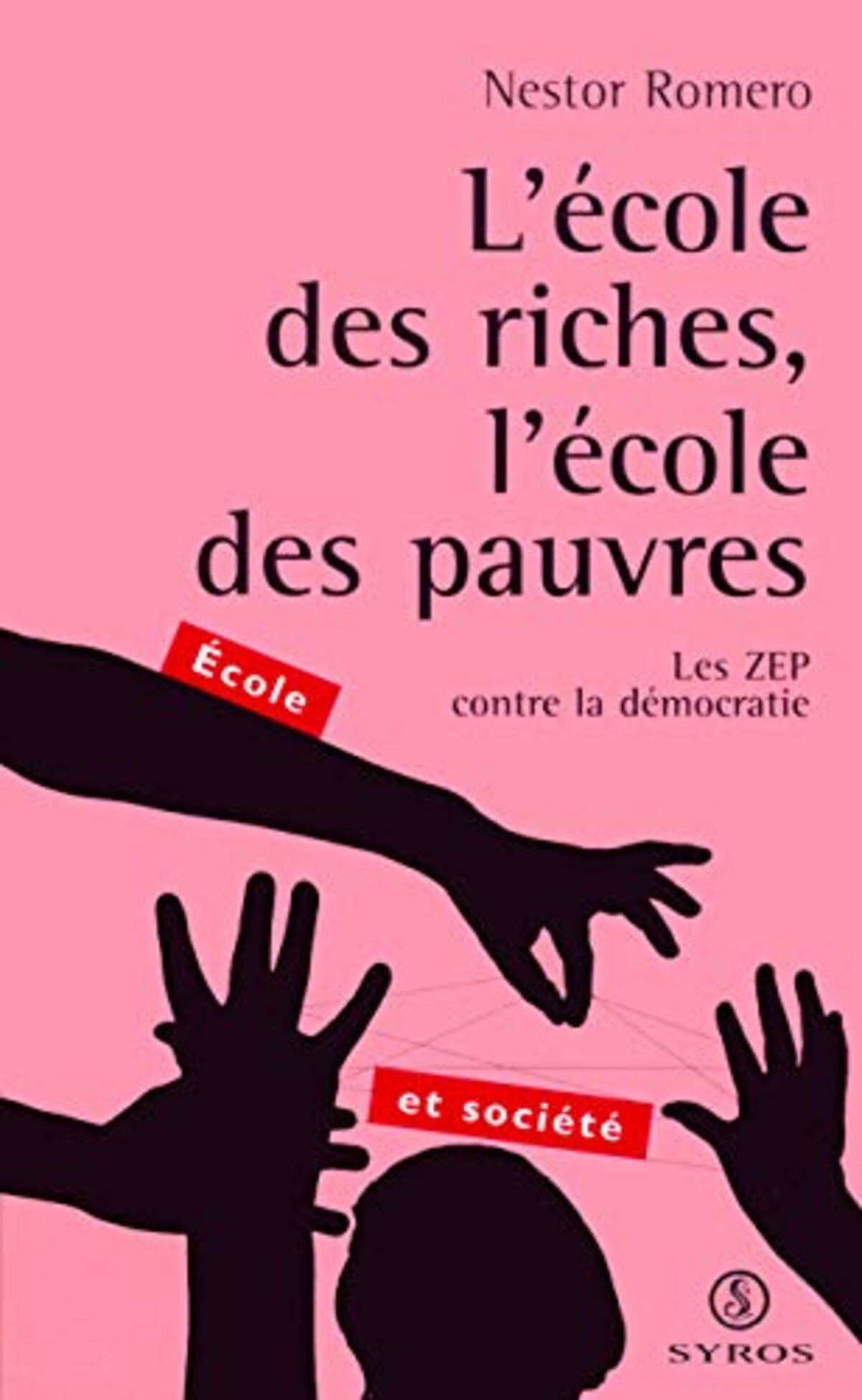
Franchissant la porte de l’école, ces enfants se retrouvent dans un monde dont les lois dictent une manière de se comporter, de se mouvoir, de prendre la parole, de dire les choses, une manière d’être qui, en somme, désavoue leur être, le milieu dont ils sont issus et leur propre entourage. Ils se retrouvent face à des adultes dont le maintien, la gestuelle et le vêtement autant que la langue qu’ils parlent, et qui parfois ne se comprend pas, assombrissent ou pour la moins troublent l’image de leurs propres parents qui en deviennent « imprésentables » […] Ils se retrouvent, enfin, dans un univers d’autant plus étrange qu’il est plus cossu, plus esthétiquement élaboré, plus minutieusement lustré, plus rigoureusement ordonnancé. Ils se retrouvent, de fait, dans un monde riche qui fait d’eux des pauvres.
Les voici alors face à l’alternative des deux modes inéluctables d’appropriation du monde : s’y couler ou le réduire. S’y intégrer, et pour cela se changer soi-même pour ressembler à ce monde, pour ne plus être étranger dans ce monde. Ou le réduire, le transformer, le dégrader, ternir son lustre, le rendre pauvre.
Nous y sommes.
En ces nuits et ces jours d’insurrection, quarante ans après la création des ZEP par la circulaire du ministre Savary (juillet 1981), nous sommes toujours face à la même alternative confirmant ainsi que la « politique d’éducation prioritaire » fut et demeure un échec car les ZEP plutôt que lieu d’innovation pédagogique se sont muées très vite en lieu d’enfermement et de pacification sociale comme en témoignait la parole d’un enseignant recueillie dans le rapport à Ségolène Royale (ministre déléguée à l’enseignement scolaire), « Le collège de l’an 2000 » : On nous dit, on s’en fout complètement des programmes, vous faites ce que vous voulez, ce qu’on veut c’est la paix, c’est que les élèves ne soient pas dans la rue, et maintenant débrouillez-vous.Ce que je confirme d’expérience. Mais alors vient la souffrance et… la violence :
Souffrance, en effet, le mot lui-même que les auteurs du rapport au ministre de la ville ont placé, dans son intitulé, en premier lieu, précédent fort significativement celui de violence pour situer l’ordre des choses (Rapport à C. Bartolone, ministre délégué à la ville : « Souffrances et violences à l’adolescence », novembre 2000). Car trop souvent le terme sonne, « violence », comme un glas alertant d’une irruption barbare, d’une intrusion de hordes sans foi ni loi, ou l’inverse, avec foi et lois étranges, mues en tout cas par on ne sait quelles pulsions dévastatrices.
Ceci fut écrit en l’an 2000 et nous en sommes toujours là, plus que jamais. Et ceci encore :
La souffrance est celle des rêves trop tôt brisés, de trop de rêves qui s’étiolent jour à jour sous l’impact incessant d’une réalité trop morne, trop réelle. Celle des rêves repris et modelés au long de moites, successives et inéluctables heures subies en cette étrange immobilité contrainte, sous le discours vain, chaque instant plus hermétique et insensé, plus inaudible, de ce personnage surgi d’un autre monde, d’un monde bavard, sous les rafales de mot identiques, parce que ils ne désignent rien. Et ce sont des enfants qui s’étiolent ainsi. Nyuma qui, sous l’injonction, retire ses yeux du vague où ils baignaient délicieusement puis, à l’instant où il reprend vie , le regard qui se voile parfois d’une imperceptible brume et les paupières alors s’abaissent.
Ou le rêve volant en éclats au point que le corps affalé en sursaute et que l’invective jaillit, et qu’à l’instant les mains se raidissent, se tendent jusqu’à se rompre et que nul ne sait ce qui, une fois encore, vient de se briser.
La souffrance est celle de la tâche inaccomplie, du « travail à la maison » qui n’a pas été fait et du trouble qui lève de cette inaction, de cette inaptitude à faire ce qui doit l’être, et de ces courses étourdissantes qui ne parviennent pas, sinon au paroxysme de l’étourdissement, à chasser le trouble qui envahit de nouveau au moindre répit d’un corps soudain las.
Cependant, et fuyant comme la peste les généralisations non seulement abusives mais qui ont pour objectif « idéologico-stratégique » de déshumaniser celles et ceux qui en sont les victimes en les noyant dans une sémantique globalisante, ceci : Ils brûlent les écoles ! Qui, ils ?
Car il en est sans doute aujourd’hui, comme il en était hier, qui trouvent dans l’école un espace de liberté qu’ils n’ont pas toujours dans leur famille :
Ainsi Nyuma et ses amies qui les portes à peine ouvertes, se précipitent et se groupent en quelque recoin pour en sortir l’instant d’après transformées, pimpantes et maquillées. Ne dirait-on pas alors que la vie commence en ce lieu où […] les amourettes ébauchées, les rivalités assumées, les réconciliations et, à nouveau les conciliabules animés, les jacasseries fébriles ne s’interrompant plus, déferlent dans les classes.
Non, « ils » ne brûlent pas les écoles ! Qui sont ces « ils » ? Les usagers de cette grammaire pronominale abstraite sont bien incapables de le dire mais ils refusent manifestement de se poser cette simple question : à qui, politiquement, profite le crime ? Naïveté ou machiavélisme ? Quant aux pillages ne sont-ils pas l’inéluctable conséquence du mercantilisme consumériste et spectaculaire qui expose dans les vitrines et sur tous les écrans de luxueuses « marchandises » dont les enfants du ghetto savent qu’ils n’y auront jamais accès. Il en est parmi eux qui « passent à l’acte ».
Ne semble-t-il pas alors qu’il y ait pour le moins quelque cynisme de la part des « riches », de ce « patron des patrons » que je viens d’entendre à la radio brandissant les chiffres du coût de l’événement, ces milliardaires qui dépensent en une journée ce qu’un de leurs domestiques ne gagne pas en un ou plusieurs mois, je ne sais, ces « entrepreneurs » qui produisent du luxe parfaitement inutile et qui par leur mode de vie contribuent, plus que tous les pauvres réunis, à détruire les être humains et les « autres qu’humains » (P. Descola) sur notre planète. Y a-t-il pire violence que celle-là ?
Mais poursuivons notre feuilletage car il ne manqua pas d’enseignants dans les ZEP (trop souvent esseulés, il est vrai) qui tentèrent de « faire quelque chose » :
Leur donner le meilleur à l’école puisqu’ils en sont privés à la maison, les plonger dans ce bain […] dans lequel ils apprendront à se délasser de bien des fatigues et dans lequel ils percevront peut-être des miroitements insoupçonnés.
C’est cela la pédagogie : rendre possible qu’ils écoutent Mozart et entendent ceci :
El mar La mer
sonrie a lo lejos sourit au loin
Dientes de espuma Dents d’écume
labios de cielo lèvres de ciel
Federico García Lorca
La balada del agua del mar, 1919
Il n’en demeure pas moins que la « politique d’éducation prioritaire » qui se donnait comme objectif la lutte contre l’inégalité fut un échec, que les ZEP furent et demeurent un échec :
Échec scolaire et échec social se nourrissant l’un l’autre et preuve à l’appui de l’échec, cette multitude de jeunes, deuxième, troisième ou quatrième génération de pauvres éprouvant plus que jamais le sentiment confus de condamnation a priori par le simple fait hasardeux de la naissance. Car nés dans le béton délabré, de l’autre côté du périphérique, ce mur construit par leurs parents ou grands-parents et qui les sépare, les exclut aujourd’hui de l’abondance rutilante, ils ne se posent pas la question du pourquoi , pourquoi moi ici, ainsi ? Quel dieu, quelle justice, m’a fait naître ici et me condamne à y vivre ainsi, avec d’autres tels que moi, condamnés avant même d’être nés, quel dieu ? Quelle justice ?
Los negros trabajando
junto al vapor. Los arabes, vendiendo,
los franceses,paseando y descansando,
y el sol ardiendo.
En el puerto se acuesta
el mar. El aire tuesta
las palmeras… Yo grito : Guadalupe ?, pero
nadie contesta.
[…]
Nicolas Guillén, Guadalupe, W. I., certes,
(Les noirs travaillant près du vapeur. Les Arabes, vendant, les Français, se promenant et se reposant, et le soleil brûlant.
Dans le port se couche la mer. La douceur du vent berce les palmiers… Moi je crie : Guadalupe ! Mais personne ne répond.)
Personne ne répond, en effet, au pourquoi de cette injustice primordiale, mais eux, les enfants du ghetto, ne se posent pas, pour la plupart la question. Ils la vivent et, la vivant, y répondent en actes irraisonnés et déplorables.
[…]
Mais alors, de la même façon que nul n’est en mesure d’empêcher les morts de faim venus du Sud de franchir le détroit de Gibraltar au risque d’y sombrer, nul n’est en mesure de maîtriser les conséquences de la culture du ghetto, rustique, certes, mais qui tend à légitimer puis à absoudre la violence, et en dernière instance à générer l’insurrection incontrôlée et le pillage des terres gorgées de richesses.
Alors ?
Nous y sommes. Après un demi-siècle de tergiversations d’une classe (ou caste?) politique incapable, ou plutôt se refusant à faire appliquer la timide loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) en permettant aux riches d’acheter leur tranquillité dans les ghettos dorés.
Nous y sommes, avec un président éberlué qui ne sait plus où donner de la tête, un ministre de l’Intérieur qui ment comme il respire et en guise de ministre de la Justice un malotru qui n’hésite pas à s’en prendre aux parents, aux mères, à ces femmes condamnées elles aussi, elles surtout, à accomplir depuis toujours les tâches les plus répugnantes, le prosaïque comme dit E. Morin.
Le brasier va s’éteindre petit à petit, voici venir les vacances (pour celles et ceux qui peuvent en jouir) et les Jeux olympiques à portée de vue qui vont distraire la multitude jusque dans les ghettos les plus disgraciés et les choses iront ainsi car il faut bien, n’est-ce-pas, que le prosaïque soit assumé, il faut bien des pauvres pour servir les riches comme il fallait bien des esclaves à Aristote puisque, disait-il « si les navettes tissaient toutes seules ; si l’archer jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se passeraient d’ouvriers, et les maîtres, d’esclaves ». (Politique, livre 1 chap 2).
N’est-ce pas ?
En attendant la prochaine insurrection…
https://blogs.mediapart.fr/nestor-romero/blog/050723/ils-brulent-meme-les-ecoles

Commentaires récents