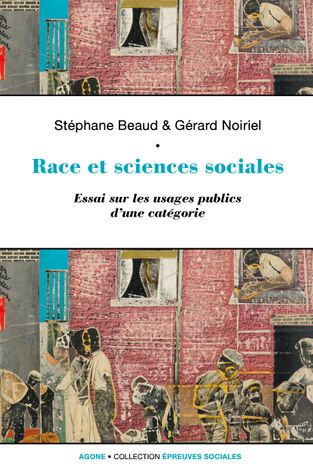
Article mis en ligne le 12 avril 2021par F.G
■ Stéphane BEAUD et Gérard NOIRIEL
RACE ET SCIENCES SOCIALES
Essai sur les usages publics d’une catégorie
Marseille, Agone, 2021, 432 p.
« Donc à la limite, que ce soit la classe qui prédomine ou que ce soit la race,
on s’en fout pas mal ! Nous [les indigénistes] on dit la race,
vous [les marxistes], vous dîtes la classe.
Mais moi les histoires théoriques, ça me soûle [rires]. On s’en fout. »
Houria Bouteldja lors de la présentation de son livre
Les Blancs, les Juifs et nous, en mars 2016.
Texte en PDF
C’était un soir lointain, un soir de fête. Des amis à la maison et parmi eux des gens d’ailleurs : une famille kazakhe ayant fui son pays car menacée de mort par une maffia locale et Juan et Alfredo, couple homo ayant profité d’un voyage en Europe pour déserter Cuba. Physiquement Juan a la peau claire tandis qu’Alfredo a les traits métissés. À un moment, la discussion a dû dériver sur le racisme. Nous étions en plein quinquennat sarkozyste, la chasse aux sans-papiers battait son plein et quelqu’un a dit qu’un type avec le physique d’Alfredo avait plus de risque de se faire contrôler par les flics qu’un blanc. Alfredo n’a rien dit mais il a souri, légèrement gêné. Juan a fait montre de sa surprise. Il a pointé du doigt son compagnon et nous a demandé : « Parce que, pour vous, Alfredo n’est pas blanc ? » La gêne a changé de camp et s’est nichée sur les épaules des Français. Il y a eu un silence. Pour nous, il était évident qu’Alfredo portait les signes physiques d’ancêtres africains, or nous comprenions soudain que notre regard n’avait rien d’universel. Apparemment nos amis cubains avaient un rapport beaucoup plus décomplexé avec la mélanine. Le fruit d’une éducation plus égalitaire ? Sauf que si officiellement Cuba avait éradiqué toute discrimination raciale depuis 1962, les faits étaient suffisamment documentés qui prouvaient la subsistance d’un racisme diffus dans la société insulaire.
Alfredo était-il blanc, noir ou métis ? La question, tout autant anecdotique que majeure, n’avait pas de réponse définitive puisqu’il suffisait de traverser un océan pour qu’elle soit sujette à diverses appréciations. Tout ceci n’empêchait pas d’être optimiste : le concept de race biologique définitivement invalidé par la recherche scientifique, nous étions en droit, nous les tenants naïfs d’une fraternité universelle, d’espérer nous débarrasser une bonne fois pour toute du poison taxinomique. Au fond il suffisait de décréter Alfredo « blanc » pour qu’agisse la magie performative et que nous soyons enfin autorisés à penser au-delà de ces basses catégorisations. Bien évidemment, c’était vite et mal penser. Car s’il est un piège en visant la race, c’est bien de la penser comme objet d’étude autonome alors qu’elle n’est, au fond, qu’une des nombreuses modalités de séparation des humains entretenue par les différents échelons, nationaux ou interétatiques, de l’ingénierie capitaliste. Mais de cette évidence qui aurait pu être tenue pour cap à maintenir au pays des femmes et hommes nés libres et égaux en droit, nous allions être privés. En quelques années la race dite « sociale » allait traverser, à l’instar d’Alfredo, elle aussi l’Atlantique pour venir irriguer bancs universitaires, réseaux militants et formations politiques. Chassé par la porte, le venin racialiste se réinvitait, à grands renforts de black ou postcolonial studies, par les fenêtres vermoulues d’un universalisme voué soudain aux pires gémonies. On nous expliquait alors que le racisme était structurel, que les Blancs (avec une majuscule) y jouissaient, sciemment ou à leur corps défendant, d’un évident « privilège », que race et classe étaient désormais à comprendre comme une équivalence de bonnet blanc et blanc bonnet. Contrairement aux apparences, les « entrepreneurs de l’identité » n’escomptaient pas faire un bilan critique de ce que plus de deux siècles de mythologie républicaine, adossée au développement de la doxa libérale – et aussi à ses multiples résistances –, avait pu produire en terme de pensée émancipatrice, mais bien de prononcer la caducité, ferme et définitive, de tout projet visant à rassembler en un nous à la fois compact et diversifié la masse bigarrée des opprimés. Héritier maudit des expansions et extorsions coloniales, ce camp des Blancs auxquels le soussigné était soudain assigné, devait accepter de se déconstruire de l’intérieur en battant sa coulpe, étant entendu que ce savoir sur lequel d’historiques lignées avaient cru bon nourrir quelques ambitieuses braises révolutionnaires n’était rien d’autre qu’un « privilège énonciatif eurocentré construit par le colonialisme et l’idée de modernité ». Dont acte.
Dans la conclusion de leur solide étude, Race et sciences sociales – Essai sur les usages publics d’une catégorie, le sociologue Stéphane Beaud et l’historien Gérard Noiriel font ce constat relativement sombre : « Nous ne nous faisons pas trop d’illusions sur la réception de cet ouvrage. L’expérience nous a appris que même si on multiplie les précautions de langage, les forces qui s’affrontent sur la question identitaire utiliseront tel ou tel de nos arguments pour alimenter leurs polémiques, soit pour nous rallier à leur cause, soit pour nous dénoncer. L’argument favori des philosophes marxistes qui n’acceptaient pas la critique était d’affirmer que leurs contradicteurs “faisaient le jeu” du pouvoir ou du grand capital. C’est le même genre d’insultes que reprennent aujourd’hui les intellectuels identitaires qui discréditent leurs concurrents en les accusant de “faire le jeu” des racistes ou des islamistes. » Pour le coup, les deux chercheurs ne se sont pas trompés car c’est peu dire que la publication de leur travail leur a valu une shit-storm de belle envergure comme on dit aujourd’hui dans notre langue colonisée à l’angliche. À croire que « tempête de merde » aurait manqué de classe et rabaissé le niveau du débat à la rase motte d’une insupportable trivialité.
Campés dans une lignée durkheimo-bourdieusienne avec cette double idée d’autonomie d’une science devant être tenue à distance des agendas politiques et médiatiques et d’une capacité du chercheur à « mobiliser les outils de la sociologie pour “se connaître soi-même comme sujet connaissant” » (poncif réflexif qui commande au chercheur contemporain d’expliquer d’ « où » il parle), force est de constater que tant de prudence dans la démarche n’a pas suffi à déminer le terrain. Qui, cependant, peut feindre d’être surpris quand on sait avec quelle virulence paniquée les mandarins et leurs ouailles postmodernes accueillent les voix contraires à leurs pseudo-savantes élucubrations ? Avec nous ou contre nous, une fois dépoussiérée de son jargon d’apparat, la pensée postmoderne est avant tout une pensée réduite à une épileptique binarité. S’alignant sur ce substrat publicitaire voulant que la marchandise du moment vaudra toujours mieux que celle d’hier, les fourbisseurs en néo-radicalisme racialisé (ça marche aussi avec « genré »), nous l’assurent sur tous les tons : c’est en fécondant et multipliant les passions victimaires que seront ringardisés les grossiers schémas explicatifs du passé. À chacun d’affûter son trébuchet personnalisé pour mesurer son taux d’atteinte discriminatoire et de l’intersectionnalité viendra le salut de toustes.
À rebours d’une telle stratégie de miettes, Beaud et Noiriel prennent grand soin d’historiciser et de documenter tant leur méthode de travail que leur objet d’étude. Fidèles à un Bourdieu qui voyait chez ses condisciples marxistes des « obnubilés » de la classe sociale, à aucun moment les chercheurs ne laissent cependant entendre que les discriminations raciales ne compteraient qu’en tant qu’éléments à charge négligeables dans l’écheveau des facteurs de domination. Faisant pièce à ce slogan qui voudrait que, désormais, lutte des races égale lutte des classes, ils réintroduisent une hiérarchie dans laquelle le dépassement de la question raciale ne pourrait s’envisager qu’en subordonnant cette dernière à la « classe sociale d’appartenance » (comprise comme un cumulé du capital économique et culturel). Voilà pour le coup de tonnerre et le coup de poignard fiché entre les omoplates des « racisés ».
Si à aucun moment les auteurs ne se prononcent sur la légitimité de luttes menées au nom ou par des « minorités raciales », leur crime est dans cette permission qu’ils s’octroient donc de discuter de la pertinence de cadres théoriques imposés par les promoteurs d’une racialisation tous azimuts. C’est qu’en ce domaine comme dans tant d’autres, la France aurait accumulé un effroyable retard par rapport au pays du Coca-cola et du multiculturalisme – en effet, tout le monde aura pu mesurer la sensationnelle amélioration de la condition noire américaine après plus d’un demi-siècle d’affirmative action et huit années de présidence Obama. Et que de ce susdit retard découlerait une urgence à déchirer le voile d’une hypocrite color blindness, réflexe tantôt oiseux tantôt pernicieux, pour qui refuse encore à accorder à la race sa place prépondérante. Or, écrivent Beaud et Noiriel, « affirmer que “la République” aurait été aveugle à la race ne veut rien dire d’un point de vue socio-historique car la question raciale a été un enjeu de luttes constant entre différentes fractions du champ politique républicain. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que le droit français a refusé (sauf exception) de catégoriser la race. C’est sur ce point que se situe la différence fondamentale entre la France et les États-Unis. […] Or, catégoriser le monde social, c’est toujours une opération arbitraire qui privilégie certains critères en laissant les autres dans l’ombre. Étant donné qu’aux États-Unis le critère racial a été constamment au cœur des procédures de catégorisation, il est compréhensible qu’il soit devenu une dimension de leur identité que les personnes acceptent ou revendiquent. »
S’il est un développement à prendre en compte au titre des conséquences des discours faisant de la race l’alpha et l’oméga de l’ordonnancement économico-social, c’est bien l’enfermement de « populations-cibles » dans des ensembles clos où la charge identitaire pourra jouer à plein (notamment dans les classes populaires moins pourvues en « ressources » matérielles ou symboliques pour se défaire d’assignations réductionnistes). En effet, énoncés dans l’espace public, statistiques et stéréotypes produisent à leur tour une forme de réalité retorse par le biais d’une intériorisation et appropriation des discours par les « minorités ». Il n’y a qu’à revisiter certaines figures archétypales du style « beur des banlieues » des années 1980 – figure qui finira par s’autoréaliser surtout quand le susdit individu, à la fois exclu de l’épanouissant marché du travail par un chômage devenu de masse et de toute perspective émancipatrice par l’abandon d’une gauche acquise aux démagogies identitaires – n’aura d’autre possibilité que de se projeter en confirmant les pronostics prononcés à son endroit : sois arabe et tais-toi ! Science-fictionnons un bref instant et imaginons que les discours tenus à l’attention de populations reléguées aient consisté à leur faire comprendre qu’elles cumulaient toutes les bonnes raisons pour barricader Bastille-Nation, la suite eût sans doute été tout autre. Argument bassement démago grimaceront les effarouchés. Sauf qu’on a dansé sur des ronds-points pour moins que ça.
Beaud et Noiriel mettent en garde face à ce qu’ils appellent une inflation des « polémiques identitaires dans le débat public ». D’abord parce que la dynamique, perverse et bien huilée, alimente par les mêmes cordons simplificateurs des expressions racistes de plus en plus décomplexées. Ensuite parce qu’il n’y a qu’un pas du ghetto physique au ghetto mental, celui qui couple à une ségrégation spatiale incontestable une vision ethnicisée de la société : « Le “nous” (de la cité, des jeunes noirs ou arabes, des exclus, mais aussi de plus en plus, semble-t-il, le “nous musulmans”) versus le “eux” (des bourgeois, des “céfrans”, des “gaulois”, des blancs ou des athées, etc.). [Leur] recherche [les] ayant conduits à la conclusion que si l’on voulait pousser la lutte contre le racisme jusqu’au bout, il fallait aussi combattre cet enfermement identitaire car il empêche ces jeunes révoltés d’apercevoir que leur existence sociale est profondément déterminée par leur appartenance aux classes populaires. »
Dit autrement : accepter que le retournement du stigmate (comme la couleur de la peau) constitue l’ADN de sa subjectivité politique, c’est accepter de se laisser définir par les termes de l’ennemi. Qu’il soit leader spirituel, expert en tribalisme ou universitaire progressiste.
Sébastien NAVARRO

Commentaires récents