
À propos de l’état du monde et d’un livre de Frédéric Lordon
Serge Quadruppani – paru dans lundimatin#217, le 18 novembre 2019 Appel à dons Nous voici donc entrés dans l’ère des soulèvements mondiaux. D’un bout à l’autre de la planète, gilets jaunes et lasers, applis et slogans, techniques du saccage et modes d’invasion pacifique, la grammaire de la révolte se partage toujours davantage. D’Alger à Santiago, de Bagdad à Hong-Kong, de Quito à Khartoum, de Conakry à Beyrouth, des millions de gens se sont mis en mouvement, des centaines de personnes sont déjà mortes et des centaines de milliers reviennent pourtant affronter les gaz et les balles. Un mot d’ordre multilingue est apparu, projeté sur la façade aveugle d’un gratte-ciel au Chili, ou bombé sur un mur à Hong-Kong : « Nous ne retournerons pas à la normale, car c’était la normale le problème ». Si toutes ces personnes repartent inlassablement à l’assaut avec un courage et une inventivité admirables, c’est donc qu’elles ont, sous des formes variables, de gros problèmes avec la normalité des institutions qui les écrasent et de la police qui les tue, de l’argent qui manque et du travail qui paie si peu.
1.« Se porter à la hauteur de l’époque »
Nous voici donc entrés dans l’ère des soulèvements mondiaux. D’un bout à l’autre de la planète, gilets jaunes et lasers, applis et slogans, techniques du saccage et modes d’invasion pacifique, la grammaire de la révolte se partage toujours davantage. D’Alger à Santiago, de Bagdad à Hong-Kong, de Quito à Khartoum, de Conakry à Beyrouth, des millions de gens se sont mis en mouvement, des centaines de personnes sont déjà mortes et des centaines de milliers reviennent pourtant affronter les gaz et les balles. Un mot d’ordre multilingue est apparu, projeté sur la façade aveugle d’un gratte-ciel au Chili, ou bombé sur un mur à Hong-Kong : « Nous ne retournerons pas à la normale, car c’était la normale le problème ». Si toutes ces personnes repartent inlassablement à l’assaut avec un courage et une inventivité admirables, c’est donc qu’elles ont, sous des formes variables, de gros problèmes avec la normalité des institutions qui les écrasent et de la police qui les tue, de l’argent qui manque et du travail qui paie si peu. Presque partout, le mouvement persiste en ses propres scansions, sans se satisfaire des quelques concessions obtenues du pouvoir. Car l’horizon, comme l’a crié, son bambin sur la hanche, la chanteuse Carmila Moreno, ce n’est pas l’abolition d’une taxe sur le carburant ou d’une loi liberticide, c’est « une société véritablement nouvelle ».
Tout effort théorique tentant de dessiner les contours et les conditions de possibilité d’une telle société sera donc le bienvenu si l’on veut se porter à la hauteur de l’époque présente, en ce qu’elle a de si formidablement nouveau. C’est pourquoi on approuvera que dès la couverture de son nouveau livre, Frédéric Lordon pose la question d’une vie sans institutions, sans police, sans travail et sans argent. C’est pourquoi aussi on désapprouvera sa réponse : se passer de ces réalités « infernales » (le mot est de lui) ? Oui, dit-il, ce serait bien, mais en fait, non, ce n’est pas possible.
Avant de développer des analyses prenant pour prétexte l’ouvrage du talentueux essayiste et animateur de réunions publiques, je dois me situer dans un échange où je suis en quelque sorte dans la position du tiers importun. En effet, si le livre de Lordon est, formellement, un dialogue avec un employé de La Fabrique, il est en fait presque entièrement structuré autour de la discussion des thèses du Comité Invisible. De cet auteur collectif et anonyme, j’ai lu tout ce qui a été publié chez le même éditeur et, malgré quelques manques et diverses obscurités inutiles, et en dépit du sentiment que tout ça était moins neuf que ça n’avait l’air de le croire, il m’a semblé que ces écrits étaient de ceux qui saisissaient le mieux les enjeux de notre temps. Toutefois, ayant eu, dans l’après-68, d’autres fréquentations que celle de mes profs d’hypokhâgne, et d’autres lectures que les philosophes au programme, me voici fort dépourvu pour affronter la querelle spinoziste que Lordon cherche à mener contre le C.I. Mais cette querelle lui fournit l’occasion de nombreux développements quant aux modalités d’interventions dans la guerre sociale. Sur ce terrain-là, même si l’on ne dispose pas du paquetage spinozo-bourdieusien avec lequel Lordon part au front, il pourra s’avérer utile de partager quelques outils théoriques fournis par l’histoire des courants révolutionnaires anti-capitalistes, antistaliniens et non léninistes, avec leurs prolongements jusqu’à nos jours. On verra que ce n’est pas une coïncidence si ces références-là, je les partage largement avec le C.I., en dépit du fait que ce dernier semble les tenir tellement pour acquises qu’il ne les explicite guère.
Une critique radicale de la domination ne peut se faire qu’au prix de la constitution d’un langage qui ne soit pas le langage courant, c’est-à-dire dominé. Mais chaque obscurité inutile, chaque complication superfétatoire de l’expression augmente l’éloignement du locuteur de ceux à qui il est censé s’adresser, et expose au reproche de rechercher, à travers les prestiges du verbe, une forme de domination. Chez Lordon, malgré l’abondance d’expressions familières et souvent plaisamment humoristiques, toute une rhétorique à base de « conatus », de « causalité interne », de « régime des affects actifs » et autres « structure télique » ou « effectuation intransitive » affaiblit la première critique d’importance qu’il adresse au C.I., à savoir de développer une conception élitaire de la politique.
Il croit pouvoir opposer, en effet, ce qu’il distingue comme « la politique par l’éthique », qui serait propre au C.I., et « la politique par les masses ». Distinction fallacieuse : ce qui a fait naître le mouvement des gilets jaunes, qu’était-ce d’autre qu’une révolte contre l’injustice d’une taxe gas-oil faisant peser sur les moins pourvus la responsabilité du désastre écologique, qu’était-ce d’autre donc, qu’un sursaut éthique ? En vérité, que ce soit contre la charge de mépris derrière une augmentation, contre le déni de démocratie, ou bien contre la corruption, ou tout cela à la fois, les « masses » qui se soulèvent, aujourd’hui comme hier, ne le font jamais que pour des questions éthiques. Quoi de plus éthique que l’immolation de Bouazizi ou celle d’Anas, dont Lordon sait si bien parler par ailleurs [1] ?
Quand le C.I. insiste sur la « centralité de la vieille question éthique », il ne fait rien d’autre que nous ramener à une idée qu’en leur temps, Maximilien Rubel (traducteur de Marx dans la Pléiade) et d’autres avec lui, avaient avancée contre un marxisme scientiste qui voyait la révolution comme l’aboutissement inéluctable de la dynamique abstraite du capital (les fameuses contradictions internes), dans laquelle les volontés et les affects n’avaient pas grand-chose à faire. Pour Rubel, « l’éthique révolutionnaire (l’éthique d’émancipation) est irréductible à toute science révolutionnaire mais s’enracine dans l’existence réelle (historiquement présente) d’une exigence, d’une tension émancipatoire chez ceux-là mêmes qui doivent être émancipés. » [2] Chez Marx, selon lui, l’éthique est « une catégorie centrale de sa pensée, celle qui sert de moteur, impulse la décision de mener un combat militant ; un combat de démystification de toutes les aliénations ». Dès lors qu’on considère les écrits de Marx comme une boîte à outils, la question de savoir si le Marx de Rubel serait ou non le Marx « réel », historique, n’a que peu d’intérêt [3]. Ce qui compte, c’est que, malgré l’antimarxisme qu’affiche parfois le C.I., il se trouve dans la continuité d’une conception (qui est aussi la mienne) liant indissolublement « politique par l’éthique » et « politique par les masses ».
Selon Lordon, cette voie éthique aurait pour corollaire de faire de la politique l’affaire d’un « petit nombre » de « virtuoses ». Mais aussitôt après cette affirmation, il note comme un paradoxe que « le Comité invisible et Lundi.am, à l’opposé du gauchisme de la chaire, se sont trouvés, dès le premier jour, sans l’ombre d’une hésitation », engagés du côté des gilets jaunes et de leur « révolution impure ». Cette position pratique est à ses yeux « somme toute très léniniste », et en opposition à la position théorique qu’il attribue au C.I., celle d’une « ligne virtuose, abstraite, d’un n’être-pas-suivi ». Cette dernière formule à traits d’union, il l’a déduite d’une phrase tirée d’une postface signée « Julien » au recueil de textes de Daniel Denevert, Dérider le désert. Ce Julien-là, que Lordon assimile au C.I., écrit en effet : « faire du bruit n’aurait aucun sens, sinon pour être suivi. Il n’est jamais bon d’être suivi. » Il est quand même assez symptomatique que deux phrases qui énoncent littéralement le refus du suivisme expriment aux yeux de Lordon le choix d’une solitude altière. Serait-ce qu’il ne conçoive pas autrement le rôle du révolutionnaire que sous les traits du tribun se plaçant à la tête des troupes prolétariennes ? Ce serait cohérent avec son petit compliment sur le « léninisme » supposé de la position du C.I. et de Lundi.am aux côtés des gilets jaunes. En effet, on connaît (enfin, beaucoup connaissent) la position de Lénine quant aux capacités révolutionnaires des masses et au rôle que les intellectuels doivent tenir auprès d’elles :
« L’histoire de tous les pays atteste que la classe ouvrière, livrée à ses seules forces, ne peut arriver qu’à la conscience trade-unioniste, c’est-à-dire à la conviction de la nécessité de s’unir en syndicat, de mener la lutte contre les patrons, de réclamer du gouvernement telle ou telle loi nécessaire aux pouvoirs, etc. Quant à la doctrine du socialisme, elle a surgi des théories philosophiques, historiques, économiques élaborées par des représentants instruits des classes possédantes, les intellectuels. Par leur situation sociale, les fondateurs du socialisme scientifique contemporain, Marx et Engels, étaient des intellectuels bourgeois. De même, en Russie, la doctrine théorique de la social-démocratie surgit indépendamment de la croissance spontanée du mouvement ouvrier ; elle fut le résultat naturel et fatal du développement de la pensée chez les intellectuels révolutionnaires socialistes. » (Que faire ?)
Les courants révolutionnaires non-léninistes auxquels je me réfère plus haut ont montré la faiblesse de cette conception qui sépare le travail intellectuel révolutionnaire de l’action des prolétaires : en réalité, la pratique précède toujours la théorie. C’est la pratique prolétarienne, celle des résistances et des luttes qui a fait naître la théorie communiste. Si le jeune Marx a eu l’intuition que « les philosophes ont assez interprété le monde, il est temps de le transformer », c’est d’abord parce qu’il percevait dans la société de son temps, et singulièrement du côté des prolétaires, des forces de transformation en gestation. Refuser « d’être suivi » ne signifie pas forcément choisir la solitude, mais peut-être bien vouloir marcher avec les « masses » sans chercher à en prendre la tête : de Rosa Luxemburg aux communistes de Conseil des années 20 et de Socialisme ou Barbarie aux groupes « ultra-gauche » d’aujourd’hui, l’accent mis sur la spontanéité révolutionnaire des masses et sur leur capacité d’auto-organisation a parfois pu passer pour un acte de foi. Né de l’analyse d’événements comme l’insurrection de 1905 en Russie ou la république des Conseils de Bavière ou la Révolution espagnole, ce parti pris n’a pourtant pas cessé de prouver sa pertinence, que ce soit autour de 1968 ou en bien d’autres occasions, gilets jaunes compris. [4] Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les soulèvements d’aujourd’hui à travers le monde n’ont pas l’air de lui donner tort.
Sur quoi peuvent déboucher ces insubordinations de masse ? C’est la question centrale de notre époque. Le thème des changements constitutionnels est parfois présenté comme une réponse, que ce soit par des gouvernants soucieux d’un retour à la normale, ou par certains courants au sein des contestataires – n’oublions pas, naguère, les milliers d’heures passées par une tendance des Nuits Debout à discuter d’une nouvelle constitution. Du hirak d’Algérie à l’Irak, des émeutes du Chili à Hong Kong, la volonté de destituer les gouvernants demeure toutefois l’âme du mouvement, ce qui lui donne sa force et sa continuité. Cette dernière circonstance donne une résonnance particulière au fait, que, confronté à l’exigence destituante telle que l’expriment les écrits du C.I., Lordon insiste sur l’indépassable nécessité des institutions. L’institution est au fond, nous dit-il (mais je le dis en mes termes), le propre de toute société humaine. Pour illustrer cette idée, il fournit deux curieux exemples. D’abord celui des agences de notation qui, selon lui, si on les supprimait, en cas de crise financière comme celle de 2008, se verraient aussitôt remplacées par d’autres formes de notation en quelque sorte spontanément instituées par le marché. Pardon, Frédéric, mais – pour employer une de ces expressions décontractées dont tu agrémentes ton propos – quel rapport avec le potage ? En quoi une manifestation de ce que le capitalisme a de plus artificiel et de plus immédiatement supprimable – sa sphère financière – peut-il être pris comme exemple de la « nécessité et [de la] généralité du fait institutionnel » ? Autre exemple : celui… de la poignée de mains. Si, en arrivant dans une assemblée, on se met à serrer la main autrement que de la droite, assure Lordon, « ça va commencer à murmurer ». A part que des millions de gens, en particulier dans la jeunesse, ont inventé diverses manières de se saluer (citons les nombreuses variations du « check »), on est en droit de trouver décidément trop extensive cette définition de l’institution qui englobe autant des organismes officiels que les normes de comportement.
Je ne défends pas spécialement la rhétorique destituante du C.I. car elle n’est à mes yeux que les habits neufs de bonnes vieilles idées libertaires. Si, comme il me semble, la critique de Lordon revient à invoquer la nécessité de s’organiser pour instaurer de nouvelles formes de vie en opposition à celles du capitalisme, on peut rétorquer que le C.I. discute des manières de s’organiser, pas de la nécessité de le faire. Mais l’institution, c’est autre chose. Selon l’une d’entre elle (l’Académie française), l’institution c’est « ce qui a été institué pour le gouvernement des hommes » et, par extension, « les grands organismes établis à cette fin ». Dans ce sens-là, qui est tout de même le plus répandu et le plus immédiatement compréhensible, oui, il me semble bien qu’on peut se passer des institutions. Mais leur abolition n’est pas concevable sans la dissolution de la police qui les défend, sans l’extinction de l’Etat dont elles forment l’armature, sans la disparition de ce que, in fine, elles sont là pour réguler : l’aliénation de l’activité humaine par le travail et par l’argent.
En revanche, on peut rejoindre Lordon quand il pointe la faiblesse d’une conception qui verrait le processus révolutionnaire comme une simple multiplication de communes ou de zad, un « archipel », pour reprendre le terme d’Alain Damasio, archipel qui, à force de multiplier les îlots de vie nouvelle, en viendrait à recouvrir la planète. Avec les gilets jaunes, mouvement dont la puissance et la nouveauté secouante ont reposé sur l’articulation entre vie des ronds-points et manifs métropolitaines, on a vérifié que les événements qui ébranlent le capitalisme portent déjà en eux l’anticipation d’un autre monde. En effet, si le niveau local a bien été décisif pour asseoir la puissance du mouvement et développer une nouvelle socialité, préfiguration des nouvelles formes de vie désirables, on a vérifié que ces dernières ne pourront se déployer qu’en s’appuyant sur d’autres échelles. Ce qui nous ramène à une faiblesse de l’option localiste, que je signalais dans une critique [5] de Premières mesures révolutionnaires, d’Hazan et Kamo. S’appuyant sur la rhétorique destituante, ce livre était une tentative bienvenue de dessiner les traits d’une société réellement nouvelle. Du niveau local dont il faisait le fondement d’une révolution, j’écrivais : « l’adéquation des besoins et des moyens ne peut s’opérer seulement à cette échelle. Sans la réappropriation-transformation des réseaux trans-locaux et trans-nationaux, le local serait condamné à une autarcie mortifère, aussi bien matériellement (quelle que soit l’ampleur de la relocalisation possible de la production et de l’énergie, des flux venus d’ailleurs demeureront indispensables) que spirituellement (que seraient nos vies sans le contact avec les rêves, les chants, les œuvres de nos amis togolais, papous, nord-américains ou chinois ? De tous petits trucs rabougris). Comment faire fonctionner ces réseaux sans recréer une structure étatique ? (…) Mais demeure entière la question du rapport entre les différents échelons de décision. C’est une bonne chose de laisser au local la tâche de créer les dispensaires, mais comment se décidera la répartition du matériel nécessaire, presque toujours produit ailleurs ? En fonction de quels critères ? Comment éviter que les intérêts particuliers l’emportent sur la supposée bonne volonté générale ? Comment empêcher les indispensables réseaux régionaux, continentaux et mondiaux de redevenir une structure étatique ? Encore une fois, l’ampleur de la question ne doit pas empêcher de la poser. »
Le soussigné réussira-t-il à répondre à cette question et à quelques autres impliquées par le projet d’une « société véritablement nouvelle » ? Vous le saurez en lisant la deuxième partie de ce texte à paraître dans le prochain Lundi Matin, et intitulé : « Une société véritablement nouvelle – 2 : Vivre sans spécialistes de la politique, de l’économie, du nucléaire, du numérique, de Spinoza… »
[1] https://blog.mondediplo.net/la-precarite-tue-le-capitalisme-tue-le-macronisme
[2] Roland Lew, « Rubel et la question de l’éthique Chez Marx », in L’Homme et la Société, 1987pp. 55-69
[3] Crachons au passage sur le Marx inventé par Althuser avec sa bouffonne « coupure épistémologique », qui nie l’unité des exigences éthiques et des ambitions scientifiques de Marx, alors qu’elle s’est vérifié toute sa vie. L’envie de cracher augmente encore quand on voit la postérité althussérienne, avec l’ignoble petite bande des chefs de la Gauche prolétarienne et leur destin de notables réactionnaires.
[4] Pour comprendre un peu plus précisément sur quels courants je m’appuie, cf. Le Socialisme Sauvage, de Charles Reeve, à l’Echappée.
[5] http://www.article11.info/?Preparatifs-pour-la-prochaine-fois#nb2
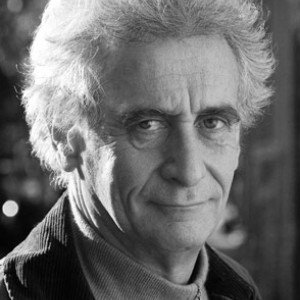
Serge Quadruppani en attendant que la fureur prolétarienne balaie le vieux monde, publie des textes d’humeur, de voyages et de combat, autour de ses activités d’auteur et traducteur sur https://quadruppani.blogspot.fr/

J’attends, pouer faire un commentaire, la réponse du « soussigné » à la question et à quelques autres impliquées par le projet d’une « société véritablement nouvelle »
Salut
Octavio