par
Il n’existe pas un seul instant qui ne porte en lui sa chance révolutionnaire.
Walter Benjamin
Thèses « Sur le concept d’histoire » (traduction de Maurice de Gandillac).
■ Michael LÖWY
WALTER BENJAMIN : AVERTISSEMENT D’INCENDIE
UNE LECTURE DES THÈSES « SUR LE CONCEPT D’HISTOIRE »
Paris, L’éclat/poche, 2018, 240 p.
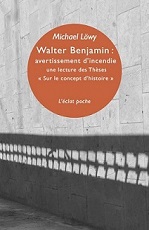 Les Thèses « Sur le concept d’histoire » de Walter Benjamin occupent une situation particulière et complexe tant dans l’œuvre et dans la vie de celui-ci que dans son temps. Il s’agit en effet de l’ultime texte de Benjamin, rédigé à Paris en 1940 peu avant qu’il ne se donne la mort. Comme on le sait par l’une de ses dernières lettres à Gretel Adorno, écrite en mai de cette funeste année, il ne le destinait pas à la publication, par crainte d’une réception faible et erronée, mais aussi probablement parce que ces Thèses fragmentaires constituaient la matrice d’une œuvre qu’il entendait enrichir et développer. Son écriture est par ailleurs contemporaine de circonstances historiques qui feraient désespérer les plus braves et dont l’intelligence est essentielle à la compréhension du texte. En bref, la signature en août 1939 du pacte de non-agression germano-soviétique (aussi connu sous le nom de pacte Ribbentrop-Molotov) aurait poussé Benjamin à coucher par écrit ses considérations sur la signification du concept d’histoire afin de mettre en évidence l’absurdité d’une conception progressiste de celle-ci, défendue notamment par les partisans de la « patrie du socialisme » qui devaient désormais répondre de l’alliance entre l’URSS et le régime nazi.
Les Thèses « Sur le concept d’histoire » de Walter Benjamin occupent une situation particulière et complexe tant dans l’œuvre et dans la vie de celui-ci que dans son temps. Il s’agit en effet de l’ultime texte de Benjamin, rédigé à Paris en 1940 peu avant qu’il ne se donne la mort. Comme on le sait par l’une de ses dernières lettres à Gretel Adorno, écrite en mai de cette funeste année, il ne le destinait pas à la publication, par crainte d’une réception faible et erronée, mais aussi probablement parce que ces Thèses fragmentaires constituaient la matrice d’une œuvre qu’il entendait enrichir et développer. Son écriture est par ailleurs contemporaine de circonstances historiques qui feraient désespérer les plus braves et dont l’intelligence est essentielle à la compréhension du texte. En bref, la signature en août 1939 du pacte de non-agression germano-soviétique (aussi connu sous le nom de pacte Ribbentrop-Molotov) aurait poussé Benjamin à coucher par écrit ses considérations sur la signification du concept d’histoire afin de mettre en évidence l’absurdité d’une conception progressiste de celle-ci, défendue notamment par les partisans de la « patrie du socialisme » qui devaient désormais répondre de l’alliance entre l’URSS et le régime nazi.
Toutes ces caractéristiques expliquent l’extrême difficulté qui réside dans la compréhension des Thèses et, en conséquence, la grande variété d’interprétations qu’elles ont suscitée. La plupart d’entre elles assument, tant à propos de l’œuvre dans son ensemble que de ce texte en particulier, l’idée selon laquelle il faudrait lire Benjamin en tenant séparément compte d’un Benjamin théologien et d’un Benjamin marxiste ou plus simplement historien. Ce sont, par exemple, les perspectives que privilégient des commentateurs comme Giorgio Agamben (pour la théologie) ou Krista R. Greffrath (pour l’histoire). Ce n’est pas l’hypothèse retenue par Michael Löwy dans le très beau commentaire qu’il consacre aux Thèses dans son Walter Benjamin : avertissement d’incendie, dont les Éditions de l’Éclat proposent, en collection de poche, une nouvelle édition augmentée du texte original en allemand. Dans la continuité de ses travaux sur le romantisme et la révolution, Löwy refuse, en effet, toute partition entre les deux perspectives de la pensée de Benjamin. Le commentaire privilégie ainsi une lecture qui s’attache scrupuleusement à toujours éclairer sa dimension matérialiste par sa dimension messianique, et réciproquement. Une telle lecture a pour elle, en plus d’être convaincante et éclairante, de pouvoir se prévaloir de ce mot de Benjamin se décrivant lui-même comme un « Janus à deux faces ». Or, comme le note judicieusement Löwy, si Benjamin « aimait à se comparer à un Janus, dont un des visages regarde vers Moscou et l’autre vers Jérusalem […], on oublie souvent […] que le dieu romain avait deux visages, mais une seule tête : marxisme et messianisme ne sont que les deux expressions […] d’une seule pensée » (p. 44).
Il n’est pas indifférent d’ajouter, par ailleurs, que la lecture – talmudique – de Löwy se caractérise par une grande clarté d’exposition, une attention méticuleuse apportée à la lettre du texte, mais aussi une constante ouverture à la pluralité des interprétations possibles – jamais récusées en polémiste. Exposant toujours le processus et les moyens de sa propre pensée et n’en dissimulant jamais les moments inchoatifs, elle traduit par ailleurs le profond désir de Löwy d’être à son tour lui-même discuté.
Progressisme et progrès
Son interprétation des premières Thèses met en avant la critique benjaminienne du concept de progrès. Revendiquée aussi bien par les défenseurs du capitalisme que par les adeptes du socialisme souhaitant voir advenir sa fin, l’idée de progrès est solidaire d’une vision de l’histoire comprise comme la suite nécessaire d’événements s’enchaînant mécaniquement vers la meilleure des destinations possibles. Que les objectifs de ces progressistes des deux bords soient antinomiques ne change rien au fait qu’ils partagent une conception commune de l’histoire humaine. Pour les uns comme pour les autres, celle-ci serait, au même titre que n’importe quel phénomène naturel, soumise à l’une de ces lois que les sciences dites positives découvrent par l’observation et l’expérimentation. Appliquée au fait humain, une telle perspective revient tout simplement à nier la part imprévisible de liberté que celui-ci porte et peut faire surgir – la « faible force messianique » qui revient, d’après Benjamin, à chaque génération –, mais aussi la possibilité de faire et, surtout de défaire, les lois auxquelles nous obéissons – ou pas. De part et d’autre de leur apparente opposition, staliniens, sociaux-démocrates et capitalistes partagent donc beaucoup plus qu’ils ne le laissent paraître. Sur le plan de l’histoire notamment, ce positivisme rigide a pour conséquence immédiate une domination autoritaire et sans partage de la sphère de l’économie sur la totalité des aspects de la vie sociale, et plus largement de l’humanité. En un mot, pour les progressistes – ceux d’hier comme ceux d’aujourd’hui –, l’histoire, processus automate, relève d’une pure accumulation quantitative d’événements. Le terme de progrès, qui recoupe tant l’idéologie béate (et néanmoins agressive) des défenseurs du capitalisme que la conception naïve (mais intéressée) des adeptes du socialisme qui considèrent comme inévitable l’avènement d’une société sans classes, renvoie donc dans les deux cas à une conception strictement mécaniste de l’histoire, dont on a pu faire le reproche à Marx d’être précisément l’un des plus éminents représentants [1]. Or, si Benjamin est un remarquable critique de l’idéologie du progrès ainsi conçu, Löwy montre bien que cette critique ne l’éloigne pas de Marx, mais qu’elle est, au contraire, solidaire de son matérialisme. En effet, Benjamin est « un critique révolutionnaire de la philosophie du progrès, un adversaire marxiste du ‘‘progressisme’’, un nostalgique du passé qui rêve de l’avenir, un romantique partisan du matérialisme » (p. 11). C’est donc à travers une lecture de Marx qu’il propose une conception de l’histoire qui s’oppose à celle de nombreux marxistes orthodoxes, histoire ouverte et qualitative contre histoire inéluctable et quantitative.
Toutefois, Benjamin est loin de renoncer à l’idée même de progrès. Il en renouvelle plutôt la conception à l’aide de cette dialectique si particulière qu’il établit entre théologie et matérialisme. S’inspirant sur ce point de Hermann Lotze, Benjamin considère avec ce dernier qu’« il n’y a pas de progrès si les âmes qui ont souffert n’ont pas droit au bonheur (glück) et à l’accomplissement (vollkommenheit) » et qu’il faut donc rejeter « les conceptions de l’histoire qui méprisent les revendications (ansprüche) des époques passées, et qui considèrent que la peine des générations passées est irrévocablement perdue » (p. 62). Le lien tissé entre révolution et rédemption implique que le progrès n’a de sens que par son rapport au passé. Il n’est donc pas assimilé à cette marche de l’histoire qu’il suffirait de suivre et de constater, mais renvoie à la possibilité révolutionnaire que chaque époque recèle en elle de faire droit aux exigences de ceux qu’on a fait taire. Son cours n’est pas celui d’une machine lancée à toute vapeur sur les rails de l’histoire inéluctable, destination révolution. Il est au contraire cette possibilité collective de « tirer les freins d’urgence » [2].
S’il conserve l’idée de progrès en en réinventant la substance, Benjamin ne garde rien de l’attitude de ceux qui ont foi en lui. Dans sa perspective, le progressisme comme l’historicisme sont également nuisibles et ce, non pas seulement pour les raisons théoriques que Benjamin expose en historien, mais aussi parce que, d’un point de vue pratique, loin de favoriser la réalisation du moment révolutionnaire, ils en interdisent le surgissement en suscitant une attitude attentiste et passive. Ces deux approches théoriques conçoivent, en effet, l’histoire comme relevant d’un cours irrésistible que l’historien comme l’opprimé ne peuvent qu’enregistrer. La conception benjaminienne de l’histoire se construit dans une opposition frontale à un tel paradigme, que le temps présent et les accords entre l’URSS et l’Allemagne nazie devraient suffire selon lui à disqualifier. C’est une des raisons pour lesquelles il peut sembler artificiel de séparer le Benjamin marxiste du Benjamin théologien. La révolution que théorise le premier a besoin de la signification que lui fournit le second. C’est d’ailleurs ce que vient figurer, dans la première thèse qui donne les clefs de lecture de l’ensemble du texte, l’image de ce joueur d’échec automate (le matérialisme) guidé jusqu’à la victoire par le truchement d’un nain expert (la théologie) dissimulé au cœur de sa machinerie.
De la révolution
C’est donc sous cet angle qu’il convient de comprendre ce qu’est une révolution pour Benjamin. Celle-ci relève bien, matériellement, d’un certain rapport de forces entre les classes antagonistes qui s’y trouvent confrontées. Mais, dans la mesure où la classe qui désire la victoire de la révolution est par définition celle qui dispose le moins à son avantage des forces matérielles qui s’y trouvent engagées, elle est aussi celle qui a le plus besoin des moyens d’accroître la « faible force messianique » (thèse II, p. 60) qui lui est échue pour espérer vaincre. Ces moyens lui sont précisément donnés par le rapport spécifique au passé qu’implique la conception benjaminienne de l’idée de progrès. C’est même là sa véritable tâche historique car « la rédemption messianique/révolutionnaire, écrit Löwy, est une tâche qui nous est attribuée par les générations passées. Il n’y a pas de Messie envoyé du ciel : c’est nous-mêmes qui sommes le Messie, chaque génération possède une parcelle du pouvoir messianique qu’elle doit s’efforcer d’exercer » (p. 66). La révolution est donc solidaire de la rédemption, en ce sens qu’elle n’existe pleinement qu’en faisant droit aux voix des vaincus qui se sont tues dans le passé. Dans ce rapport au passé et aux opprimés qui ont été vaincus, aucun misérabilisme de la part de Benjamin, mais une exigence historique et révolutionnaire qui demande réparation (tikkun en hébreu), dans le présent, des torts subis.
Pour lui, il est clair qu’en l’absence d’une telle dimension eschatologique et théologique, qui vient donner au moment présent son enracinement dans les revendications et dans l’exigence de réparation de ceux qui ont lutté et sont morts – et qui ne doivent pas être morts pour rien –, une révolution est matériellement vouée à l’échec. Un tel événement ne saurait donc s’accomplir dans l’amnésie. Il n’existe et n’a de sens que dans le rapport actif et collectif qu’il entretient avec ce qui l’a précédé. Le bonheur d’un temps révolutionnaire est irrémédiablement lié à l’idée de faire justice à ceux qui, dans le passé, se sont battus pour lui sans jamais parvenir à l’atteindre. C’est d’ailleurs ce que semblent confirmer de nombreux exemples lointains (la Commune de Paris comme écho de la révolution de 1789), mais aussi plus récents (les luttes en Amérique latine chères à Löwy et les aspects les plus intéressants du mouvement de mai 68 en France et ailleurs). Plus cruellement peut-être, en atteste négativement le vide exaspéré de notre propre époque, aussi soucieuse d’archives qu’elle est méprisante de l’histoire, incapable en tous cas d’esquisser d’autres futurs que l’éternelle répétition de ce que l’on n’ose plus nommer « nouveauté ».
En conséquence, la critique du progrès et du progressisme est, pour Löwy, solidaire de la conception benjaminienne de la révolution, car « le rapport entre aujourd’hui et hier n’est pas unilatéral : dans un processus éminemment dialectique, le présent éclaire le passé, et le passé éclairé devient une force au présent » (p. 80). Combinant matérialisme et messianisme, la révolution apparaît ainsi comme une « tentative d’arrêter le temps vide grâce à l’irruption du temps qualitatif, messianique – comme Josué avait, selon l’Ancien Testament, suspendu le mouvement du soleil, pour gagner le temps nécessaire à sa victoire » (p. 169). Ce temps qualitatif ou en suspens ne relève pas de l’éternel présent d’une société sans classe, mais du moment où la conjugaison victorieuse des faibles forces messianiques de chacun parvient à réaliser la fin de toutes les formes de domination. Il n’aspire pas davantage à un paradis éternellement projeté au devant de soi, mais à un présent messianique à l’intérieur duquel les torts du passé et les souffrances qu’ils ont entraînées se trouvent rédimés. L’irruption de l’utopie à l’intérieur même du présent vient, dès lors, « briser le continuum de l’oppression » (p. 164). Ainsi, le présent n’aboutit pas de manière inéluctable à la révolution, mais il la porte secrètement en lui comme possibilité explosive d’abolir l’ordre actuel en rachetant le passé.
L’historien et la révolution
Cette double intelligence du progrès et de la révolution suffit à expliquer pourquoi il serait erroné de ne voir en Benjamin qu’un historien. Et ce d’autant qu’il est un critique impitoyable de ce qu’il nomme « l’historicisme », c’est-à-dire cette façon de se rapporter au passé en se « [contentant] d’établir un lien causal entre les divers moments de l’histoire » (thèse A, p. 188). Pour Benjamin – comme pour le Nietzsche des Considérations inactuelles, qu’il cite – « l’histoire n’est utile que si elle sert le présent » (pp. 145-146). Dans une telle perspective, être historien, c’est être immédiatement révolutionnaire, et réciproquement. Ainsi, de la même façon que Löwy tient ensemble le messianisme et le matérialisme de Benjamin, il insiste, au sein de chacune de ces dimensions, sur l’indissoluble corrélation entre remémoration et rédemption, d’un côté, et histoire et révolution, de l’autre.
Cette unité indissoluble de la théorie et de la praxis, c’est certainement le concept de constellation qui en traduit le mieux la réalité et l’exigence. La tâche de l’historien n’est donc pas d’établir le lien causal qui unit des moments épars de l’histoire, mais bien de « découvrir la constellation critique que tel fragment du passé forme précisément avec tel moment du présent » (p. 176). Plutôt qu’une cause supposément objective, c’est bien l’intransigeance d’une subjectivité vivante et engagée dans son temps qu’il s’agit, dans un acte de remémoration, de projeter sur le passé. Loin de s’appauvrir en rigueur scientifique, c’est-à-dire de perdre de vue l’exigence de la vérité, une telle construction, pour supposer une projection subjective, n’en implique pas moins une attention exigeante à l’objectivité de ce qui est observé. À la différence de l’historicisme dont l’objectivité est en fait un effet déformant de la situation réelle à laquelle est confronté l’historien, la constellation critique, en assumant cette situation, se rend consciente de sa propre projection et en annule les effets de distorsion. Ainsi, la rationalité que l’observateur découvre dans la voûte constellée d’événements épars qu’est l’histoire, tient certainement à une projection de sa situation présente, mais elle ne contredit pas un travail d’observation patient et respectueux du passé. Elle en est même la condition du succès. De sorte que la part d’arbitraire et de convention qu’implique toute projection de soi sur l’objet se voie ainsi sublimée dans la reconnaissance de celui-ci. Une constellation n’apparaît, en effet, possible qu’au sein d’une totalité cohérente et ouverte. Elle permet d’apercevoir le tout (l’histoire) par la force suggestive de la partie (la constellation). Elle fonde une reconnaissance où s’harmonisent l’objectivité de ce qui est observé et la projection et l’effort de celui qui observe et se sent comme visé par l’objet de cette observation. Enfin, et c’est sans doute là le plus important, la constellation critique ainsi découverte permet concrètement et pratiquement de s’orienter dans le temps présent de l’observation. C’est de son rapport dialectique au passé que le présent, pour Benjamin, tire sa force révolutionnaire.
Ce n’est pas le moindre des mérites du commentaire de Löwy d’être lui-même en profonde cohérence avec cette exigence benjaminienne. Il s’efforce, en effet, en permanence de « mettre en évidence à la fois l’universalité et l’actualité du concept d’histoire de Walter Benjamin » (p. 46) en rapportant, par exemple, celui-ci aux présents des luttes menées en Amérique latine, et, de manière générale, en proposant une lecture d’autant plus convaincante de ces Thèses qu’elle est aussi, et de façon non dissimulée, personnelle. Construisant à son tour une constellation critique, Löwy restitue au temps actuel quelques-uns « des éclats du temps messianique » (p. 188) qui l’ont pénétré.
Ariane MINTZ et Basile ROSENZWEIG
[1] Marx et Engels écrivent, dans la première partie de L’Idéologie allemande consacrée à Feuerbach : « Nous ne connaissons qu’une seule science, celle de l’histoire. » Cette revendication éminemment discutable du caractère scientifique du marxisme suscita – et suscite encore – de nombreux débats et interprétations, en raison notamment de son exploitation positivement autoritaire par ses épigones. On se bornera ici à faire remarquer que, bien qu’aspirant à la catégorie de science positive, la pensée de Marx n’en demeure pas moins dialectique et critique, et par là-même difficilement assimilable à une quelconque forme de positivisme mécaniste.
[2] Au sujet de la révolution, Benjamin écrit : « Marx avait dit que les révolutions sont la locomotive de l’histoire mondiale. Mais il se peut que les choses se présentent tout autrement. Il se peut que les révolutions soient l’acte, par l’humanité qui voyage dans ce train, de tirer les freins d’urgence. » Ce passage est extrait des Gesammelte Schriften et cité par M. Löwy, p. 123.


Commentaires récents